mort du professeur Jacques Valette
mort du professeur Jacques Valette

mort du professeur Jacques Valette

Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris
Ce dimanche 28 mars 2021, M. Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris a déclaré sur la chaine LCI qu’il ne peut se mettre autour de la même table que les fédérations (CIMG «Milligorüs» et CCMTF Comité de Coordination des Musulmans Turcs de France») qui ont refusé de signer la charte des principes pour l’Islam de France. Il précise également qu’à travers ces deux fédérations l’État Turc s’ingère dans notre pays.
Dans cette même émission, le recteur m’accuse de me «cacher derrière les statuts du CFCM» pour continuer à avoir des contacts avec ces fédérations.
Il convient de rappeler que le même recteur a invité l’ambassadeur et représentant de l’État Turc en France à un déjeuner convivial, le 16 mars 2021, à la mosquée de Paris. Il a également rencontré le président du CCMTF, longuement à la mosquée de Paris le 12 mars 2021.
Quant à moi, j’ai organisé effectivement une réunion du bureau du CFCM, le 17 mars 2021, afin de désigner l’aumônier national des prisons, conformément à l’engagement pris, en octobre 2020, par le CFCM devant le ministre de la justice. Les responsables de ces deux fédérations, en leur qualité de membres élus du bureau du CFCM, ont participé à cette réunion.
Ce que le recteur qualifie abusivement de «se cacher derrière les statuts du CFCM» est en réalité le respect des règles qui régissent le CFCM conformément à loi de la République sur les associations. En vrai républicain, je ne peux transgresser les lois de la République et en même temps critiquer ceux qui n’ont pas signé la charte des principes pour l’islam de France. D’autant plus que cette charte met le respect des lois de la République au cœur de ses engagements.
Quant au recteur de la mosquée de Paris, rien ne l’obligeait à organiser ces rencontres avec ceux qu’il fustige, et dénonce et à forte raison dans les formats qu’il a choisis.
Cette réalité des faits montre clairement l’incohérence de l’action du recteur de la mosquée de Paris et son double langage malgré ce qu’il prétend être.
Mohammed MOUSSAOUI
Président du CFCM
Archives nationales :
«N’abusons pas du secret-défense,
si justifié soit-il parfois»
TRIBUNE - Trente-et-un éminents spécialistes d’histoire contemporaine s’inquiètent d’une instruction interministérielle qui autorise l’administration à refuser l’accès à certains documents classés «secret-défense» au-delà du délai de 50 ans prévu par la loi.
Par Tribune collective
Publié dans Le Figaro le 08 mars 2021
Chacun convient, quand il n’y appelle pas, de la nécessité du secret de la défense nationale qui s’applique à protéger notre sécurité, les intérêts fondamentaux de la nation et nos libertés publiques. Et chacun peut s’astreindre à en définir les usages, à titre individuel comme dans l’espace public qui nous est collectif, face à un défi majeur ou en temps de guerre.
Pourtant, des garde-fous sont nécessaires en démocratie, où l’État ne saurait penser par lui seul, loin de la société. La publication récente au Journal officiel d’une instruction générale interministérielle du 13 novembre 2020 précisant les dispositions réglementaires en matière d’accès aux archives de la nation nous le rappelle.
Profitant de la dernière révision périodique de ce texte, dont la première version date de 1952 jusqu’à l’avant-dernière en 2011, le gouvernement a cru devoir outrepasser les dispositions générales prévues par la loi sur les archives du 15 juillet 2008, qui soumettent déjà à un long délai l’accès aux archives contemporaines de la France ayant été classifiées «secret de la défense nationale».
Ce nouveau tour de vis permet à l’administration de dépasser discrétionnairement les délais légaux pour certains documents, fixés par la loi à cinquante ans, sauf exception. La situation concerne tous ceux qui, historiens, archivistes, étudiants, mais encore citoyens, à l’instar des associations et personnalités ayant déposé un recours contre l’instruction générale interministérielle devant le Conseil d’État le 15 janvier 2021 ont un droit à accéder aux archives.
L’enjeu n’est pas simplement technique, même si cette réforme désorganise profondément les services d’archives et fait dysfonctionner les Archives de France, submergées par des demandes de déclassification. Hier inexistantes pour des documents au-delà de 50 ans, à l’exception de ceux touchant la sécurité des personnes physiques, les armes de destruction massive ou le judiciaire, ces procédures de déclassification leur sont aujourd'hui imposées.
Surtout, par ce choix porté par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, la France s’expose à une régression sans précédent de l’ouverture de ses archives concernant ses activités régaliennes, remontant jusqu’à 1934 et non plus 1970 ainsi que le fixe la loi sur les archives.
Cette situation inédite est d’autant plus incompréhensible que l’élargissement de l’accès aux archives contemporaines, précisément délimité et effectivement contrôlé, répond, à l’heure du rapport Stora sur l’Algérie, à la demande des trois derniers présidents de la République et pour satisfaire aux relations
de la société française à son histoire nationale. Jugulaire, l’État aurait-il oublié, sur son chemin, toujours réglementaire, la société ?
C’est du bon usage des procédures de classification et de déclassification qu’il s’agit, «tant le secret dela défense nationale vieillit mal», disait déjà le conseiller d’État Guy Braibant avant même la loi de 2008.
Précisément, l’équilibre entre la loi, en son esprit, et les effets pratiques
de la réglementation sur l’accès des archives, est rompu. Nous sommes parvenus à l’instant où les inconvénients particuliers l’emportent désormais sur l’intérêt général.
Entre Courteline et Kafka.
Doit-on maintenir dans le secret de la défense nationale les discussions des accords de Munich de 1938 ou des plans stratégiques de 1940, des conflits contemporains postérieurs à 1945 ou de la diplomatie française des trois dernières Républiques ? Comme par un effet de prolifération du secret à une matière historique variée se trouve paradoxalement affectée l’histoire des institutions publiques, de l’énergie, des relations internationales de la France, de la technologie et de la science même : pourra-t-on travailler sur l’histoire de la police, donc du nécessaire antiterrorisme, ou sur l’énergie nucléaire civile alors que son avenir est actuellement en jeu ?
Dans toutes les grandes démocraties du monde, chacun comprend que le secret, y compris celui de la défense doit s’interrompre à un terme historique échu. La France ne peut dès lors se singulariser et doiy chercher des convergences avec nos alliés qui conservent eux aussi des archives de leurs relations extérieures et de défense.
Sans revenir sur les dispositions concernant les documents relatifs aux armes de destruction massive, ce qui fait débat, aujourd’hui et demain, est la définition du nécessaire secret de la défense nationale s’appliquant aux archives françaises : or, il s’agit bien de le délimiter sans provoquer de disproportion, de déséquilibre ou d’inconvénient pratique.
Le domaine précis de son application se trouve posé, d’abord par le législateur et non par l’administration, tentée de classifier à tout-va des documents qui n’ont parfois que peu ou plus à voir avec les intérêts fondamentaux de la nation. Il n’est pas simple de trancher entre ce qui est secret, très secret et ce qui ne l’est pas ou plus. Il existe une liberté d’accès aux archives, rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 2017.
Aux termes de l’article 34 de la Constitution, son organisation relève de la loi ; aussi est-il périlleux pour nos libertés publiques de vouloir la restreindre par le seul confort juridique d’une instruction générale interministérielle.
Liste des signataires :
Éric Anceau, maître de conférences à Sorbonne Université ;
Laurence Badel, professeur à l’Université Paris-I- Panthéon-Sorbonne ;
Olivier Dard, professeur à Sorbonne Université ;
Alain Duhamel, de l’Institut ;
Olivier Forcade, professeur à Sorbonne Université ;
Jacques Frémeaux, professeur émérite à Sorbonne Université ;
Jean Garrigues, professeur à l’Université d’Orléans ;
Pascal Griset, professeur à Sorbonne Université ;
Jean-Charles Jauffret, professeur émérite à l’IEP d’Aix- en-Provence ;
Jean-Noël Jeanneney, professeur émérite à l’IEP de Paris, ancien ministre ;
Pierre Journoud, professeur à l’Université Paul-Valéry- Montpellier-III ;
Henry Laurens, professeur au Collège de France ;
Sébastien-Yves Laurent, professeur à l’Université de Bordeaux ;
Roseline Letteron, professeur à Sorbonne Université ;
Philippe Levillain, de l’Institut ;
Christine Manigand, professeur à l’Université Paris-III- Sorbonne nouvelle ;
Hélène Miard- Delacroix, professeur à Sorbonne Université ;
Pierre Nora, de l’Académie Française ;
Mona Ozouf, directrice de recherche émérite au CNRS ;
Jenny Raflik, professeur à l’Université de Nantes ;
Jean-Pierre Rioux, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale ;
Eric Roussel, de l’Institut ;
Jean- François Sirinelli, professeur émérite à l’IEP de Paris ;
Georges-Henri Soutou, de l’Institut ;
Frédéric Turpin, professeur à l’Université de Savoie ;
Maurice Vaïsse, professeur émérite à l’IEP de Paris ;
Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris-I- Panthéon-Sorbonne
Fabrice Virgili, directeur de recherche au CNRS ;
Laurent Warlouzet, professeur la Sorbonne Université ;
Bertrand Warusfel, professeur à l’Université Paris-VIII ;
Michel Winock, professeur émérite à l’IEP de Paris.
_______________________________
Palais de l’Élysée, le mardi 9 mars 2021
Communiqué
Il revient à l’État d’articuler de manière équilibrée la liberté d’accès aux archives et la juste protection des intérêts supérieurs de la Nation par le secret de la Défense nationale.
Décidé à favoriser le respect de la vérité historique, le Président de la République a entendu les demandes de la communauté universitaire pour que soit facilité l’accès aux archives classifiées de plus de cinquante ans.
Le chef de l’État a ainsi pris la décision de permettre aux services d’archives de procéder dès demain aux déclassifications des documents couverts par le secret de la Défense nationale selon le procédé dit «de démarquage au carton» jusqu’aux dossiers de l’année 1970 incluse. Cette décision sera de nature à écourter sensiblement les délais d’attente liés à la procédure de déclassification, s’agissant notamment des documents relatifs à la guerre d’Algérie.
En complément de cette mesure pratique, le gouvernement a engagé, sur la demande du Président de la République, un travail législatif d'ajustement du point de cohérence entre le code du patrimoine et le code pénal pour faciliter l'action des chercheurs. Il s’agit de renforcer la communicabilité des pièces, sans compromettre la sécurité et la défense nationales. L’objectif est que ce travail, entrepris par et avec les experts de tous les ministères concernés, aboutisse avant l’été 2021.
SERVICE DE PRESSE ET VEILLE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
organisationpresse@elysee.fr — T. +33 (0)1 42 92 83 01
les historiens réagissent
au rapport de Benjamin Stora
analyse et pétition
Comme d’autres historiens, nous avons reçu soit directement par Benjamin Stora, soit indirectement le rapport demandé par le Président de la République, Emmanuel Macron, sur l’état des lieux concernant l’histoire et les mémoires de la guerre d’Algérie. Après l’avoir lu, nous l’avons longuement étudié et nous en avons débattu, sans doute parce que nous en attendions beaucoup. Mais au final, nous sommes restés sur notre faim.
À une première partie générale sur l’état d’esprit de ce rapport, puis aux grandes lignes d’explicitation de ce que peut être un travail de mémoire et de réconciliation entre la France et l’Algérie, succède une série de préconisations relativement décevantes. Comme si la réconciliation n’était pas à chercher avec l’Algérie mais avec les mémoires qui s’affrontent sur le seul sol français. Pourtant, la science historique n’est pas une opinion. Les historiens ne peuvent pas se satisfaire d’un rapport qui relève davantage d’un texte politique que d’une réflexion historique. Nous en voulons pour preuve le choix des interlocuteurs choisis par Benjamin Stora, et les préconisations qui ne s’adressent qu’à la France.
Effectivement l’Algérie d’aujourd’hui ou à tout le moins le gouvernement algérien semble absent du rapport sauf à deux reprises où Benjamin Stora souligne l’accord préalable des autorités algériennes ou un «reste encore à discuter». On connaît la position constante de ce gouvernement concernant les Archives, les faits d’histoire subordonnés à une version officielle, la surévaluation massive des nombres de morts, et en conséquence on comprend que les mots excuses, repentance, crime contre l’humanité et réparations financières ponctuent les discours algériens.
Pour se réconcilier, il faut être au moins deux
Il s’agit là de postures sans doute, mais qui excluent toute réconciliation.
Pour se réconcilier, il faut être au moins deux et chacun doit être capable d’avancer vers l’autre. Or, l’Algérie s’est muée depuis longtemps en statue du Commandeur avec soit les bras croisés (fermés à toute initiative), soit avec un doigt accusateur et vengeur. Jusqu’à aujourd’hui, les autorités algériennes soufflent le chaud et le froid en espérant remplacer les Accords d’Evian par un aveu de défaite morale de la France.
De son côté, la France avec le président Chirac avait tenté une réconciliation qui n’a reçu aucun véritable écho en Algérie. Et les présidents suivants ont eux aussi tenté cette réconciliation, en vain. Il était donc normal que le Président Macron essaie lui aussi. Mais à chaque fois, la repentance, l’accusation de génocide, les excuses officielles de la France, voire une réparation financière évaluée aujourd’hui par certains auteurs à 100 milliards, sont pour les gouvernements algériens un préalable avant toute discussion. Or les Autorités algériennes ne sont nullement intéressées par la conclusion, soixante ans après les Accords d’Evian, d’un traité de paix ou d’amitié. On comprend alors que la marge de manoeuvre de Benjamin Stora ait été des plus étroites.
Si l’Algérie n’est pas la destinataire officielle de ce rapport, il s’efforce de prendre en compte les points de vue divergents des groupes porteurs de mémoires coexistant sur le territoire français.
D’un côté, des Franco-Algériens influencés consciemment ou non par la politique mémorielle algérienne, et des Français de gauche qui tendent à partager leur point de vue. De l’autre, des victimes françaises de la décolonisation (Pieds-noirs, harkis, militaires de carrière et de vocation) qui se sentent très minoritaires et incompris. Entre les deux, une majorité favorable à l’indépendance de l’Algérie pour mettre fin à la guerre, qui n’a pas cessé de se renforcer depuis 1962. Benjamin Stora leur accorde-t-il la même attention ? L’impression domine à lire son rapport qu’il penche davantage vers les premiers. Mais en Algérie, le reproche contraire lui est très souvent adressé.
En réalité, Benjamin Stora propose des satisfactions mémorielles à tous les groupes porteurs de mémoires, en espérant les satisfaire sans céder à la revendication de repentance que l’Algérie présente à la France depuis un quart de siècle. Mais il le fait sans donner les raisons les plus solides à l’appui de ce refus.
Le regretté Gilbert Meynier avait rédigé en 2007 (avec Eric Savarese et Sylvie Thénault) une pétition franco-algérienne, dans laquelle il déclarait nettement : «dépasser le contentieux franco-algérien implique une décision politique, qui ne peut relever du terme religieux de ‘repentance’. Et des ‘excuses officielles’ seraient dérisoires». Il aurait fallu aller encore plus loin en récusant formellement cette revendication, récurrente depuis mai 1995, et en expliquant qu’elle est incompatible avec les clauses d’amnistie réciproque sur lesquelles étaient fondés les accords d’Evian du 18 mars 1962.
Les préconisations
La longue liste des préconisations contenues dans la conclusion du rapport, même si elle peut contenir quelques idées utiles, nous inspire une réaction d’incompréhension : elles sont pour le moins décousues et ne sont pas à même de favoriser une quelconque réconciliation, moins encore un apaisement.
Par exemple, pourquoi panthéoniser Gisèle Halimi ? Excellente avocate et pionnière de la cause féministe, s’il faut la reconnaître, ce n’est pas au titre de la défense de membres du FLN, mais de son combat pour le droit des femmes. Ne faut-il pas lui préférer William Lévy, secrétaire de la fédération SFIO d’Alger assassiné par l’OAS et dont le fils avait été assassiné peu de temps avant par le FLN ?
Pourquoi vouloir faire reconnaître Emilie Busquant (épouse de Messali Hadj) par la France ? Elle n’a pas connu la guerre d’Algérie puisqu’elle est morte en 1953. Le fait qu’elle ait «confectionné» le drapeau algérien entre 1934 et 1937 suffit-il à ce que la France lui rende hommage alors que l’Algérie ne l’a pas reconnue comme militante de la cause nationale pour l’indépendance de l’Algérie ? Il y a tant de femmes que la France devrait reconnaître : celles qui composaient les EMSI (les équipes médicales), Mademoiselle Nafissa Sid Cara, professeur de lettres, députée d’Alger et membre du gouvernement Debré jusqu’en 1962, par exemple.
Pourquoi honorer les époux Chaulet, alors qu’ils ont pris la nationalité algérienne, sont reconnus comme moudjahids et honorés par l’Algérie ? Pourquoi ne pas leur préférer les époux Vallat, elle institutrice, lui maire de Thiersville, assassinés par le FLN ? Pourquoi la France devrait-elle reconnaître l’assassinat de Maître Ali Boumendjel (reconnu lui-aussi en Algérie comme martyr) plus que d’autres commis à la même époque ? Ne revient-il pas à la France de reconnaître en premier lieu les siens avant de reconnaître ses adversaires ?
Peut-on être héros et martyr algérien et en même temps héros français ?
Peut-on être héros et martyr algérien et en même temps héros français ? Non bien évidemment. Face au Manifeste des 121 de septembre 1960 intitulé Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie, à l’initiative de Dionys Mascolo et de Maurice Blanchot, signé par Sartre et par tous ceux qui soutiennent le réseau Jeanson, un autre manifeste, le Manifeste des intellectuels français pour la résistance à l’abandon, paru en octobre 1960, dénonçait l’appui que certains Français apportent au FLN, les traitant de «professeurs de trahison». Ceux qui signèrent ce manifeste étaient plus nombreux et portaient des noms prestigieux.
Nombre d’entre eux étaient de grands résistants. Que disaient-ils ? : «Considérant que l’action de la France consiste, en fait comme en principe, à sauvegarder en Algérie les libertés - et à y protéger la totalité de la population, qu’elle soit de souche française, européenne, arabe, kabyle ou juive, contre l’installation par la terreur d’un régime de dictature, prodigue en persécutions, spoliations et vengeances de tous ordres dont le monde actuel ne nous offre ailleurs que trop d’exemples, contre l’installation par la terreur d’un régime de dictature», ils taxaient le FLN de «minorité de rebelles fanatiques, terroristes et racistes» et déniaient «aux apologistes de la désertion le droit de se poser en représentants de l’intelligence française». Soixante ans après, la proposition de Benjamin Stora d’un colloque international dédié au refus de la guerre d’Algérie est donc un choix idéologique.
Pourquoi considérer le 17 octobre 1961 comme date à commémorer officiellement ? Que les historiens étudient cette manifestation, cela va de soi. Mais nous pouvons nous étonner qu’on l’on préfère les approximations du livre du journaliste Jean-Luc Einaudi aux éléments sérieux de celui de l’historien Jean-Paul Brunet. Qu’on en fasse une commémoration «nationale», cela dépasse l’entendement à moins de donner des gages au FLN. Ou alors, dans ces conditions, comment ne pas accepter une commémoration nationale pour la fusillade du 26 mars 1962 à Alger, une autre pour le massacre du 5 juillet 1962 à Oran, et demander que nul ne porte atteinte aux plaques et stèles érigées à la mémoire de l’OAS ? Cette préconisation est donc de nature à souffler davantage sur les braises qu’à apporter un apaisement. Les mémoires engagées ne sont pas l’histoire.
Sur les Disparus, même si «la mise en place d’une commission mixte d’historiens français et algériens pour faire la lumière sur les enlèvements et assassinats d’Européens à Oran en juillet 1962, pour entendre la parole des témoins de cette tragédie» ( p. 127) est une bonne proposition, il y a néanmoins un manque de discernement historique : le rapport parle de dizaines de milliers de disparus algériens, mais omet le nombre pourtant bien connu maintenant des 1700 disparus européens, des 5 à 600 militaires français disparus, inscrits d’ailleurs sur le Mémorial du quai Branly.
Dans le même état d’esprit, si les disparus d’Oran sont évoqués, rien n’est dit sur ceux d’Alger pourtant en nombre plus important. En revanche, un travail sur la localisation des sépultures des «disparus» est à faire. Sera-t-il rendu possible par l’Algérie ? Nous en doutons. Enfin, il y a sous la direction des Archives de France (dont le Service des Archives du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le SHD) et l’ONACVG une commission qui a travaillé sur l’élaboration d’un guide sur les Disparus en Algérie qu’ils soient le fait de l’armée française, du FLN et de l’ALN. Préconiser une recherche qui existe déjà est problématique.
Concernant les ex-supplétifs et Harkis, le rapport les réduit à la portion congrue : il aurait fallu dire que même si la France les a abandonnés, c’est bien l’Algérie indépendante qui en a massacré ou laissé massacrer un trop grand nombre, en violation de clauses fondamentales des accords d’Evian.
Il faudrait donc faciliter les déplacements des harkis et de leurs enfants en Algérie, mais cela reste à «voir avec les autorités algériennes» ! On comprend le mécontentement exprimé par des représentants de harkis sur ces propositions. « Faire des quatre camps d’internement situés sur le territoire un lieu de mémoire » (p. 127) (Larzac, Saint-Maurice-l’Ardoise, Thol et Vadenay) rend hommage aux internés algériens tout en faisant de l’hébergement des réfugiés harkis, plus tard, dans les deux premiers un simple épiphénomène. Rappelons toutefois qu’existe déjà le Mémorial de Rivesaltes qui fait un excellent travail. Et d’autre part, à l’initiative d’associations de harkis ou de l’ONACVG, des plaques ont été posées sur les lieux des camps, des hameaux forestiers. Pourquoi ne pas proposer un guide de recherches sur les harkis piloté par la Direction des Archives de France ?
Une catastrophe pour la recherche
Sur les archives (p. 128), il faut dire ce qui est : leur rétrocession serait une catastrophe pour la recherche, car, d’une part, l’Algérie n’a pas les moyens humains et financiers de les accueillir (reconnu par l’archiviste algérien Fouad Soufi lors de la journée consacrée au Guide sur les Disparus du 4 décembre 2020), et d’autre part, si les gouvernements algériens ont réclamé ces archives, c’est pour que les historiens français ne puissent pas y trouver des éléments compromettant la doxa algérienne. Le maintien de la conservation et de l’accessibilité des archives doit être pour la France un impératif prioritaire par rapport aux revendications politiques de souveraineté exprimées par Abdelmadjid Chikhi.
Bien sûr, des pas ont été accomplis en France depuis 1999 par les Présidents de la République française. Quels sont les pas accomplis par les gouvernants algériens ? Une réconciliation suppose que l’on soit au moins deux et qu’on soit disposé à avancer l’un vers l’autre. Nous craignons que cela ne soit pas le cas et qu’une nouvelle fois, nous soyons aveuglés par notre désir de réconciliation. On ne peut plus considérer que la France reste encore coupable et surtout comptable de la situation de l’Algérie d’aujourd’hui.
Dans ces conditions, l’idée d’un «nouveau traité d’Alliance et de Vérités» à signer en 2022 nous paraît utopique. Au contraire, la proposition d’une commission «Vérité et réconciliation» à la française nous semble pouvoir être une très bonne idée, à condition que sa composition soit clairement définie en fonction de son programme et celui-ci clairement exposé.
Il ne peut s’agir en effet de réconcilier l’Algérie et la France (au risque de soumettre la seconde à la première), ni de réconcilier toutes les mémoires qui s’expriment sur notre sol entre elles, car leur seul point commun est leur mécontentement de ne pas être assez entendues. L’objectif d’une telle commission ne pourrait être que de faire évoluer les mémoires conflictuelles vers un dialogue constructif, et vers la reconnaissance de l’autorité de l’histoire au-dessus des mémoires.
En revanche, il convient de réaliser un travail de recherche sur les conséquences des essais nucléaires français au Sahara (p. 127), dont les premières victimes ont été des soldats français exposés en première ligne, ainsi que sur l’achèvement du déminage des frontières.
Donner à des rues, places et autres boulevards des noms de personnes issues de l’immigration et de l’outre-mer, de médecins, enseignants artistes d’origine européenne, pourquoi pas, mais lesquels ? Ceux qui sont déjà inscrits sur le monument aux Martyrs d’Alger ne peuvent pas légitimement trouver leur place en France. Pour les autres, qui ont prouvé leurs talents en Algérie ou après leur retour en métropole, il n’y a que l’embarras du choix.
Quant à «l’OFAJ» (Office franco-algérien de la jeunesse) calqué sur le modèle de l’OFAJ (Office franco-allemand de la jeunesse), cette proposition nous semble contrefactuelle et passéiste. L’OFAJ «allemand» a été créé en 1963 et il se trouvait des jeunes gens de moins de vingt ans qui avaient connu la Seconde guerre mondiale. Créé en 1970, l’OFAJ «Algérien» aurait pu marcher mais aujourd’hui, il faut être naïf pour le croire.
La «création d’une ‘collection franco-algérienne’ dans une grande maison d’édition» (p. 129) ne relève pas du rôle de l’État.
En revanche, et plus que symboliquement, pourquoi ne pas proposer aux grandes villes de France comme aux grandes villes d’Algérie une action commune qui reviendrait en Algérie à nommer une rue Albert Camus débouchant sur une place Mouloud Feraoun, et en France une rue Mouloud Feraoun qui arriverait à une place Albert Camus ?
La commémoration ne garantit pas l’apaisement
Même sur des périodes plus reculées, la commémoration ne garantit pas l’apaisement. Par exemple, Benjamin Stora propose : «La création d’une commission franco-algérienne d’historiens chargée d’établir l’historique du canon Baba Merzoug - ou «La Consulaire» - et de formuler des propositions partagées quant à son avenir, respectueuses de la charge mémorielle qu’il porte des deux côtés de la Méditerranée» (p. 130). Mais ce prudent euphémismes camoufle un enjeu de discorde majeur, puisque ce canon qui a servi à riposter aux bombardements d’Alger par les flottes françaises dans les années 1680 a également servi à pulvériser de nombreux otages attachés à sa gueule (dont le père Levacher, religieux lazariste et consul de France en 1683).
Autre exemple encore plus frappant : «La construction d’une stèle, à Amboise, montrant le portrait de l’émir Abd el-Kader, au moment du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie en 2022» (p. 126). Cette proposition qui semblait pouvoir recueillir une très large approbation a été repoussée avec indignation en Algérie par une pétition soutenue par son arrière-petit-neveu et président de la Fondation Emir Abdelkader : «Nous nous opposons à cette tentative de nouveau détournement de notre symbole et notre patrimoine par un État français dont les actions envers l’Algérie ont toujours des relents coloniaux. Nous, signataires de cette pétition, nous nous élevons de la façon la plus ferme et la plus déterminée pour dénier à cet Etat de jouer encore avec la haute figure de notre Émir. Nous demandons de la façon la plus énergique à notre propre Etat de se positionner clairement contre cette manœuvre néocoloniale et de peser de tout son poids pour refuser ce crime supplémentaire contre notre mémoire nationale».
Ce rapport n’est donc pas à même d’apporter une réconciliation des mémoires ni avec l’Algérie, ni entre les «communautés» coexistant en France. Laissons donc travailler les historiens et non les «mémoriens». Mais agissons pour que le public puisse enfin comprendre la différence entre les mémoires et l’histoire, et préférer celle-ci à celles-là. Telle nous paraît être la seule orientation réaliste, puisque les acteurs et les témoins de la guerre d’Algérie auront tous disparu d’ici vingt ou trente ans.
Conclusion
Près de quatre semaines après la remise du rapport Stora, ses conséquences commencent à apparaître. Si son accueil a été plutôt favorable en France, il l’a été beaucoup moins en Algérie. L’association des Anciens moudjahidin puis celle des enfants de Chouhada l’ont fermement condamné, et une pétition a été lancée par des députés algériens pour réclamer une nouvelle fois la criminalisation de la colonisation française.
Après que le directeur des archives nationales algériennes, Abdelmadjid Chikhi, ait réclamé à la fin décembre 2020 la restitution de presque toutes les archives emportées par la France, le porte-parole du gouvernement algérien, Ammar Belhimer, a déclaré le 8 février 2021 regretter le refus de la France de reconnaître ses «crimes coloniaux».
Selon lui, l’épais dossier de 150 pages vient camoufler la vérité historique de la colonisation et de la guerre d’Algérie, rapporte le journal algérien TSA : «le criminel fait tout pour éviter de reconnaître ses crimes. Mais cette fuite en avant ne pourra pas durer» (cité par l’AFP le 9 février et dans Courrier international du 10-2-2021).
Les dirigeants algériens qui n’ont pas cessé depuis 1995 de relancer cette revendication de repentance oublient simplement que les accords d’Evian du 18 mars 1962, qui ont - trop lentement - mis fin à la guerre, étaient fondés sur l’amnistie générale et réciproque des deux belligérants. Refuser cette amnistie pour une seule des parties en cause, c’est relancer la guerre sous la forme d’une guerre des mémoires.
Ainsi, des conclusions se dégagent nettement :
Jean-Jacques Jordi et Guy Pervillé
* Rédacteurs :
* Signataires (en cours) :
*Soutiens
Analyse du rapport de Benjamin Stora
par Jean-Jacques Jordi*
J'ai lu plusieurs fois ce rapport, sans doute parce que j'en attendais beaucoup. Et au final je suis resté sur ma faim. À une première partie générale sur l'état d'esprit de ce rapport, les grandes lignes d'explicitation de ce qu'est un travail de mémoire et de réconciliation, succède une série de préconisations relativement décevantes.
Comme si la réconciliation n'était pas à chercher avec l'Algérie mais avec les mémoires qui s'affrontent sur le seul sol français. Avouons que l'entreprise relevait plus du funambulisme que de la recherche historique. Disons-le d'emblée, la science historique n'est pas une opinion.
l'Algérie, absente du rapport
Effectivement l'Algérie d'aujourd'hui ou à tout le moins le gouvernement algérien semble absent du rapport sauf à deux reprises où Benjamin Stora souligne l'accord préalable des autorités algériennes ou un «reste encore à discuter». Concrètement, il faut être funambule car l'on connaît la position officielle du gouvernement algérien concernant les Archives, les faits d'histoire, le jonglage sur le nombre de morts, les dénis en tous points... et par la suite, on comprend que les mots excuses, repentance, réparation financière et crime contre l'humanité arrivent dans les discours algériens.
Il s'agit là de postures sans doute mais sans possibilité de réconciliation. Pour se réconcilier, il faut être au moins deux et chacun doit être capable d'avancer vers l'autre. Or, l'Algérie s'est muée depuis longtemps en statue du Commandeur avec soit les bras croisés (fermés à toute initiative), soit avec un doigt accusateur et vengeur. Aujourd'hui, le gouvernement algérien souffle le chaud et le froid en espérant rejouer les Accords d'Évian non respectés soixante années après.
De son côté, la France avec le président Chirac a tenté une réconciliation qui n'a reçu aucun véritable écho en Algérie. Et les différents présidents français ont eux-aussi tenté cette réconciliation, en vain. Il était donc normal et logique que le Président Macron essaie lui-aussi. Mais à chaque fois, la repentance, l'accusation de génocidaires, les excuses officielles de la France et une réparation financière évaluée on ne sait comment à 100 milliards sont pour les gouvernements algériens un préalable avant toute discussion (comme le Sahara lors des discussions d'Évian).
On comprend alors que la marge de manœuvre de Benjamin Stora ait été des plus étroites et que ses préconisations embrassent un champ large, de la restitution d'un canon à une panthéonisation (pourquoi le choix de Gisèle Halimi dans ce rapport concernant la réconciliation entre la France et l'Algérie, j'y reviendrai) en passant par la restitution des archives ou les échanges culturels (qui existent déjà depuis fort longtemps).
nommer cette guerre
Comme j'ai pu le voir dans les premières critiques de ce rapport, Benjamin Stora peine à nommer cette guerre qui est plus une guerre d'indépendance qu'une guerre de décolonisation, davantage une guerre en Algérie qu'une guerre d'Algérie. Et pourtant ce fut bien une guerre qui fut juridiquement admise par la Cour d'Appel de Montpellier du 20 novembre 1959, et même une guerre civile dit l'arrêt. Du coup, on comprend mieux que le mot «Événements» ait été (avant le coup diplomatique du GPRA sur l'internationalisation de la guerre en 1960) commode pour le gouvernement français comme pour ses adversaires. Pour ce dernier, les événements et les opérations de pacification sont une affaire franco-française dans laquelle l'ONU ne saurait intervenir. Pour les avocats qui défendaient les membres du FLN, il était aussi préférable que cette guerre n'en fût pas une.
manque de précisions
Ensuite le rapport reprend à son compte, omet ou n'est pas précis sur quelques points importants :
L'historien ne peut pas être d'accord avec l'opinion d'Emmanuel Alcaraz (note 1, page 19) qui dénonce les propos de ceux qui «pointent les atrocités commises des deux côtés, cherchant un équilibre qui méconnaît les causes fondamentales de la lutte contre les dénis de droits, la dépossession et la répression continue. Mais, à chaque fois, ils cherchent à mettre en avant la responsabilité du FLN et à minorer celle de la France coloniale».
Il ne s'agit pas de mettre à dos les violences commises par les deux camps mais juste reconnaître que ces violences ont existé. Je ne dis pas qu'elles se valent mais juste qu'elles ont existé. Emmnuel Alcaraz se trompe car il n'y a pas de violences excusables et d'autres inexcusables. En tout cas ce n'est pas le rôle et le travail de l'historien. Le regard critique est essentiel.
Quant aux juifs, on peut mettre dos à dos ceux engagés pour l'indépendance et ceux qui s'engagent dans l'OAS. Cependant, il y eut davantage de juifs dans l'OAS qu'il n'y en eut dans les rangs du FLN. Même si la très grande partie d'entre eux, très français, restaient bouleversés par cette guerre, les archives montrent bien que les juifs ont été des cibles du FLN dès 1956 ! Il faudra bien, à un moment donné, faire la part des discours tenus par les uns et les autres et la réalité. Ce n'est pas la vérité que doit chercher l'historien mais la véracité et cela est plus difficile.
préconisations décousues
Sur les préconisations, mon questionnement révèle une incompréhension de celles-ci qui sont pour le moins décousues et qui ne sont pas à même de favoriser une quelconque réconciliation, moins encore un apaisement.
Pourquoi Gisèle Halimi ? Au demeurant excellente avocate et pionnière de la cause féministe ? Elle est née en Tunisie et s'il faut la reconnaître, ce n'est pas au titre de l'avocature et de défenseure de membres du FLN (il y a bien d'autres avocats qui ont assumé leur mission de défendre leurs clients) mais de son combat pour le droit des femmes. De ce fait, que vient-elle faire dans ce rapport ? Ne faut-il pas lui préférer William Lévy, secrétaire de la fédération SFIO d'Alger assassiné par l'OAS et dont le fils avait été assassiné peu de temps avant par le FLN ? Et on ne serait pas en peine de trouver d'autres personnes.
Pourquoi vouloir faire reconnaître Émilie Busquant (épouse de Messali Hadj) par la France Elle n'a pas connu la guerre d'Algérie puisqu'elle est morte en 1953. Le fait qu'elle ait «confectionné» le drapeau algérien entre 1934 (Stora) et 1937 (Yahia) suffit-il à ce que la France lui rende hommage alors que l'Algérie ne l'a pas reconnue comme militante de la cause nationale pour l'indépendance de l'Algérie ?
Il y a tant de femmes que la France devrait reconnaître : celles qui composaient les EMSI (les équipes médicales), Mademoiselle Nafissa Sid Cara, professeur de lettres, députée d'Alger et membre du gouvernement Debré jusqu'en 1962, par exemple... et quid du Bachaga Boualem, du médecin Abdelkader Barakrok, de Chérif Sid Cara (frère aîné de Nafissa), député et secrétaire d'État de la République Française.
Pourquoi les époux Chaulet alors qu'ils ont pris la nationalité algérienne, sont reconnus comme moudjahids et honorés par l'Algérie (la clinique des Grands brûlés d'Alger porte leurs deux noms) ? Pourquoi ne pas leur préférer les époux Vallat, elle institutrice, lui directeur d'école assassinés par le FLN ? Ils ne sont ni colons, ni militaires et sont morts pour la France.
Pourquoi la France devrait reconnaître l'assassinat de Maître Ali Boumendjel (reconnu lui-aussi en Algérie comme martyr) plus que d'autres commis à la même époque ? Ne revient-il pas à la France de reconnaître en premier les siens avant de reconnaître ses adversaires ?
peut-on être héros et martyr algérien et héros français ?
La seule question à se poser est la suivante : peut-on être héros et martyr algérien (y avoir sa place, sa rue à Alger ou ailleurs) et héros français ? Non bien évidemment. Dans tous les pays du monde, tous ceux, Français, qui auraient pris faits et cause pour l'Algérie indépendante en aidant le FLN auraient été considérés comme traîtres. Cela n'est pas le cas en France.
Et pourtant, face au Manifeste des 121 de septembre 1960 intitulé Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, à l'initiative de Dionys Mascolo et de Maurice Blanchot (au passé d'extrême droite, antisémite et vichyste), signé par Sartre et par tous ceux qui soutiennent le réseau Jeanson, un autre manifeste, le Manifeste des intellectuels français pour la résistance à l'abandon, paru en octobre 1960, dénonce l'appui que certains Français apportent au FLN, les traitant de «professeurs de la trahison». Celles et ceux qui signent ce manifeste sont plus nombreux et portent des noms prestigieux : Jules Romains, André-François Poncet, Daniel Halévy, François Bluche, Guy Fourquin Roland Mousnier, Pierre Chaunu, Yvonne Vernière, Jacques Heurgon, Charles Picard, Antoine Blondin, Roland Dorgelès, Marie-Madeleine Fourcade, Suzanne Labin, le colonel Rémy, Pierre Grosclaude... Nombre d'entre eux sont de grands résistants.
Que dit ce Manifeste : «Considérant que l'action de la France consiste, en fait comme en principe, à sauvegarder en Algérie les libertés - et à y protéger la totalité de la population, qu'elle soit de souche française, européenne, arabe, kabyle ou juive, contre l'installation par la terreur d'un régime de dictature, prodigue en persécutions, spoliations et vengeances de tous ordres dont le monde actuel ne nous offre ailleurs que trop d'exemples».
De ce fait, la proposition d'un colloque international dédié au refus de la guerre d'Algérie est un choix idéologique et presque contrefactuel. D'un autre côté, les Intellectuels et la Guerre d'Algérie, cela s'est déjà fait...
le 17 octobre 1961
Pourquoi considérer le 17 octobre 1961 comme date officielle à commémorer ? Que les historiens étudient cette manifestation, cela va de soi. Je peux juste m'étonner qu'on l'on préfère les approximations du livre du journaliste Einaudi aux éléments sérieux de celui de l'Historien Brunet ! Qu'on en fasse une commémoration «nationale», cela dépasse l'entendement à moins de donner des gages au FLN.
Ou alors, dans ces conditions, comment ne pas accepter une commémoration nationale pour le 26 mars, une autre pour le 5 juillet, et personne ne devrait porter atteinte aux plaques et stèles érigées pour l'OAS ! Rappelons que jusqu'au 18 mars 1962 le FLN est considéré comme un mouvement terroriste par le gouvernement français ! Cette préconisation est de nature à souffler davantage sur les braises que d'apporter là-aussi un apaisement. Les mémoires ne sont pas l'histoire.
les disparus
Sur les Disparus, là-aussi, il y a un manque de discernement historique : le rapport parle de dizaines de milliers de disparus algériens (d'où ce chiffre vient-il ?) mais omet le chiffre pourtant bien connu maintenant des 1700 disparus européens, des 5 à 600 militaires français disparus, inscrits d'ailleurs sur le Mémorial du quai Branly. Dans le même état d'esprit, si les disparus d'Oran sont évoqués, rien n'est dit sur ceux d'Alger pourtant en nombre plus important ! Et, à ma connaissance, ni Raphaëlle Branche, ni Sylvie Thénaut, ni Trémor Quémeneur ne parlent des disparus européens alors que ces historiennes et historien sont cités dans le rapport sur ce sujet.
En revanche, un travail sur la localisation des sépultures des «disparus» est à faire. Sera-t-il rendu possible par l'Algérie ? J'en doute fort. Enfin, il y a sous la direction des Archives de France (dont le Service des Archives du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le SHD) et l'ONACVG une commission qui a travaillé sur l'élaboration d'un guide sur les Disparus en Algérie qu'ils soient le fait de l'armée française, du FLN et de l'ALN. Préconiser une recherche qui existe déjà est problématique.
les archives
Sur les archives, véritable serpent de mer agité par l'Algérie, il faut dire la réalité : nous savons très bien que la rétrocession des archives serait une catastrophe pour la recherche, car, d'une part, l'Algérie n'a pas les moyens humains et financiers de les accueillir (dixit Fouad Soufi lui-même lors de la journée consacrée au Guide sur les Disparus du 4 décembre 2020) et d'autre part, avouons que si les gouvernements algériens ont demandé ces archives c'est pour que les historiens français ne puissent pas y trouver des éléments compromettant la doxa algérienne.
Je trouve très étonnant que certains historiens français montent au créneau concernant l'instruction générale interministérielle 1300 (alors que nous pouvons demander des dérogations qui sont presque toujours accordées) et ne voient pas que le départ de ces mêmes archives (de souveraineté) vers l'Algérie serait une véritable catastrophe pour la recherche historique ! Françoise Durand-Evrard, qui a été la directrice des ANOM (puisque ce sont ces archives qui sont visées) l'a très clairement écrit sur sa page «Facebook . D'ailleurs, elle précise que ni Benjamin Stora, ni Abdelmajid Chikhi ne sont des conservateurs du patrimoine.
quels sont les pas accomplis par les gouvernants algériens ?
Bien sûr, des pas ont été accomplis en France depuis 1999 par leurs Présidents de la République. Quels sont les pas accomplis par les gouvernants algériens ? Une réconciliation suppose que l'on soit au moins deux et qu'on soit disposé à avancer l'un vers l'autre. Je crains que cela ne soit pas le cas et qu'une nouvelle fois, nous sommes aveuglés par notre seul désir de réconciliation. Au début des années 2000, l'Algérie demandait des dizaines de milliards d'euros, aujourd'hui c'est 100 milliards, demain, 200 milliards ? On ne peut plus considérer que la France est encore coupable et surtout comptable de la situation de l'Algérie d'aujourd'hui. Ne faut-il pas interroger les 60 années de démagogie, de dictature, de compromissions et d'enrichissements personnels des dirigeants algériens ?
La préconisation «Alliance et vérité» calquée sur le modèle sud-africain reste une belle initiative mais elle est inadéquate pour l'Algérie pour deux raisons principales : en Afrique du Sud, les européens sont restés (n'ont pas été chassés de leur terre natale) et où se trouve un Nelson Mandela en Algérie ? Et si cette «commission» Alliance et vérité existait, pourrait-on alors poser la question aux Algériens : Qu'avez-vous fait de ce que nous vous avons laissé ? Certes, la réponse de l'Algérie sera que la France a tout détruit et qu'elle doit réparer. Or, nous savons très bien pour peu que l'on soit honnête que les accusations de l'Algérie sont erronées.
Il convient aussi de réaliser un travail sur les essais nucléaires au Sahara. Nous avons les éléments en France pour le faire.
quels noms retenir pour nommer des rues ou des places ?
Donner à des rues, places et autres boulevards des noms de personnes issues de l'immigration et de l'outre-mer, de médecins, enseignants artistes d'origine européenne, pourquoi pas mais lesquels ?
Ceux qui sont déjà inscrits sur le monument aux martyrs d'Alger ne peuvent pas légitimement trouver leur place en France. Pour la France, Moïse Aboulker, José Aboulker, Roger Carcassone, quant aux médecins il n'en manque pas tout au long des XIXe et XXe siècles (les frères Sergent, les professeurs Alcantara, Bruch, Patin Trollier, Sédillot, Trollard, Texier... Mohamed Seghir Benlarbey (premier médecin «algérien» à soutenir sa thèse en 1884 en Algérie car le premier médecin fut Mohamed Nekkache en 1880 mais à la Faculté de médecine de Paris), Trabut, Lagrot, Goinard, Pelissier, Porot... le jeune docteur Jean Massonat tué le 26 mars dans la tuerie de la rue d'Isly alors qu'il portait secours à des blessés, et j'en oublie.
les harkis et supplétifs
Concernant les ex-supplétifs et Harkis, le rapport les met dans une portion congrue : il aurait fallu dire que si la France les a abandonnés, c'est bien l'Algérie indépendante qui les a massacrés ! Il faudrait donc faciliter les déplacements des harkis et de leurs enfants en Algérie mais cela reste à voir avec les autorités algériennes !
Cela n'est pas possible : il faut que la France reste sur ses positions sinon cela sera perçu comme une action à sens unique et de fait vouée à l'échec. Sans doute, la proposition de plaques sur des camps d'internement ou de regroupement est louable mais pour la Larzac et Saint-Maurice l'Ardoise, oui. Pourquoi ceux du Thol ou de Vadenay ? Rappelons toutefois qu'existe déjà le Mémorial de Rivesaltes qui fait un excellent travail. D'autre part, à l'initiative d'associations de harkis ou de l'ONACVG, des plaques ont été posées sur les lieux des camps, des hameaux forestiers. Pourquoi ne pas proposer un guide de recherches sur les harkis piloté par la Direction des Archives de France ?
remarques supplémentaires
Quant à « l'OFAJ» (Office franco-algérien de la jeunesse) calqué sur le modèle de l'OFAJ (Office franco-allemand de la jeunesse), cette proposition me semble contrefactuel et passéiste. L'OFAJ «allemand» a été créé en 1963 et il se trouvait des jeunes gens de moins de 20 ans qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale. Créé en 1970, l'OFAJ «Algérien» aurait pu marcher mais aujourd'hui, il faut être naïf pour le croire.
Une «édition franco-algérienne», cela doit être de l'ordre du privé car sinon qui déciderait qu'un livre sera publié et un autre non, et idem pour les traductions
Réactiver le projet du Musée de Montpellier abandonné il y a plusieurs années, cela n'est jamais une bonne idée car ce sera du «réchauffé».
L'idée générale que je retiens est que ce rapport (qui reprend beaucoup de choses publiées par Benjamin Stora les années précédentes) n'est pas à même d'apporter une quelconque réconciliation ni avec l'Algérie, ni avec les «communautés» étant en France, chacune portant une mémoire spécifique, pour autant que cette dernière affirmation soit vraie, ce dont je doute. Laissons donc travailler les historiens et non les «mémoriens».
Jean-Jacques Jordi
historien, docteur en histoire
spécialiste de l'histoire de l'Algérie française
Marseille-Périgueux (23-28 janvier 2021)
comment prétendre vouloir pacifier les mémoires
quand celle de l'Algérie repose sur une histoire
fondée sur le ressentiment anti-français ?
Bernard LUGAN
Pacifier les mémoires, certes, mais à condition :
1) Que cela ne soit pas une fois de plus à sens unique…Or, les principales mesures préconisées par le Rapport Stora incombent à la partie française alors que du côté algérien il est simplement demandé des vœux pieux…
2) Que la mémoire algérienne ne repose plus sur une artificielle construction idéologique car, comme l’a joliment écrit l’historien Mohammed Harbi, «L’histoire est l’enfer et le paradis des Algériens».
Enfer parce que les dirigeants algériens savent bien qu’à la différence du Maroc millénaire, l’Algérie n’a jamais existé en tant qu’Etat et qu’elle est directement passée de la colonisation turque à la colonisation française. (Voir à ce sujet mon livre ).
Paradis parce que, pour oublier cet «enfer», arc-boutés sur un nationalisme pointilleux, les dirigeants algériens vivent dans une fausse histoire «authentifiée» par une certaine intelligentsia française…dont Benjamin Stora fait précisément partie….
Voilà donc pourquoi, dans l’état actuel des choses, la «réconciliation» des mémoires est impossible.
l'Algérie et son non-dit existentiel
Voilà aussi pourquoi toutes les concessions successives, toutes les déclarations de contrition que fera la France, seront sans effet tant que l’Algérie n’aura pas réglé son propre non-dit existentiel.
Et cela, les «préconisations» du Rapport Stora sont incapables de l’obtenir, puisque, pour l’Algérie, la rente-alibi victimaire obtenue de la France, notamment par les visas, est un pilier, non seulement de sa propre histoire, mais de sa philosophie politique…
Un peu de culture historique permettant de comprendre pourquoi, il est donc singulier de devoir constater que l’historien Benjamin Stora ait fait l’impasse sur cette question qui constitue pourtant le cœur du non-dit algérien.
Au moment de l’indépendance, la priorité des nouveaux maîtres de l’Algérie fut en effet d’éviter la dislocation. Pour cela, ils plaquèrent une cohérence historique artificielle sur les différents ensembles composant le pays.
Ce volontarisme unitaire se fit à travers deux axes principaux :
1) Un nationalisme arabo-musulman niant la composante berbère du pays. Résultat, les Berbères furent certes «libérés » de la colonisation française qui avait duré 132 ans, mais pour retomber aussitôt dans une « colonisation arabo-musulmane » qu’ils subissaient depuis plus de dix siècles…
2) Le mythe de l’unité de la population levée comme un bloc contre le colonisateur français, à l’exception d’une petite minorité de « collaborateurs », les Harkis. Or, la réalité est très différente puisqu’en 1961, 250.000 Algériens servaient dans l’armée française, alors qu’à la même date, environ 60.000 avaient rejoint les rangs des indépendantistes.
Or, cette fausse histoire constitue le socle du «Système» algérien, lequel se maintient contre le peuple, appuyé sur une clientèle régimiste achetée par les subventions et les passe-droits.
Ce même «Système» qui, à chaque fois qu’il est en difficulté intérieure, lance des attaques contre la France
N’en déplaise à Benjamin Stora, voilà qui n’autorise pas à croire à sa volonté d’apaisement mémoriel.
critique du Rapport Stora
par Jean MONNERET
Préliminaires
Avant d’analyser le rapport de Benjamin Stora et les curieuses préconisations qu’il contient, je voudrais me livrer à de brèves considérations préliminaires. Comme l’a écrit Ernest Renan : «Une nation est une âme, un principe spirituel». Cette phrase ne relève pas de la métaphysique mais de la Science Politique, au sens le plus fort du terme.
Son auteur, dont l’oeuvre peut certes être diversement appréciée, a ainsi magistralement défini le fait national. Cette phrase, il l’a complétée par deux autres qui la précisent : «Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis».
Cette définition de Renan est indépassable ; elle représente un sommet en matière d’analyse politique. La France, qui pourrait s’honorer d’avoir produit un tel historien, semble avoir renoncé à s’en inspirer aujourd’hui.
un désir de vivre ensemble de moins en moins évident
Au début des années 1980, nous vîmes s’opérer le recours à une immigration massive provenant, mais pas exclusivement, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne. Elle continue à ce jour et à un rythme soutenu. La natalité des Français autochtones étant plutôt faible, une certaine bigarrure culturelle en résulte. Ce phénomène est amplifié du fait que nombre de nouveaux venus, contrairement au passé, sont de culture musulmane.
Dès lors, «la possession en commun d’un riche legs de souvenirs» n’est plus une donnée factuelle immédiate. Si l’on ajoute que l’école française est en crise, que l’assimilation des immigrés n’est plus tenue pour nécessaire, que l’institution familiale elle-même évolue à grande vitesse, chacun comprendra que la nation française actuelle est de plus en plus diverse et de moins en moins unie. Comment s’étonner dans ces conditions si le désir de vivre ensemble exalté par Renan est de moins en moins évident voire, en certaines zones, inexistant.
Ce fut le travail des Présidents de la République successifs, depuis 40 ans, d’affronter cette situation délicate, voire dangereuse. Ils l’ont fait sans brio, sans imagination en multipliant généralement les mesurettes. Le problème de M. Macron, aujourd’hui, est d’être à la tête d’une société, divisée, hétérogène et même, à lire certains, atomisée.
On ne comprendra pas le rapport de Benjamin Stora et la considération d’Emmanuel Macron pour ce personnage sans se référer à ce contexte très trouble. Une phrase, glanée au hasard, me parait résumer la démarche du Président : «apaiser le passé pour restaurer l’unité nationale.»
Une telle démarche est parfois nécessaire. Rappelons-nous Henri IV et la difficile sortie des guerres de religion. Pour y parvenir, il fallut de grands hommes pour de grands maux. En ces circonstances, il faut des gens connaissant l’art des compromis et ayant le goût de rapprocher les êtres.
En revanche, il faut éviter de jeter du sel sur les plaies. C’est ce que fait le rapport Stora.

dans le centre d’Alger, le 12 août 2020. RYAD KRAMDI / AFP
des victimes toujours négligées.
Après avoir lu ce qui précède, certains me diront : «Hola ! Arrêtez. Vous faites erreur, le rapport Stora ne concerne pas l’immigration, ni la nation française. Il concerne les rapports franco-algériens avec comme but de réconcilier les mémoires opposées de la Guerre d’Algérie.»
Or, précisément, il n’est pas nécessaire de réfléchir longtemps pour comprendre que le Président voudrait, - ce qui explique la mission confiée à Stora -, que les rapports d’une France et d’une Algérie réconciliées servent de modèle pour toute la politique de l’immigration.
Dans son esprit, si la France et l’Algérie, pays musulman, se rapprochent, toute la société française en sera apaisée. Le fait colonial appartiendra au passé comme les traumatismes de la décolonisation et les crispations actuelles. Le passage des générations, l’œuvre du temps effaceront les conflits et les rancoeurs d’hier comme d’aujourd’hui.
Certes, tout le monde peut rêver. Aux esprits simples, tout parait simple. Or, réconcilier les mémoires conflictuelles de la Guerre d’Algérie est tout, sauf aisé.
Une des conditions pour réussir ce type d’opération, à supposer que ce soit possible, est de bien prendre en compte toutes les sensibilités, tous les vécus, toutes les souffrances. Les 60 dernières années montrent qu’en ce domaine, beaucoup, vraiment beaucoup, reste à faire. En effet, pour nombre de ceux qui s’expriment, débattent, écrivent, «colloquent» sur ce sujet, il n’existe qu’une seule catégorie de victimes : celles causées par l’activité de la Police et de l’Armée françaises.
Les harkis, les pieds-noirs enlevés et portés disparus, les massacrés du 20 août 1955 et du 5 juillet 1962, n’entrent pas dans la même catégorie. Ceux qui les ignorent délibérément, qui minimisent leur nombre, les souffrances et le désarroi de leurs familles, ne sont pas rares. C’est peu dire ; ils sont légion.
Pour toutes ces victimes si peu ou si mal considérées, la mission confiée à Stora est une blessure supplémentaire. Celui-ci, par ses écrits, ses interviews, ses prises de position diverses, n’a jamais fait preuve d’une grande sensibilité pour elles. De plus, en maintes circonstances, il a affiché des penchants peu compatibles avec sa qualité hautement revendiquée d’historien.
Il n’a pas craint d’affirmer son désaccord avec Camus concernant le terrorisme ; allant jusqu’à affirmer que «pour les Algériens musulmans, il n’y avait pas d’autre issue» (que la violence anticoloniale). Philosophie Magazine n° 06296. Hors-Série.
Lorsqu’au prix d’efforts considérables, des historiens et des chercheurs ont réussi à faire sortir de l’oubli les massacres de pieds-noirs du 5 juillet 1962 à Oran, il s’est empressé de dire qu’il ne fallait pas «instrumentaliser» cette journée.
Lorsque le film antihistorique de Bouchareb Hors-La-Loi est sorti, il en a parlé favorablement à la télévision.
Dans Les mots de la Guerre d’Algérie. Presses Universitaires du Mirail, 2005, il a affirmé, sous l’entrée Terrorisme que la pratique terroriste des Européens (allusion à un attentat commis dans la Casbah en août 1956) avait inauguré «la période du terrorisme urbain qui sera ensuite pratiqué par le FLN, surtout pendant la Bataille d’Alger.» Ceci est historiquement faux, le FLN a lancé des attentats aveugles contre les Européens, dans la capitale algérienne, dès juin 1956.
Bien sûr, d’aucuns diront qu’il a changé, que son Rapport fait droit à certaines revendications des harkis, des pieds-noirs, de ces victimes si longtemps «oubliées». Pour nous l’impression qui se dégage de son texte et des préconisations qu’il contient est assez différente.

bataille d'Alger, février 1957
erreurs d’analyse.
Nous analyserons plus loin diverses recommandations «apaisantes» du Rapport. L’une d’elles parait spécialement saugrenue autant que contre-productive. Pour que les préconisations de Benjamin Stora soient utiles, il faudrait qu’elles constituent un remède au mal qu’elles sont censées traiter. On nous permettra d’être sceptique, car son rapport repose sur des analyses fausses.
Évoquant les divergences mémorielles que la Guerre d’Algérie a suscitées dans la population française d’aujourd’hui, il en fait une description fort contestable. Certes, un conflit d’une telle envergure, qui a duré 8 ans marque à jamais ceux qui l’ont vécu. Mais, selon Stora, face à l’historicité guerrière des mémoires algériennes, il y aurait en France parmi les harkis, les pieds-noirs, une partie des anciens combattants et toutes les victimes de la décolonisation une masse de «gardiens de la mémoire» surtout soucieux de montrer «qu’ils ont eu raison dans le passé». Nous sommes là au niveau du café du commerce.
Une autre thèse de Stora, moins farfelue, est qu’il y eut en France, après l’Indépendance, un silence officiel sur la Guerre d’Algérie. Cela est relativement vrai, mais en parallèle, il n’y eut aucun silence médiatique. La télévision n’évita point les débats sur le sujet après 1968. Et que dire du cinéma ! Dans les années 1970, de nombreux films apparurent (deux de Lakhdar Hamina, un sur La Question, un d’Yves Boisset, celui de Pontecorvo). Pour l’écrivain Yves Courrière et pour les revues historiques, le conflit algérien fut un filon dûment exploité.
Chercheurs et universitaires restèrent, il est vrai, longtemps discrets. Pour Stora, le monde commence et s’arrête aux frontières de l’Université. C’est donc tout naturellement qu’il pense qu’avant les années 1990, on ne parlait pas de l’Algérie. Grâce à lui en partie - il ne l’écrit pas mais semble le penser -, le silence officiel cessa et l’Histoire reprit ses droits. Or, cette discipline «peut rassembler» alors que la «mémoire divise». La formule est de Pierre Nora.
Nous sommes là dans l’approximation. La recherche historique sur l’Algérie et la Guerre fut stimulée par deux facteurs : le début d’ouverture des archives militaires et la guerre civile en Algérie qui marquait la faillite sanglante du régime né de l’Indépendance. Beaucoup de gens comprirent alors que ce qui s’était passé trente ans avant était plus compliqué qu’ils ne l’imaginaient.
Le succès de Stora, à ce moment-là, vint de ce qu’il proclamait qu’il fallait passer de la Mémoire à l’Histoire. Son film réalisé avec Alfonsi, tombait à point nommé. Beaucoup, ne connaissant rien à l’Algérie, crurent qu’ils passaient des ténèbres à la lumière.
Pour Stora la nostalgie est une maladie. Il stigmatise dans son rapport : «L’Atlantide engloutie de l’Algérie Française, honte des combats qui ne furent pas tous honorables*, images d’une jeunesse perdue et d’une terre natale à laquelle on a été arraché» (p. 17). Ailleurs encore, il évoque une littérature de la souffrance soufflant sur les braises de l’Algérie française ?

la Bataille d’Alger, film antihistorique de Pontecorvo
En réalité, Stora ne comprend pas que pendant 60 ans, nombre des nôtres ont ardemment combattu non pas pour exalter l’Algérie Française mais pour faire reconnaître nos épreuves. Pour faire reconnaître que le conflit avait fait des victimes dans toutes les communautés. On parlait abondamment déjà, dès les années 1970 des victimes de Massu, de la Bataille d’Alger (film antihistorique de Pontecorvo, etc…). Mais qui connaissait en France les massacres d’El Halia d’août 1955, ceux d’Oran le 5 juillet 1962 ? Disons simplement que B. Stora ne contribua guère à éclairer l’opinion de ce chef.
Comme de l’autre côté de la Méditerrannée, les Algériens ont construit une mémoire antagoniste avec leur guerre de «libératio », Stora est persuadé que 60 ans après la fin des combats, les relations entre les deux pays sont complexes, difficiles, tumultueuses. Ne serait pas plutôt, les relations de nos classes dirigeantes. ? Nous, «rapatriés», avons d’excellentes relations avec nos compatriotes musulmans.
Heureusement, notre spécialiste, a la solution : l’Histoire. Entre les récits fantasmés des victimes de la décolonisation et l’imaginaire guerrier des Algériens, lui, le grand historien, va éclairer ce qui était caché et mettre à bas les mises en scène et les représentations complaisantes. Finies les mémoires parallèles et hermétiques. Finie l’empathie exigée, exclusive, à sens unique. La France, à nouveau, pourra «faire nation».
Tout cela est caricatural.
les oubliés
Une des plus grandes injustices nées de ce qui se dit ou s’écrit sur la guerre d’Algérie est l’oubli des 25 000 jeunes Français qui tombèrent dans les combats. Certes, le Quai Branly a accueilli un monument destiné à les honorer. Ceci n’est pas négligeable, mais qui pense à eux parmi ceux que concernent les questions mémorielles ?
Plus rares encore sont ceux qui se soucièrent des militaires portés disparus. C’est le mérite personnel du Général Fournier d’avoir tenu à les rechercher et à réconforter leurs familles. L’Administration, quant à elle, ignorait jusqu’à leur nombre. Le Général a consacré plusieurs années à cette tâche. Ils doivent être recherchés et leurs restes recueillis. Nous réaffirmons ici que ces morts ou portés disparus n’ont pas combattu en vain. Ils ont péri dans la lutte contre le terrorisme, donc pour la Liberté. Dans certains milieux, on est aux antipodes de tout cela. Ce sont les victimes de l’Armée française, exclusivement, qui retiennent l’attention.
Le pondéreux rapport Stora est long et fastidieux. S’y alignent d’interminables considérations sentencieuses où le simplisme le dispute à l’insignifiance. Stora semble ainsi accorder de l’importance au dépôt d’une plaque par M. Delanoë, évoquant les manifestations du 17 Octobre 1961. Nous n’oublions pas, quant à nous, que toute l’opération fut basée sur les «recherches» d’un «historien maoïste», alors que les travaux d’un authentique universitaire furent soigneusement négligés.

le travail d'un authentique universitaire, négligé par le rapport Stora
une idéologie anticoloniale aussi sommaire qu’antifrançaise
Un autre historien authentique, Mohammed Harbi pense que ne pas étudier le passé colonial ferait le lit de l’islamisme. Peut-être. Mais l’étudier n’importe comment et le faire dans un esprit victimaire est bien pire. Or, c’est exactement ce qui se passe depuis trente ans.
Une masse de films, téléfilms et documentaires s’est déversée sur nos écrans petits et grands. Une vaste majorité en était inspirée par une idéologie anticoloniale aussi sommaire qu’antifrançaise. A-t-on réfléchi aux conséquences de cette mise en accusation sans limites et uniquement à charge a pu avoir dans nos banlieues rongées par l’islamisme ? Le terreau du terrorisme s’est gorgé de ces émissions, si peu soucieuses de vérité historique.*
L’Université, longtemps discrète est entrée dans la danse. Hélas, ce fut souvent pour y nourrir d’épaisses cohortes d’anticoloniaux «désinhibés» (comprendre engagés). L’Université s’est montrée plus à la remorque des media que soucieuse de les guider ou de les rectifier.
Qui s’étonnera si après avoir passé en revue les 3 décennies écoulées, M. Stora aboutit à cette conclusion aussi surprenante qu’inattendue : «Pour un grand nombre d’historiens français, la responsabilté première du conflit se comprend par l’établissement d’un système colonial, très ferme, interdisant, pendant plus d’un siècle, la progression des droits pour les indigènes musulmans» (p. 132).
Alors là chapeau ! Ça c’est fort ; bravo l’artiste ! La guerre coloniale vient du système colonial. Il fallait y penser. On songe irrésistiblement à la vertu dormitive de l’opium chez les médecins de Molière. (Vous savez : l’opium fait dormir car il contient une vertu dormitive).
Nous terminerons par le final, comme il se doit. Stora suggère que la dépouille de Mme Gisèle Halimi soit déposée au Panthéon. Là, on atteint les hauteurs. Que Mme Halimi fut une bonne avocate, exact. Mais flanquée de de Beauvoir, elle a porté très loin la critique de l’Armée Française.
Alors que voulez-vous ? Entre la poignée de mains aux terroristes** et la Panthéonisation de leurs avocats ! À l’heure où le terrorisme est devenu un fléau planétaire ! Certains auront du mal à suivre. Porter Me Halimi au Panthéon serait un geste «fort» nous dit Stora. Si fort qu’il ébranlerait la Nation.
Pourra-t-on encore demander à des jeunes de verser leur sang pour la Patrie, si demain, tel ou tel obnubilé de l’isme en vogue, pourra les stigmatiser au nom d’une idéologie ou d’une autre, portée par les circonstances, l’opportunité du moment ou la pleutrerie.
Jean Monneret, historien
* Appartient-il à un historien revendiqué, mais qui se dit favorable à la violence anticoloniale, de juger de l’honorabilité des combats des uns et des autres ?
** Que dire de la poignée de main de Jacques Chirac aux poseurs de bombes Djamila Bouhired et Yacef Saadi lors de son voyage de 2002 en Algérie ? Là encore on imagine les effets dans les quartiers sensibles.
L'exacte vérité finira par triompher
Jean-Pierre PISTER
J'ai eu connaissance du rapport Stora dès le milieu de la semaine dernière par mon ancien étudiant, désormais professeur d’histoire du Maghreb à la Sorbonne, Pierre Vermeren, dont on connait la riche bibliographie.
Voici une partie de mon commentaire adressé à quelques correspondants dont je respecte l'anonymat par souci de discrétion.
"Benjamin Stora s’est autoproclamé scandaleusement le meilleur spécialiste de l’Algérie. Né en 1950 à Constantine, il a milité dans la mouvance trotskyste lambertiste dès son arrivée en France. Il a rejoint ensuite le PS et est devenu le favori de François Hollande.
J’ai eu l’occasion de le rencontrer à Nancy et de déjeuner avec lui par obligation professionnelle en 2007. Il a alors promis à mon épouse, née à Oran, de mentionner les massacres du 5 juillet 1962 dans ses futures publications ....nous attendons toujours !
Dans le document transmis à Macron, il recommande la commémoration de la répression anti-FLN du 17 octobre 1961 à Paris qui aurait fait 3 à 400 morts. Il s’agit là d’une "fake news" éhontée banalisée dans les années 90 par le journaliste gauchiste Daniel Mermet et le pseudo historien Einaudi sur France-Inter. Des travaux scientifiques récents, ceux de Brunet, en particulier, démontrent qu’il faudrait diviser le nombre de victime par dix. Voir à ce sujet l’article de Wikipédia. Nous sommes dans une totale affabulation historique. Le silence sur le 5 juillet n’en est que plus scandaleux. Maître Goldnadel, avocat du Cercle algerianiste , en a fait état sur C News, il y a quelques jours.
Parmi les autres propositions scandaleuses figurant dans ce rapport, le projet de transfert au Panthéon des restes de la dame Halimi, ancienne avocate des tueurs du FLN.
Ne nous laissons pas décourager et continuons de résister, c’est là un impératif absolu. Au cours de ma carrière, j’ai toujours dit la stricte vérité à mes étudiants, candidats à Normale Sup, à Sciences Pô et même à de futurs officiers quand j’ai accompli une suppléance en Prépa St-Cyr. Cela ne m’a jamais valu le moindre problème avec ma hiérarchie puisque j’ai terminé ma carrière avec une note globale particulièrement élevée et une remise de décoration.
La vérité historique est un impératif absolu qui finit toujours par triompher. Pensons aux massacres vendéens de 1793-17944 si mal traités par l’historiographie républicaine, aujourd’hui pleinement reconnus. Le grand Soljenitsyne est venu lui-même sur place, en élébrer le 200e anniversaire.
L'exacte vérité sur ce que fut l’Algérie française finira par triompher, j’en suis convaincu."
Jean-Pierre Pister
Professeur de Chaire supérieure honoraire (Khâgne-histoire, Nancy)
Membre associé-correspondant de l'Académie de Stanislas-Nancy
Jean-Pierre Lledo,
Le voyage interdit, Alger-Jérusalem,
Les Provinciales éd, 2020.
compte rendu par Roger Vétillard
Jean-Pierre Lledo est un cinéaste d’origine franco-algérienne. Dans ce livre qui a des allures de Mémoires, il nous raconte son parcours, fort singulier. Officiellement Français jusqu’à l’âge de 25 ans, même s’il dit ne s’être jamais senti Français, Algérien depuis 1973 et maintenant Israélien depuis 2011… Il faudrait peut-être dire Français de naissance, puis Algérien parce que communiste, et maintenant Israélien après l’appropriation de sa judéité, sans oublier de noter sa proximité avec la communauté des Pieds-Noirs après 2008. C’est donc l’histoire insolite d’un communiste, Algérien, marxiste, antisioniste qui devient juif, Israélien, sioniste…
Il raconte les difficultés à obtenir la nationalité algérienne qui ne lui sera octroyée qu’après 4 ans de démarches. Son père, compagnon de route du FLN pendant la guerre d’Algérie, l’a obtenue en 1963. Cependant, il a préféré terminer sa vie en France. Mais nombre de communistes et d’Européens non-musulmans, qui s’étaient engagés pour l’indépendance et qui en avaient subi les conséquences, ont quitté définitivement l’Algérie qu’ils avaient cru être leur pays au moment où on leur a refusé la nationalité algérienne, alors qu’elle a été reconnue aux harkis musulmans qui ont combattu les futurs maîtres de l’Algérie.
Né à Tlemcen en 1947, d’un père d’origine catalane et d’une mère juive
qu’il identifie comme séfarade ou parfois berbère
Le livre comporte deux grandes parties. La première, traitée en cinéaste qui remonte le temps, parle de l’Algérie, ce pays où le FLN, parti au pouvoir, est « le bras politique de l’Armée ». La seconde est consacrée à Israël, avec une période intermédiaire, où la rupture devient définitive avec le pays natal avant de se retrouver dans la famille maternelle qui vit du côté de Tel Aviv. Sa fille l’accompagne dans cette démarche, son fils ne l’accepte pas. Cette seconde partie, très imprégnée d’une intime émotion, se prête mal à une analyse objective. C’est pourquoi je limiterai mes commentaires à la première, dont le sujet m’est plus familier.
Il est possible de mettre en exergue quelques moments de cet ouvrage.
Né à Tlemcen en 1947, d’un père d’origine catalane et d’une mère juive qu’il identifie comme séfarade ou parfois berbère, il a longtemps imaginé que l’Algérie saurait être un pays multiethnique avant de comprendre que l’idéologie arabo-musulmane avait organisé le départ des non-musulmans, ce que Mohammed Harbi a qualifié de nettoyage ethnique. Cette réalité ne s’est imposée à lui qu’au bout de plusieurs décennies : en 1993, quand les islamistes du F.I.S. ont menacé sa vie et qu’il s’est réfugié en France, mais plus probablement en 2008, quand son film « Algérie, histoires à ne pas dire » fut interdit de l’autre côté de la Méditerranée parce qu’il montrait que Pieds-Noirs et Algériens pouvaient cohabiter harmonieusement avant l’indépendance.
Lui, qui se savait juif, pense avoir « passé un contrat avec l’Algérie, une sorte d’accord secret, jamais reconnu comme tel : tout sauf l’entité sioniste, car le nom même d’Israël était imprononçable… Ce que j’avais cru [dit-il] être une intransigeance personnelle, politique, de principe, n’aurait été qu’une soumission à un impératif d’autant plus catégorique que tacite ? ».
Avec l’interdiction du film « Algérie, histoires à ne pas dire », avec la censure exercée à son encontre par ceux qui avaient, tels les deux principaux journaux francophones (El Watan et le Quotidien d’Oran), alors une réputation de libéraux, il sait qu’en Algérie, il n’a plus le droit à la parole, qu’il est devenu un non-citoyen…
une Algérie multiethnique ?
En 2008, une parole de Lakhdar Kaïdi, ancien secrétaire général de le CGT en Algérie, lui ouvre les yeux : « Cette Algérie multiethnique dont nous, les communistes, avions rêvé, les dirigeants nationalistes n’ont jamais caché qu’ils n’en voulaient pas. Ils ne voulaient rien d’autre qu’une Algérie arabo-musulmane ».
C’est à cette époque qu’il mesure la gravité des massacres d’Oran, le 5 juillet 1962, grâce à la cousine Halima de la famille Bourokba (qui sera plus tard l’épouse du président Chadli), prise ce jour-là pour une Européenne, dans les rues de la ville. Pour échapper au couteau, elle a dû crier qu’elle était musulmane, réciter la fatiha (1er verset du Coran) et piétiner le corps d’un Européen qui venait d’être égorgé. Et le récit du communiste Pierre Molina, emprisonné pendant la guerre d’Algérie comme membre du FLN et qui a échappé à la mort ce 5 juillet grâce à un Algérien qui le reconnaît, lui confirme la dimension ethnique du conflit.
En Algérie, en 1989, alors que le F.I.S.[1] montait en puissance, le P.A.G.S.[2], qui regroupait les communistes et qui venait de sortir de la clandestinité, fait cause commune avec les islamistes aux élections municipales. Sadek Hadjeres, son secrétaire général, affirmait qu’il était opportun de mener campagne avec des partis qui utilisaient l’islam, « pourquoi pas un volontariat pour la propreté des villes ? ». On sait maintenant que nombre des adhérents de ce parti étaient des agents infiltrés de la Sécurité militaire.
L’URSS (et donc les partis communistes) a soutenu la naissance de l’État d’Israël et l'auteur cite à ce propos le discours d’Andreï Gromyko, son ministre des Affaires étrangères en 1948, à l’ONU. Il y aurait à propos d’Israël et de bien d’autres sujets, dont ceux concernant l’Algérie avant et après l’indépendance, beaucoup à écrire sur les revirements des Soviétiques : par exemple que les partis communistes ont soutenu le FLN pendant la guerre d’Algérie tout en sachant pertinemment que ces indépendantistes militaient pour instaurer un pouvoir arabo-islamiste, mais en s’abstenant de le faire savoir[3]…
Jean-Pierre Lledo savait-il que les communistes, engagés du côté indépendantiste pendant la guerre d’Algérie, n’ont pas été les bienvenus au sein de l’ALN, parce que instigateurs d’un athéisme ? Ainsi l’avocat Laïd Lamrani, membre du Comité central, Georges Raffini, un ancien des Brigades Internationales, le docteur Counillon ou encore Maurice Laban et Henri Maillot furent éliminés directement ou livrés à l’armée française. Et le Parti communiste ne condamna jamais l’assassinat de ses propres militants.
cécité de la gauche française
Mouloud Hamrouche, premier ministre de 1989 à 1991, est pour l'auteur le seul dirigeant algérien démocrate. Cela rejoint ce que Gilbert Meynier me disait : « Hamrouche est le seul premier ministre algérien véritablement démocrate qui possédait en plus l’envergure d’un homme d’État ». Mais les journalistes français veulent ignorer l'orientation religieuse du pouvoir algérien. À Paris, au début de l’année 1994, il rencontre René Backmann, du Nouvel Observateur, et tente de lui expliquer que « l’islamisme était bel et bien une variante du fascisme. Au-delà de son inspiration propre, coranique, il en avait toutes les caractéristiques (refus de la démocratie, vénération du chef, embrigadement, massification) et les méthodes intimidantes, brutales, cruelles et létales […] et il s’inscrivait dans un mouvement international, celui des Frères musulmans ». Backmann, surpris par cette analyse, lui demande un papier sur le sujet. Celui-ci lui fut remis, mais l'auteur n’en entendit plus parler. La cécité de la gauche française sur cette question est exemplaire d’un déni de la réalité.
Revenant sur l’histoire de la guerre d’Algérie, l’auteur confesse qu’il croyait « à la suite de son père, et croirait longtemps encore, que l’action de l’OAS était motivée par son refus de l’indépendance. […] il me faudra bien des années pour réaliser que le peuple pied-noir entendait protester contre son exclusion du processus de négociations entre le France et le GPRA, imposant celui-ci comme seul représentant du peuple algérien […] : on leur refusait l’appartenance à ce peuple algérien ». Il comprend désormais pourquoi bien des communistes européens se sont solidarisés avec l’O.A.S et que le MNA de Messali Hadj qui n’a pas été associé à l’organisation de l’indépendance, s’est heurté violemment au FLN.
Il est incontestable que les non-musulmans qui sont restés en Algérie après l’indépendance ont eu du mal à se faire accepter comme Algériens. Un souvenir parmi d’autres, évoqué par l'auteur, montre que l’inconscient est bien présent en Algérie, même chez les intellectuels : lors d’une réception, Taleb Bendiab, directeur du Centre culturel algérien à Paris, le présente à un général comme un cinéaste, « ami de l’Algérie », et non comme un cinéaste « algérien ». De même chez Louisa Ighilahriz, combattante de l’ALN qui, dans son livre Algérienne, présente Colette Grégoire, emprisonnée en même temps qu’elle, comme une « Française », alors que celle-ci a la nationalité algérienne : un non-musulman, Européen qui plus est, ne peut pas être Algérien…
Ce livre très dense parle enfin de son installation en Israël, son nouveau pays. Pour lui, être Israélien, c’est également être juif, et être juif, ce n’est pas seulement une religion, c’est aussi être sioniste, c’est-à-dire vouloir mettre fin à la dispersion du peuple juif, en le ramenant en un lieu, Sion, la colline de Jérusalem, le pays des Hébreux. C’est une culture, une histoire, et c’est, dit-il, un « mouvement de libération nationale ». Un qualificatif qui mérite d’être discuté…
Roger Vétillard
[1] Front Islamiste du Salut.
[2] Parti de l’Avant-Garde socialiste.
[3] Voir mon livre : La guerre d’Algérie, une guerre sainte ? éd. Atlantis, 2020, pp154/155.
France-Afrique des Grands Lacs :
un rapport universitaire occulte les crimes de Kagame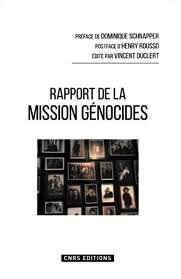
Les «omissions» du Rapport Duclert
On ne saurait parler ou aborder la question la question des génocides et des crimes de masse survenus dans le monde sans se référer aux évènements dramatiques qui ont ensanglanté l’Afrique centrale, notamment le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo (RDC), dans les années 1990 et au début des années 2000. Ces évènements ont fait l’objet de nombreux rapports des Nations Unies et d’organisations humanitaires. Si le Rapport final de Mission présidée par Vincent Duclert évoque, avec raison, le « génocide des Tutsi » au Rwanda, il reste étrangement silencieux sur les massacres ayant touché les Hutu ainsi que les Congolais.
En effet, le rapport fait une impasse totale sur les crimes qui ont touché les Hutu et les Congolais, tout en insistant seulement sur ceux ayant touché les Tutsi du Rwanda. L’expression «génocide des Tutsi» est citée 58 fois dans le rapport. Quant au mot «Hutu» qui est cité 7 fois, il renvoie soit à «extrémiste» ou à «négationniste »; et dans des très rares cas, il est employé pour faire allusion aux Hutu dits «modérés». Aucune allusion aux crimes de masse dont les populations hutu ont été victimes aussi bien au Burundi qu’au Rwanda et en RDC. À lire le rapport, on serait tenté de croire que les seules populations qui ont été victimes de génocide et de crimes de masse sont les Tutsi. Une telle lecture des évènements ne résiste ni la réalité des faits et encore moins la vérité historique...
Ce que l’on sait des génocides et des crimes de masse commis en Afrique centrale
René Lemarchand, 88 ans, est un spécialiste de l’Afrique centrale domicilié en Floride, aux États-Unis, où il a enseigné pendant plusieurs années. Il est reconnu mondialement pour ses travaux sur les cycles de violence en Afrique centrale. Pour lui, cette région du continent noir a été confrontée non pas à un génocide (celui des Tutsi) mais à plusieurs génocides. Il explique :
«Le premier génocide a eu lieu en 1972 contre les Hutu du Burundi. Ce génocide avait été commis par les Tutsi du Burundi soutenus par les exilés tutsi du Rwanda qui avaient fui leur pays suite à la Révolution sociale hutu de 1959. Ensuite, il y a eu un autre génocide contre les Hutu, cette fois-ci au Rwanda, en 1994, commis par le Front patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame. Ce génocide s’est déroulé à l’ombre du génocide des Tutsi commis par les extrémistes hutu. Puis il y a eu un autre génocide des Hutu et des Congolais en RDC, commis par la même armée de Kagame...»
Le spécialiste franco-américain, qui a publié plusieurs ouvrages et travaux sur les dynamiques de la violence en Afrique centrale, ne comprend pas pourquoi le débat s’articule uniquement autour du génocide des Tutsi, alors que d’autres populations de la région ont été tout autant touchées par les massacres de masse. À cet égard, il convient de rappeler que les crimes de masse commis contre les Hutu tant au Rwanda qu’en RDC ont été amplement documentés. On peut penser au Rapport Gersony, du nom du consultant de l’ONU, l’Américain Robert Gersony, qui avait établi, à la suite d’une enquête menée au Rwanda au lendemain du génocide, que le FPR de Paul Kagame s’était livré au massacre de plus de 30 000 Hutu dans trois préfectures du pays. Le rapport Gersony avait fait état «de meurtres systématiques et de persécutions des populations civiles hutu par l’Armée patriotique rwandaise» et de «massacres à l’aveugle des hommes, des femmes et des enfants, sans oublier les vieillards et les malades...»
À la demande des États-Unis, allié du FPR, les Nations unies avaient étouffé ce rapport au point de nier son existence. Mais un document du département d’État avait tout de même parlé de « génocide » pour décrire les atrocités relevées dans le rapport Gersony. De plus, les données publiées dans l’édition de janvier 2020 du Journal of genocide research sur le génocide survenu au Rwanda établissent que plusieurs centaines de milliers de Hutu ont été tués par le FPR.
Bien qu’il accorde une prépondérance aux crimes commis contre les Tutsi par les extrémistes hutu, le rapport d’enquête de plus de 800 pages produit conjointement par la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) et Human Rights Watch (HRW) — considéré comme un document de référence sur le génocide rwandais —, dès 1999, montre comment le FPR a massacré des milliers de Hutu au lendemain du génocide.
D’autres rapports ont décrit dans les détails les crimes de masse commis par le FPR dans la région. Il y a le Rapport Garreton qui a documenté le massacre de masse des Hutu à l’est du Congo en 1997, mais aussi et surtout le Rapport Mapping du Haut- commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) publié le 1er octobre 2010, donc il y a dix ans jour pour jour, qui a documenté les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Selon les enquêteurs du HCDH, les attaques «en apparence systématiques et généralisées» conduites par les troupes rwandaises contre les civils «révèlent plusieurs éléments accablants qui, s’ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide».
Il convient par ailleurs de souligner que le caractère génocidaire des crimes commis par le FPR contre les Hutu et les Congolais avait également été décrit par ses membres dissidents...
«Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir»
Ce que l’on sait maintenant hors de tout doute, c’est que le génocide et les crimes de masse en Afrique centrale ne se sont pas arrêtés avec la conquête de Kigali par le FPR en juillet 1994; ils se sont poursuivis après cette date au Rwanda même avant d’atteindre le Congo à partir d’octobre 1996, année de la première invasion du pays par les armées coalisées du Rwanda, du Burundi et de l’Ouganda.
Au regard de tout ce qui précède, on est donc tenté de se demander comment tous ces éléments ont pu échapper aux experts de la « Mission d’étude sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse » mise en place par le gouvernement français ? D’autant que les évènements susmentionnés ne datent pas du 18e ou 19e siècle, mais sont assez récents et ont été amplement documentés.
Comment des données relatives à des évènements si récents ont-elles pu échapper à la vigilance des gens censés être des experts dans leur domaine de recherche ? Comme me l’a confié un universitaire français ayant requis l’anonymat, «ils (les chercheurs de la Mission, du moins ceux qui sont présentés comme les spécialistes du Rwanda et/ou de l’Afrique centrale) ne pouvaient plaider l’ignorance. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir que le Mapping report existe». Pour René Lemarchand, «un tel rapport [Duclert] est un scandale». Le professeur Filip Reyntjens, spécialiste mondialement reconnu des Grands Lacs, n’en pense pas moins. «En parcourant le rapport, j’ai été surpris», relate l’universitaire belge, qui a été expert au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Selon lui, le «rapport Duclert est très contesté» parce qu’ «il ne dit rien sur les évènements de 1972 au Burundi, ne parle pas de ce qui s’est passé en RDC et des crimes de masse commis par le FPR dans la région».
Cette «omission» n’était-elle pas volontaire ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que certains « experts » du Rwanda ayant participé à la Mission sont réputés être très alignés sur les thèses du FPR, en plus d’entretenir des rapports assez étroits avec des mouvements et/ou milieux associatifs qui lui sont proches. Ces «accointances» auraient-elles impacté le travail de ces « experts » dans le traitement du volet rwandais et/ou Afrique du rapport Duclert ?
Des « experts » franchement gagnés à la doxa de Kigali
Parmi les «experts» qui ont contribué aux travaux de la Mission Duclert sur les génocides et les crimes de masse en Afrique centrale, il y a l’historien Stéphane Audoin- Rouzeau, directeur d’études à l’EHESS (CESPRA), vice-président et rapporteur de la Mission; Helene Dumas, historienne, chargée de recherche au CNRS; l’historien Marcel Kabanda, président d’IBUKA-France, association des victimes du génocide considérée comme une excroissance du FPR. Tous trois sont des membres de la Mission. Cette dernière a également entendu l’africaniste Jean-Pierre Chrétien, «qui a contribué à sensibiliser l’opinion française sur le génocide des Tutsi, en 1994», peut-on lire dans le Rapport final de la Mission.
S’il est vrai que ces universitaires ont contribué, à leur manière, à l’évolution de l’état des connaissances sur les crimes de masse survenus en Afrique centrale, notamment au Rwanda, il est aussi attesté qu’ils ont tous en commun de n’aborder la question de ces crimes que sous le prisme du «génocide des Tutsi», occultant volontairement les crimes du FPR tout en acquiesçant sans aucune distance critique à la doxa que celui-ci a imposée sur les évènements survenus dans les Grands Lacs. La plupart des spécialistes et des observateurs de l’Afrique centrale interviewés par l’auteur de ces lignes n’ont pas hésité à questionner la rigueur scientifique et la probité intellectuelle de ces quatre chercheurs.
Il faut rappeler que Stéphane Audoin-Rouzeau est un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui n’a jamais véritablement travaillé sur l’Afrique centrale. Il avait publié en 2017 un livre sur le Rwanda après un voyage dans le pays, ouvrage qualifié de «très émotionnel» par certains de ses pairs. «Il est allé au Rwanda, mais sa connaissance de l’histoire du pays est nulle», affirme René Lemarchand.
Un avis que semble partager Filip Reyntjens. Hélène Dumas, son étudiante, a publié son doctorat sur les juridictions gacaca, et comme l’a confié un universitaire français, «sa thèse doctorale est bonne, mais elle a une connaissance limitée du Rwanda qu’elle ne connaît que sous le prisme du génocide des Tutsis». Quant à Marcel Kabanda, sa proximité avec le FPR est un secret de polichinelle ; « il est le patron du réseau FPR en France », affirme l’ancien ministre des Affaires étrangères dans le premier gouvernement FPR, Jean Marie Vianney Ndagijimana. Ce dernier raconte :
«Je le connais depuis 1994. Au début des années 2000, je l’ai rencontré et lui ai demandé de travailler à la mémorialisation de toutes les victimes rwandaises du génocide. Il a refusé en me disant :» Nous c’est pour les victimes tutsi qu’on est là. Si vous voulez commémorer les victimes hutu, faites-le dans votre coin. La mémoire, ça ne concerne que les Tutsi, et non les Hutu.” J’étais tellement choqué qu’un Rwandais parle de la sorte. C’est un homme radical...»
S’agissant de Jean-Pierre Chrétien, ces travaux universitaires ont été sévèrement critiqués par certains de ses pairs, qui lui ont reproché de véhiculer les thèses du FPR sans aucune distance critique. À son sujet, René Lemarchand observe :
«Le parti pris de Jean-Pierre Chrétien dans le dossier du Rwanda est très prononcé. Nous étions des amis jusqu’à ce que je me sois aperçu que je ne pouvais plus travailler avec lui à cause de son parti pris.»
Profitant de la forte légitimité qu’ils ont acquise dans leur champ professionnel et dont ils tirent leur force d’intervention dans le champ public, les universitaires susmentionnés font la promotion, sans une once de nuance, de la version officielle du génocide écrite à l’ombre de la victoire militaire du FPR. Interrogé par l’auteur de ces lignes, l’universitaire français ayant requis l’anonymat donne son appréciation de la situation :
«C’est une toute petite partie du monde universitaire qui travaille sur les Grands Lacs en France. C’est très peu. Peut-être une dizaine de chercheurs, pas plus. Ils se connaissent tous, ils se sont recrutés les uns les autres [...] Le bocal est trop petit et ils ne peuvent pas se permettre de se marcher dessus au risque de s’étouffer. Il faut donc s’aligner sur la ligne du groupe. La vie intellectuelle française est piégée là-dessus. En France, c’est dangereux — pas physiquement bien entendu — de remettre en question la version officielle du génocide. C’est dangereux pour des carrières, pour des réputations, pour des publications... C’est vraiment risqué.»
Tout en ne se faisant pas d’illusion sur l’alignement du trio Kabanda, Audoin-Rouzeau, Dumas sur l’orthodoxie de Kigali, l’universitaire accorde tout de même le bénéfice de la bonne foi aux chercheurs et à Vincent Duclert, en faisant observer qu’ils doivent montrer patte blanche s’ils veulent retourner mener des recherches dans les archives au Rwanda — ce qui est le cas de Duclert qui est actuellement à la tête d’une commission sur le rôle de la France pendant le génocide au Rwanda :
«Il faut montrer au régime qu’on est du bon côté. Il faut donner des gages. Peut-être qu’ils ne sont pas dupes, peut-être qu’ils savent qu’ils ont affaire à des gens peu scrupuleux, mais ils jouent le jeu. »Il est vrai que le régime rwandais est très regardant sur tout ce qui s’écrit et se dit sur le Rwanda et plus particulièrement sur le génocide.
Plusieurs chercheurs, militants des droits de l’homme, humanitaires, universitaires, journalistes ou même simples observateurs se sont vu refuser l’accès au Rwanda après la publication d’articles, de travaux et/ou de rapports critiques jugés « inacceptables » par le régime de Paul Kagame. Si Kabanda, Audoin-Rouzeau et Dumas sont autorisés à mener des recherches au Rwanda sans être importunés par le régime, c’est parce que leurs travaux n’ont pas jusqu’ici bousculé la doxa et ont été jugés «acceptables» par les maîtres du pays. Et s’il l’on peut accorder le bénéfice de la bonne foi au président de la Mission, Vincent Duclert, qui a réuni ces «experts» autour de lui, il n’en demeure pas moins que ceux-ci agissent avant tout comme des militants avant d’endosser le costume de scientifiques...
L’étrange rigidité intellectuelle des «experts» dans le dossier rwandais
Pour eux, il n’y a eu au Rwanda que des crimes, pour ne pas dire un génocide, commis par les Hutu et stoppés par un Paul Kagame héroïque qui est intervenu militairement pour sauver ses congénères tutsi. Aucun point de vue dissident n’est toléré, et son auteur est voué aux gémonies, accusé de «révisionnisme», de «négationnisme» et de «banalisation du génocide des Tutsi». Des allégations utilisées régulièrement par le régime de Kigali pour anesthésier toute critique visant le FPR.
Pourtant, l’état des connaissances sur les évènements survenus dans la région des Grands Lacs a tellement évolué qu’un tel postulat ne saurait résister, même minimalement, au poids de la vérité des faits. En effet, que ce soit sur les causes profondes de la guerre déclenchée par le FPR en octobre 1990 que sur l’attentat qui a coûté la vie aux Présidents Juvénal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi — évènement constituant l’élément déclencheur du génocide au Rwanda —, en passant par la «mécanique génocidaire» qui n’a épargné aucun Rwandais avant de faire des ravages dans toute la région, l’état des connaissances actuel permet de comprendre comment les évènements se sont articulés et quel a été le rôle joué par chaque acteur. Il est établi hors de tout doute que le FPR a joué un rôle important à tous les niveaux de ces processus. Le capitaine Amadou Deme, officier de renseignement à la MINUAR (Mission des Nations Unies au Rwanda), l’avait bien décrit dans un entretien avec Robin Philpot :
«S’il y a eu conspiration, planification, c’est du côté du FPR qu’il faut chercher. Il y a eu un plan, tous les mécanismes et stratégies militaires sont là, pour la prise du pouvoir. C’était un plan mûri de A à Z, avec tous les moyens militaires nécessaires. Un plan de déstabilisation du pays, d’attentat, d’offensive militaire massive jusqu’à la prise de pouvoir.»
Deux décennies après le génocide et des millions de morts plus tard, on ne peut donc plus faire comme si l’état des connaissances sur ce drame et ses suites catastrophiques au Congo n’avait pas évolué. Même si on ne saurait prétendre tout savoir des évènements qui ont ensanglanté l’Afrique centrale, il n’en reste pas moins qu’il y a de ces faits qui sont clairement établis.
S’enfermer dans une logique dogmatique ou faire preuve de rigidité intellectuelle, comme le font Kabanda, Audoin-Rouzeau, Dumas ou même Chrétien, pour faire triompher une version des faits au détriment d’un autre ne fait pas honneur aux sciences humaines et sociales. Le prestige de l’universitaire n’en sort pas grandi. La position de ces «experts» sur le Rwanda est d’autant surprenante que même les protecteurs traditionnels du Rwanda, comme les États-Unis et la Grande- Bretagne, questionnent désormais la doxa imposée par le régime de Kigali, qui excelle dans la hiérarchisation des victimes du génocide...
L’impossible débat sur le Rwanda
La France est l’un des rares pays au monde — avec la Belgique dans une moindre mesure — où les débats et les études sur le Rwanda, notamment lorsqu’ils portent sur les crimes du FPR, virent très souvent à la « guerre civile ». Le climat est si délétère que Filip Reyntjens a confié à l’auteur de ces lignes qu’il n’entendait plus se rendre dans l’Hexagone pour participer à des activités et des débats liés au génocide rwandais. Impossible donc d’écrire et de débattre sereinement. Tout se passe comme si un petit groupe détenait les clés de la vérité, et ceux qui contestent son monopole sont victimes de lynchage et d’une censure insidieuse, qui les réduisent au silence. Comme le fait observer le sociologue Marc Le Pape dans une tribune :
«Écrire sur le Rwanda provoque parfois l’impression de traverser un champ de mines. On croit, au début, se trouver dans un champ de controverses [...] Puis, il faut bien vite constater qu’il ne s’agit pas de cela, mais de dénonciation, d’intimidation».
À défaut de fabriquer le consentement» autour des thématiques relatives au drame rwandais qui leur sont chères, la clique des universitaires — tout comme une bonne partie des médias et de militants français — fait tout pour faire taire toute voix discordante qui rejette le récit manichéen du « méchant hutu » charcutant le «gentil tutsi». Se comportant comme des agents de police de la pensée au service du FPR, ou plus généralement de la cause ethnique tutsi, ils pratiquent l’intolérance intellectuelle en toute bonne conscience et attaquent tous ceux qui osent questionner la version officielle du génocide. Leurs méthodes allient bien souvent intimidations, invectives et censure. Ces derniers mois, Stéphane Audoin-Rouzeau, Hélène Dumas ainsi que Marcel Kabanda ont signé des lettres ouvertes et fait pression pour faire annuler des évènements dans lesquels devait être abordée la question rwandaise et... donc la responsabilité du FPR dans le génocide.
Comment comprendre un tel comportement de la part des universitaires censés être les chantres de la liberté d’expression et de pensée ainsi que les promoteurs de la confrontation intellectuelle de laquelle devrait jaillir la lumière ? En quoi le fait de mettre à nu les crimes du FPR et d’exposer la stratégie d’infiltration des Interahamwe par l’ancienne rébellion tutsi, comme l’a fait la journaliste canadienne Judi Rever, relèverait-il d’une négation du «génocide des Tutsi» ? Depuis quand parler des victimes hutu reviendrait-il à nier le massacre de ces derniers ? Pourquoi exposer la part de responsabilité du FPR dans les tueries de masse en Afrique centrale équivaudrait-il à nier le «génocide des Tutsi» ? Pourquoi ramener toutes les critiques adressées au FPR à cette terrible tragédie ?
Contrairement à ce que l’on peut penser, le fondement de la démarche de ces universitaires n’est pas de contrer un quelconque révisionnisme ou négationnisme, mais d’anesthésier toute critique des politiques criminelles du FPR. Ce qui pose problème à leurs yeux, ce n’est pas tant le fait de nier ce qu’ils appellent le «génocide des Tutsi» que de mettre sur la table de l’Histoire les massacres perpétrés par le FPR contre les Hutu et les Congolais, qui, eux, n’ont jamais commis un seul crime au Rwanda.
À preuve, ils n’ont jamais manifesté la moindre sympathie à l’égard des victimes tutsi du FPR, et on peut se demander pourquoi sont-ils imperméables à la souffrance des rescapés tutsi qui croupissent sous le poids de la dictature du régime Kagame, réclamant l’aide de la communauté internationale avec l’énergie du désespoir ? Pourquoi ne se sont-ils jamais insurgés contre ce qui s’apparence à un assassinat du chanteur gospel Kizito Mihigo, survivant tutsi devenu critique du régime et retrouvé mort dans une prison de Kigali, ou même dénoncés la situation catastrophique des droits de l’homme au Rwanda ?
En adoptant la posture partiale qui est la leur, ces universitaires ne rendent pas service à l’histoire et encore moins à la science. Au regard de leurs travaux, qui accordent très peu de place aux crimes commis contre les Hutu et les Congolais par le FPR, il n’est pas surprenant que le Rapport de mission auquel ils ont contribué ait occulté ces faits. Si, comme l’a affirmé Vincent Duclert dans Jeune-Afrique, que «la recherche permet de fermer la porte au négationnisme en révélant l’entreprise de dissimulation du génocide», il n’en demeure pas moins que le rapport de Mission qu’il a présidée a brillé par le silence proprement négationniste entourant les génocides et les crimes de masse commis par le FPR à l’encontre des Hutu et des Congolais.
Patrick Mbeko
12 octobre 2020
Nota bene : contactés par l’auteur de ces lignes, Audoin-Rouzeau, Hélène Dumas ainsi que Vincent Duclert n’ont pas souhaité répondre à ses demandes répétitives d’interviews sur la question... Contactée également, la sociologue Claudine Vidal, directrice de recherche émérite au CNRS, n’a pas daigné commenter le rapport, se contentant de faire observer que « les rédacteurs du Rapport étaient moins engagés dans une recherche au sens strict du terme que dans une proposition comportant des enjeux universitaires et institutionnels, ce qui induisait effectivement des biais dans le choix des cas exposés. »
source
prochetmoyen-orient.ch /france-afrique-des-grands-lacs-un-rapport-universitaire-occulte-les-crimes-de-kagame 11 octobre 2020