Jean-Claude Picolet, Vie d’une Harka en Algérie française
Vie d’une Harka en Algérie française
un livre de Jean-Claude Picolet
Jean-Claude Picolet, officier de réserve passé par l’EMI de Cherchell, en 1960, nommé sous-lieutenant, choisit d’être affecté au 1/22ème RI, unité qui avait le privilège d’être «le régiment le plus décoré à titre posthume». Il était stationné dans la région de Gouraya, à une centaine de km à l’ouest d’Alger, à moins de 10 km de la mer
Son livre est un livre de mémoires. Mais l’auteur a pris soin de confronter ses souvenirs à ceux de ses camarades, comme lui engagés dans la guerre d’Algérie, et il a tenu à chercher confirmations et informations dans les archives du SHD (Service historique de la Défense) et dans le JMO (Journal de marche et d’opérations) du bataillon.
Cet ouvrage est riche en anecdotes et informations. Il serait difficile d’en faire une liste exhaustive. Laissons au lecteur le plaisir de les découvrir. On retient de sa lecture l’extrême engagement des harkis dans la lutte contre les indépendantistes, motivé en grande partie par l’opposition séculaire entre les Berbères (les Kabyles) et ceux appelés «Arabes», leur discipline et le respect du chef s’il est juste.
On retient encore un certain amateurisme de l’armée française avec des erreurs stratégiques, une méconnaissance des populations et de leur psychologie et un manque manifeste de moyens. Et malgré cela, les harkas ont effectué un travail remarquable pour finir par être piteusement abandonnées par ceux qui les avaient engagées dans une guerre qu’elles ont aidé à gagner militairement.
Et puis, il y a des moments souriants telle l’histoire de la petite Zohra que sa maman voulait donner au sous-lieutenant pour qu’elle ait une meilleure vie en France, en vertu d’une tradition locale que le métropolitain n’a découverte que tardivement. Des moments surprenants où un prisonnier garde les armes des appelés partis se restaurer et des instants tristes où un harki est tué dans son sommeil par une balle qui ne lui était pas destinée.
Et puis il y a ce qu’on imagine plus aisément, les patrouilles, les accrochages, les missions, les opérations avec leur cortège de surprises, d’attentes et l’incomparable connaissance du terrain de Cherifi, le pisteur. Un livre très attachant qui se lit très facilement…
Roger Vétillard
Jean-Claude Picolet, Vie d’une Harka en Algérie française, Affecté au quartier du 1/22e RI, 1960-1961, éditions Dualpha, Paris, 2017, 255 p, 29€.


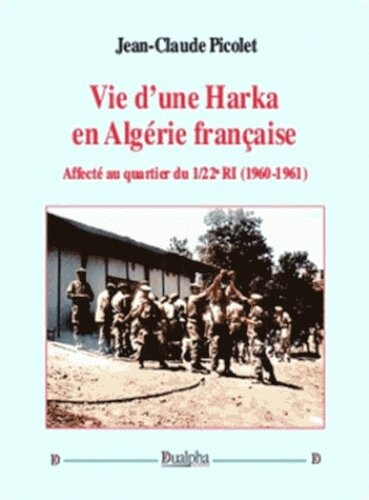
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F98%2F113362%2F7169458_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F96%2F97%2F113362%2F134487132_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F78%2F113362%2F134071052_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F88%2F19%2F113362%2F133839148_o.png)
/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)