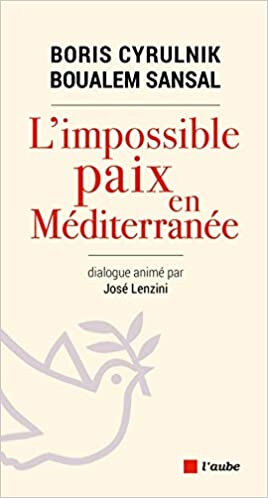
tribune libre
Critique de
L’impossible paix en Méditerranée
de Boualem Sansal et Boris Cyrulnik
par Lounis Agggoun
_______________
Nous publions ce long et très argumenté texte article de Lounis Aggoun. C’est donc que nous le jugeons digne de figurer sur ce site. Nous ne sommes pas forcément d’accord avec tout. Mais, comme il est coutume de dire, la responsabilité des propos relève de l’auteur. Et les éventuels droits de réponses seront accueillis comme il se doit.
Études Coloniales
petite leçon de Grande Histoire
pour «intellectuels de la foutaise»
Lounis Aggoun
Kul lqern yurja lehna
Waqil abrid-is yenneḍ…
Tout le siècle attend la paix.
Son chemin semble escarpé.
Lounis Aït-Menguellat
Yemma hezmi-li serwali
Ch’hal seïba rrejlia
Maman, serre-moi la ceintured’être un homme me semble si dur.
Salah Sadaoui
«Je préférerais mille fois une domination de Juifs à celle que nous impose le régime algérien»
Imam islamiste,Diar el-Kef,
lors des inondations à Bal el-Oued en 2003.

Lounis Aït Menguellet
Il y a dans cette citation d’Aït-Menguellat plus de profondeur de vue qu’on cherchera en vain dans l’ouvrage, écrit à quatre mains par le tandem Boualem Sansal-Boris Cyrulnik, accouché au forceps par José Lenzini, directeur de collection des éditions de l’Aube.
Le bébé, né d’un accouplement contre-nature, est un objet difforme. Il est, sur un sujet aussi couru que la guerre et la paix, difficile de produire pensées plus arides. Mais, comme dans le chef-d’œuvre de Rachid Mimouni le monstrueux Tombeza profite d’un destin radieux dans un pays ravagé par ses élites, Sansal et Cyrulnik sont des penseurs indiscutés dans un monde qui marche sur la tête. L’on pourrait, à l’adresse de Sansal et de ses mandants, rajouter une autre citation du même chanteur kabyle : tenγid tamurt gi nemlal : «Tu as tué la terre qui nous a réunis.»
La Méditerranée est vaste. L’Algérie pourrait y occuper une place de choix ; elle y fait, au grand malheur de son peuple, œuvre empoisonnée. Ce ne sont pas les auteurs du cru qui manquent pour inspirer un écrivain ou un journaliste désireux de bien dire, de bien penser, pour bien agir : des artistes, des savants, des hommes de grand talent et d’une probité insoupçonnable ; des intellectuels vrais, dont l’œuvre devrait inciter Sansal et ses semblables à une grande humilité. Mouloud Mammeri, Kateb Yacine, Mouloud Feraoun ont éclos et gardé leur tête haute dans les terribles temps coloniaux. C’est dire que la colonisation a eu, dans ce domaine au moins, plus «d’aspects positifs» que la période postérieure, à laquelle on se réfère un peu hâtivement comme celle de «l’Indépendance».
En matière littéraire seulement, l’Algérie française a engendré ces hommes-là, et d’autres, Jean Amrouche, Mohammed Dib, Assia Djebbar, Nabil Farès. L’Algérie algérienne a avorté de Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Kamel Daoud et Mohammed Sifaoui. Ceux en revanche, tels Djillali Lyabès, Djillali Belkhenchir, M’Hamed Boukhobza, Tahar Djaout, Mahfoud Boucebsi, Youcef Fathallah, etc., ont préféré la dignité à la servitude l’ont payé de leur vie. Un autre, Saïd Mekbel, après avoir servi par inadvertance de caution aux poussées fascistes de la junte militaire, est allé au-devant de la mort en regagnant l’authenticité du journaliste vrai[1], pour laisser à sa progéniture le souvenir d’un père digne.

Tout le reste, pourrait-on dire, n’est que littérature… Mais, comme l’Histoire, le territoire, les cultures, les richesses, etc., la littérature a été confisquée, livrée à une nuée de vautours d’autant plus féroces qu’ils sont incompétents, d’autant plus célébrés qu’ils font œuvre lamentable. Quid des citoyens ordinaires, de seconde zone en fait, qui méritent mieux que l’élite toxique qui sévit sur leur destin et sur leur image ? Les rêves même leur ont été soustraits. Soixante après, alors qu’ils abordent de nouveau pieds nus les chemins escarpés et piégés de leur liberté et de leur souveraineté, de leur renaissance peut-être, ils se retrouvent en plus mauvaise posture que ne le furent les militants des années 1940 qui conçurent de se soulever contre l’une des plus grandes puissances de la planète. Ils voudraient rêver de paix les Algériens. Boualem Sansal et Boris Cyrulnik leur assènent leur verdict, la peine capitale : L’Impossible paix en Méditerranée. Et les accusent d’être inaptes et indignes à la démocratie.
Tel est donc le titre d’un ouvrage que les compères carpe et lapin Boualem Sansal et Boris Cyrulnik ont entrepris d’infliger aux devantures des librairies. Ils auraient dû commencer par explorer l’impossible paix entre leurs propres idées. Laissons-leur le soin d’indiquer une citation phare, point d’entrée de leur réflexion tortueuse : «Georges Duby […] procédait de la même manière, en s’intéressant peu à l’histoire des batailles, des grandes familles, et beaucoup plus à l’histoire de la vie privée… Comme nous le faisons aujourd’hui en abordant, par exemple, la façon dont on lutte contre la canicule en sortant les chaises ou la manière dont on protège les personnes âgées de la déshydratation en leur distribuant de l’eau le soir. Auparavant, ces "anecdotes" ne faisaient pas l’histoire ; elles étaient considérées comme des épiphénomènes sans intérêt. Maintenant on en fait de l’histoire […].» L’Histoire serait donc tombée si bas ? Mais faut-il donner foi à cette assertion ? Que gagne Georges Duby à être mêlé bien malgré lui à cette insondable poussée pseudo-intellectuelle au cœur de l’incongru ?
D’accord sur tout,
et surtout sur son non négligeable contraire
On ne sait si ces épiphénomènes sont aujourd’hui plus capitaux que jadis ; et, le cas échant, on ignore s’il faut se réjouir que, dans un monde profondément tourmenté, l’anecdotique soit devenu matériau pour l’Histoire. L’intérêt de cette pensée de courte volée de Cyrulnik, sur la façon de lutter contre la canicule en allant prendre l’air au dehors, rebondit d’une étrange façon chez Boualem Sansal, trahissant au passage tout le mépris que celui-ci nourrit à l’égard des peuples méditerranéens qu’il s’apprête à tailler en pièces : «Cette analyse me convient parfaitement. Pour moi, la Méditerranée ne serait qu’un territoire somme toute banal, une petite mare bordée de territoires plutôt arides, où vivent les cigales et où, comme le dit joliment Boris Cyrulnik, les hommes ont la drôle d’habitude de sortir les chaises à la moindre alerte caniculaire, plutôt que les parasols. Voilà ce coin de monde à la besace pleine de magnifiques légendes ; il vit de légendes, il en produit, s’en nourrit, au point qu’il est lui-même une légende, que dis-je, il est La Légende tout entière.»
L’on pourrait commencer par proposer à nos deux compères d’apprendre à lire, avant de s’aventurer à écrire. Mais ce serait dommage de s’arrêter de façon si prématurée…

Sortir les chaises dans l’idée de Cyrulnik apparaît, après analyse syntaxico-sémantique, comme un geste salvateur, tandis que son alter ego suggère – du moment que l’alternative aurait dû être «les parasols» – un acte inconsidéré. Ils sont si bêtes, ces Méditerranées, qui en pleine canicule vont s’exposer au soleil ardent. Un dialogue de sourds donc. L’incongruité n’a pas échappé à José Lenzini ; il l’attribue avec beaucoup de bienveillance à une approche contradictoire, qui fait la «richesse» de l’échange, la complémentarité, la convergence, une certaine proximité des deux orateurs, qui traduirait en conclusion globale une vision hautement «optimiste» puisque, selon lui, le livre « est bien le témoin qu’un dialogue reste possible entre les deux rives de la Méditerranée ». Si c’est pour asséner des conclusions telles que , on eût préféré, entre les deux, une grande discorde et, du moins, de bénéficier d’un pessimiste relatif.
Les deux hommes se diront ainsi continument en phase l’un avec l’autre, en déclarant parfois l’exact contraire de ce sur quoi ils sont d’accord, comme deux envinés du petit matin bruyant sans s’écouter, tirant parti du laps de temps pendant lequel l’autre expulse un remugle de mauvaise cuisine pour improviser son propre délire éthéré… Dans quelles annales trouve-t-on pareilles mœurs suicidaires de s’exposer aux affres d’un soleil de plomb un jour de canicule ?
Puisqu’il ne reste dans ce monde d’images que le témoignage happé du passé par des caméras de plus en plus équivoques, Pagnol pourrait être une bonne source de ces scènes d’été sous l’ombre d’un arbre épais sur la place publique, pour profiter des brises rafraîchissantes que canalisent les aléas du relief. Une fable donc, à laquelle Sansal donne une épaisseur supplémentaire en offrant aux cigales le mérite de «vivre» et aux hommes l’horizon d’y mourir. Les peuples Méditerranéens seraient «La légende tout entière» ; et on sait ce qu’il faut faire des légendes : la canicule présente un bon procédé pour leur urgente crémation.
Entendons-nous tout de suite : l’ouvrage entier est un concentré de vide, quand il ne verse tout simplement pas dans le ridicule et la culture – au sens biologique – du faux ; et nous allons le monter au-delà de toute incertitude. Il est cependant, bien malgré ses auteurs, d’un apport précieux. Non qu’il nous apprenne quoi que ce soit sur le sujet qu’ils prétendent subsumer de leur esprit supposément vaporeux, mais sur ce qu’il révèle sur eux-mêmes : prétentieux, mégalomanes, médiocres, incohérents, ignorants, faussaires et, surtout, dangereux ; comme le sont tous ces médicaments tels que le Médiator qui prétendent soigner et qui empoisonnent, mutilent, tuent. Des intellectuels toxiques. Leur ouvrage en apporte la preuve indiscutable. Commençons par le plus véniel, la médiocrité.
La guerre, une norme
L’impossible paix en Méditerranée. Le titre sonne comme une condamnation, assortie d’un verdict irrévocable. La Méditerranée mérite de meilleurs auteurs, tels les Fous d’Afrique[2], en bien ou en mal, mais qui l’aiment vraiment. Ils dessinent, à l’instar de Béatrice Patrie et Emmanuel Espaňol[3], de plus réjouissantes perspectives, servies par une qualité de plume autrement plus soignée. Quant à la paix… Dans Le Bel venir de la guerre, Philippe Delmas aborde – avec profondeur – tous les sujets connexes, laissant toujours la place à l’espoir. La guerre y a la faveur des pronostics mais les portes ne sont pas définitivement fermées pour le sursaut. Pour lui, «les guerres peuvent obéir à deux logiques possibles. Les logiques de puissance, qui engendrent des conflits de souveraineté, et les logiques de sens, qui engendrent des logiques de légitimité. […] Les secondes reflètent l’impossibilité pour certaines populations de vivre ensemble ou sous une certaine autorité. La guerre du Cachemire entre l’Inde et le Pakistan, celle de Bosnie en sont des exemples[4]» récents. Il ajoute que «la guerre ne naît plus de la puissance des États mais de leur faiblesse. La première question de sécurité aujourd’hui ce ne sont pas les ambitions de puissance, c’est la panne des États.»

L’exposé est d’autant plus pertinent qu’il date de 1995, les vingt-cinq années passées depuis ont démontré toute la justesse de l’analyse et de ses projections. Il est aisé de comprendre sur ces deux registres que les peuples sont les victimes de leurs élites. De part et d’autre des lignes de démarcation, les élites conjuguent leurs efforts pour instaurer les conditions de la discorde ; puis elles expriment leur puissance aux fins d’un grand racket. Il y a matière à investigation et à engagement intellectuel. Sansal et Cyrulnik examinent des événements passés et ils en extraient une réflexion d’une vacuité sidérante, au service des racketteurs.
Si l’on fait abstraction – pour y revenir longuement plus loin – du conflit israélo-palestinien, la guerre en Méditerranée durant les quarante dernières années recense celles qu’ont menées les USA et la France contre la Libye, d’abord dans les années 1980 puis au cours de la décennie qui vient de se terminer. Il y a bien eu des escarmouches de l’armée algérienne contre le Maroc à la fin des années 1970 ; elles ont définitivement convaincu les militaires algériens de ne pas se frotter à un ennemi qui ne soit pas leur propre peuple désarmé ; ils se replieront dans l’univers glauque des barbouzeries, là où ils peuvent, en toute quiétude, poignarder dans le dos leurs citoyens esseulés.
La guerre étrange que mène au Sahel la France aujourd’hui – secondée par les USA qu’elle espère, paradoxalement, éjecter de la région pour s’adonner seule, quoique la Chine s’en mêle désormais, au pillage des ressources naturelles – mériterait d’épais ouvrages, hors des sentiers éculés d’un terrorisme islamiste érigé en force irréductible. Ce sont là des guerres d’Occidentaux davantage que de «Méditerranées» au sens entendu par Sansal et Cyrulnik. On pourrait ajouter la guerre en Syrie où des coalitions opaques rivalisent de férocité contre des civils, toujours. Il y a les guerres par procuration, où les innocents offrent leur existence comme support aux déchirements étrangers. Bref, il y a la guerre, qui unit tous les conflits, que mènent des dictatures féroces, lourdement armées par l’Occident, contre des populations innocentes, dans un jeu immonde, dans un choc de civilisations : celle des élites, où l’humanité est en passe de disparaître, contre celle, à réhabiliter, des peuples. Nous sommes loin de l’univers tel que s’apprêtent à le dépeindre les deux auteurs, une Méditerranée enracinée dans l’obscurantisme, qui éclabousse de ses fléaux moyenâgeux la paisible, la généreuse et si démocratique Europe…
Le prédicat incontournable de la guerre
La fiction envoûtante veut que l’Europe ait conjuré ses démons et que l’union politique de ses pays ait eu raison des pulsions belliqueuses de ses peuples. Rien n’est plus faux. A-t-on jamais vu un peuple souverain appeler ses dirigeants à mener une guerre contre un voisin pacifique ? La guerre ne concerne les peuples que dans la mesure où ils offrent leur chair aux canons. Ils ne s’y rendent, sinon manipulés, que contraints et forcés. Ce qui a permis de maintenir la paix en Europe et entre puissances mondiales, explique Philippe Delmas, ce n’est pas que des peuples furieux aient été soudainement saisis par la raison ; ce n’est pas davantage la conséquence pragmatique d’un marché « libre » qui exige une circulation sans entrave des marchandises. Ce qui a rendu ce petit miracle possible, c’est le spectre de l’holocauste nucléaire, la certitude que personne ne sortirait indemne d’un conflit où les belligérants disposent de suffisamment d’énergie pour anéantir mille fois toute vie sur terre ; et qu’il suffirait d’appuyer, fût-ce par inadvertance, sur un bouton pour que la mécanique s’emballe, que l’apocalypse survienne.

La capacité de destruction détenue par les USA et l’URSS était si phénoménale que les armes nucléaires s’étaient d’elles seules neutralisées. Elles étaient dès lors devenues un potentiel énorme d’accidents pour le pays détenteur[5] davantage qu’une arme à mettre en œuvre contre l’ennemi, dont la réplique eût pris l’allure d’un Armageddon. 50 missiles nucléaires suffisaient pour détruire l’intégralité de l’URSS. Les USA en détenaient 70 000, qui donnaient lieu quotidiennement à des centaines d’incidents qui frisaient l’horreur ; pour ses propres personnels bien entendu, sur le sol américain même. L’arsenal nucléaire était devenu bêtement inutilisable. La raison qui a prévalu, c’est celle «de mort assurée» pour tous si l’une ou l’autre des deux puissances s’avisait d’enclencher l’engrenage. La paix était-elle pour autant assurée ? Loin s’en fallait. La guerre, si lucrative, devait perdurer ; elle serait menée sur des territoires tiers, pour le sacrifice de peuples alternatifs. Il n’y a plus guerre mondiale, mais mondialisation de la guerre. «Toutes ces petites guerres acharnées et sans enjeu bien clair nous paraissent relever de la maladie mentale.
Que n’a-t-on dit de Saddam Hussein et de Slobodan Milosevic ! Qu’une telle répression soit possible nous semble inconcevable et ne pouvoir s’expliquer que par la pathologie de quelques fous dangereux dont le Dr. Kouchner, médecin de la grande famille humanitaire, appelle l’ablation urgente.[6]» Et ablation il y eut ; à la manière du docteur Hyde, en Serbie, en Afghanistan, en Irak, puis en Libye. L’Iran attend son tour, pour un destin que le même Dr. Hyde-Kouchner devenu ministre des Affaires étrangères, «pilier du système qu’il critique», formulera sans ambages, faisant écho à Benyamin Netanyahou : contre l’Iran, il faut en venir au « pire : la guerre ».
Mais cette ère d’une non-paix assurée par l’équilibre de la terreur est arrivée à son terme. Chine, Inde, Brésil, sortent leurs griffes après une léthargie millénaire. Les USA et la Russie ne sont plus que des géants aux pieds d’argile. Le piège de Thucydide est en train de refermer ses mâchoires, et le seul pays qui – quoique souvent à mauvais escient – assurait bon an mal an une certaine stabilité, les USA, est dirigé par un président ouvertement détraqué. «Pourquoi la guerre qui nous fut quotidienne nous serait soudain étrangère ? Parce que 10 % de l’humanité l’ont évitée pendant deux générations ? La belle affaire !

Louis XIV, 1672, guerre de Hollande
Cette même Europe dont nous promouvons le modèle pacifique est cimentée par la guerre jusqu’à la dernière pierre. Au XVIe siècle, l’Europe n’a connu que dix ans de paix, au XVIIe, quatre ans seulement, et seize au XVIIIe. De 1500 à 1800, […] l’Europe a connu deux cent soixante-dix ans de guerre, avec une nouvelle […] tous les trois ans. L’Autriche et la Suède, modèles pacifiques, ont connu, pendant ces trois siècles, une guerre tous les trois ans, l’Espagne tous les quatre ans, la Pologne et la Russie tous les cinq ans. Tout cela est trop loin peut-être. Les deux guerres mondiales, nos proches voisines, ont causé cent millions de morts dont soixante millions de civils. Les révolutions russes et chinoises en ont ajouté au bas mot cinquante millions, et nombre croissant d’historiens estiment que c’est plutôt le double.
Quant aux 146 petites guerres qui ont sévi depuis 1945, elles ont exterminé avec discrétion environs trente millions d’individus, civils pour les trois quarts, et essentiellement pour le compte des grandes puissances. Les plus lointaines de celles-ci n’ont pas d’histoire différente des nôtres : au cours des six premiers siècles, la Chine n’a connu que dix-sept années sans guerre. Au cours de son dernier siècle, entre la colonisation occidentale, l’invasion japonaise, la libération et les révolutions maoïstes successives, elle a perdu entre trente et soixante millions de morts selon les estimations.
Un étonnant article du Wall Street Journal faisait remarquer que traiter Deng Xiao Ping de "Boucher de Tien An Men" était méconnaître l’histoire. Le millier de morts innocents de 1989 est en deçà de la moyenne quotidienne qu’aura connue la Chine depuis soixante ans de vie publique du vieux dirigeant. L’article ne plaidait pas l’absolution mais la différence de regards.[7]»
Ce décompte effectué avant les guerres du Golfe et d’Afghanistan fait l’économie de quelque 4 millions de victimes de la «lutte antiterroriste». En divisant par deux pour assurer ses chiffres, cela ferait 2 millions de morts. Et au moins trois pays démolis : l’Irak, la Syrie et la Libye.
Dans tout ce décompte macabre, cette anthologie de la terreur, les peuples en général, les peuples méditerranéens du Sud plus spécialement encore, n’ont eu à connaître les affres de la guerre qu’en les subissant. Il paraît dès lors pour le moins injuste de les accabler de tares qui rendent «la paix impossible». La paix les sauverait ; la guerre qu’ils subissent les maintient depuis des siècles soumis, captifs, irresponsables de leurs devenir et des actes qu’on leur impute. De toutes les accusations que l’on peut formuler à l’encontre de celui que l’on s’apprête à pendre, il y en a une à laquelle personne, y compris son bourreau, ne songe : celle de ne pas vouloir se délivrer assez. Et c’est celle-là qu’invoque, de façon insidieuse, Sansal et Cyrulnik pour les peuples méditerranéens : leur refus de la démocratie, leur attachement à leurs chaînes.
L’exposé d’un ignare. Voilà le résumé du livre que nous allons passer au tamis ; et si ce que nous désirons récolter c’est un peu de connaissance, l’on aura beau brasser, rien ne passera au travers des mailles.
Les Ténèbres qui viennent…
Si vous voulez en revanche un ouvrage dégoulinant de prétention à l’érudition, de vanité et de fatuité intellectuelle et qui, dans les faits, est un concentré de superficialité de vue et de vacuité d’analyse, celui de Boris Cyrulnik et de Boualem Sansal vous comblera de bonheur. Le sujet n’est pas d’une grande originalité ; il est aussi vieux que la vie sur terre ; la compétition intra-spécifique, la lutte au sein d’une même espèce animale ou végétale pour s’approprier une ressource vitale rare ; chez les humains, on l’appelle la guerre : elle consiste à faire fi des manières «humaines» et de la bienséance «sociale» pour parvenir à ses fins. Ce pourrait être l’apanage des bêtes féroces, régies par la loi de la jungle ; mais c’est devenu, au pinacle de la civilisation, le modèle dominant dans le monde des hommes ; celui dans lequel se sont épanouis ces deux auteurs : la «loi du marché». À cette nuance près que la jungle est hautement mieux régulée que «le marché» conçu pour une seule espèce : les vautours…

la guerre
L’exploration des arcanes de la guerre – résurgence de l’instinct sauvage – et de la paix – contribution de l’homme à sa propre civilisation –, peut être passionnante : à condition de ne pas être révulsé par l’odeur du sang versé des innocents. Autant dire, d’autres avant eux ont abordé la question ; avec plus de profondeur. L’écriture ayant permis d’épaissir la chronique de plus de deux mille ans de mémoire belliqueuse, dans un monde où la guerre est devenue le mode d’interaction privilégié entre humains, on imagine leur travail épais, documenté et débouchant sur des perspectives éclairantes. Las. Il fait moins de 100 pages, sur une demi-largeur.
En ôtant l’introduction, les questions et les généreux espaces entre les paragraphes, il resterait de l’ouvrage une cinquantaine de pages ordinaires au grand maximum, laborieusement noircies ; redondantes puisqu’ils s’amusent l’un et l’autre à se proclamer en total concordance de vue, ce qui leur donne à chacun l’occasion de réitérer la même idée éculée énoncée par l’autre. Pour une conclusion tout en désespoir : «l’impossible paix en Méditerranée». Il est des jugements définitifs que les faits démentent très vite. Mais au moins s’attend-on à trouver les raisons qui poussent les deux auteurs à un pessimisme si terminal… Rien ! Pas la plus petite once de fait solide qu’un lecteur avisé puisse souligner, ou un autre, désireux d’apprendre, retenir. Qu’à cela ne tienne ! l’interviewer l’annonce en quatrième de couverture comme un modèle d’optimisme, comme prélude à la seule information tangible que recèle l’ouvrage : il coûte 15 euros.
N’est-ce pas cela le privilège du prince, éditeur en l’occasion, que de contraindre les faits à ses desirata ? L’optimisme du désespoir des damnés. Pour une somme rondelette : 1 € les trois pages, qui auraient – nous l’allons montrer tout à l’heure – gagné à rester blanches. L’ouvrage se termine par une annexe qui reproduit une lettre de Boualem Sansal, une sorte de complainte contre X, adressée à d’inidentifiables «amis», pour rétablir le «vrai» dans une aventure personnelle, pour justifier un voyage en Israël qu’il avait parfaitement le droit d’accomplir mais que, pour des raisons douteuses, il pensait pouvoir effectuer à l’insu des «amis» en question, et, surtout, de ses ennemis. Ce qui lui donne l’occasion de broyer du «Hamas» coupable à ses yeux d’avoir vendu la mèche ; de sacrées balances, les radicaux islamistes. Le capitalisme sauvage assassine ses consommateurs en leur faisant payer cher les poisons et autres tabacs qu’il leur fait ingurgiter ; Sansal fait mieux : il vend ses tracts. Mais au moins les auteurs sont-ils cohérents avec leur analyse ? La paix est impossible ? Soit ! Mais qu’est-ce donc la paix ?
Le bonheur des «idiots à fond la caisse»
«Je sais pas ce qu’est la paix, ne l’ayant jamais connue», glisse doucereusement Sansal. Est-il alors bien placé pour en discourir, pour la décréter impossible ? Ignorons que l’idée sous-jacente est d’attirer l’empathie du lecteur pour le malheureux et écorché Sansal qui n’a jamais connu la paix ; le poète maudit «accompagné à la fosse commune par un chien, et des fantômes», dirait Léo Ferré. Il ne sait pas ce qu’est la paix ; cela ne l’empêche pas d’en proposer une définition : « Je peux dire que je me sens en paix chaque fois que je suis en cohérence avec moi-même, chaque fois que je vois autour de moi des gens simplement aller et venir sans avoir peur d’eux-mêmes et de leurs semblables. Si ce n’est pas le bonheur, c’est du moins son image. Ce qui viendrait en plus serait du luxe, et c’est vrai que le bonheur est un luxe ; on se pâme à voir un oiseau chanter dans les arbres, des bébés gazouiller aux anges, des filles rire à gorge déployée, des garçons faire les idiots à fond la caisse, des abeilles butiner au soleil, des vieux balader leurs vieux chiens dans les jardins publics. » L’ange de Verlaine, ou bien est-ce celui d’Hugo, passe, dépité de ne pouvoir poser réclamation auprès du Commissariat des Belles lettres, et va se réfugier dans sa tombe, rassuré de se savoir dans son tombeau, plus vivant que ceux qui se repaissent de la «paix», synonyme de « bonheur » tout en «luxe» de Sansal tandis qu’ils vouent leurs congénères à la damnation éternelle.
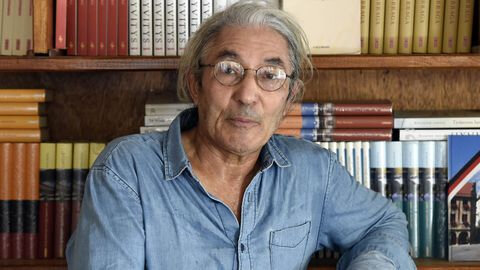
Boualem Sansal
Anticipons un peu, pour les besoins de la «littérature». Après avoir décrété la paix, qu’il assure ne pas connaître, impossible, il termine l’ouvrage – un peu en queue de poisson – par l’annonce d’un mouvement qu’il copréside avec un intellectuel – un vrai, pour le coup, au point de se taper la tête contre le mur pour comprendre ce que David Grossman a trouvé de si attrayant dans les idées de Sansal qu’il veuille partager une phrase avec lui. Une association, cela ne s’invente pas, «pour la paix».
Écoutons Sansal décrire la chose : «Notre ambition est simple : parler de la paix, écrire sur la paix, mais aussi, parce que cela va ensemble, dénoncer la guerre et ses promoteurs, et de la manière la plus claire et la plus simple possible. Je dois dire que dans ce cadre, nous avons bien mouillé la chemise, nous faisons activement notre boulot de VRP de la paix.» Convenons que, même si mal vendue, la marchandise donne énormément envie : la paix… Mais Sansal sait-il qu’il vient de présenter la quintessence même du capitalisme sauvage mal habillé de démocratie ? L’impuissance volontaire.
Les gardiens de la pensée inique
Le totalitarisme est accompli quand ceux qui ont les fonds, l’argent, les armes, le pouvoir, l’exercice de la violence légitime, s’approprient aussi la forme, les canaux médiatiques, le privilège de définir pour la collectivité ce qui est le Bien et ce qui est le Mal. Et quand on parle d’argent, d’influence, de violence, de puissance médiatique, l’on ne peut faire l’économie de penser à ceux, réels ou fantasmés, dont disposent les Juifs. Dans ce monde où des forces belliqueuses s’emploient systématiquement à placer Israël et son peuple là où partent et se croisent les tirs, l’on espérerait que, dans un ouvrage parlant de paix, l’on se simplifie la donne, pour s’épargner l’intrusion d’une problématique dont on ne sait pas trop si elle relève de millénaires ou de quelques décennies, si elle tire son essence de Dieu ou des armes, si elle relève de la justice humaniste ou de la cruauté sublimée. Bref, l’on a envie qu’on laisse un peu les Juifs tranquilles ; ils ont bien des chats à fouetter.
Dans l’ouvrage de Sansal et de Cyrulnik, cela est simplement impossible. Au point qu’on se prend, en tournant les pages, à se demander si l’imprimeur n’a pas mis une mauvaise couverture sur un mauvais livre. Car, au sortir de sa lecture, l’on est certain qu’un titre plus approprié aurait été : «J’aime les Juifs ; et Israël, c’est tellement bon !» En quoi les uns et l’autre en tirent avantage ; la question est contingente ; des auteurs plus intègres, qui cumulent leurs nombreuses qualités avec celle d’être juifs, nous permettront plus loin d’y voir bien plus clair que ce que proposent ces deux littérateurs étriqués.
Le montage paraît bancal d’emblée, l’alliage du bric avec le broc. Les deux hommes ne se connaissaient pas et leurs sujets de prédilection n’ont rien de commun. L’on pourrait leur faire la charité de dire que, pour l’un, en tant que psychiatre, les pensées intimes des hommes n’ont plus de secret ; l’autre prétend même sonder les âmes des Maghrébins, non pour exorciser un mal intrinsèque que, selon lui, ils portent en eux – un «antisémitisme viscéral» – mais pour donner à leurs ennemis des raisons de les «éradiquer». À titre d’écrivains installés, l’un et l’autre devraient savoir que les mots ont un sens ; les leurs sont une enfilade de lieux communs auxquels l’annexion de la mémoire de quelques grands hommes disparus offre un semblant de dimension. C’est le propre d’un nain que de se revendiquer de géants disparus, des géants qui, croient-ils, ne peuvent plus se défendre.
Sansal privatise Albert Camus, cet homme du peuple, qui a vécu pour le peuple. Il le dilapide, pour les besoins de sa croisade contre les innocents, les impuissants, dans une étrange quête pour sauver les conglomérats les mieux dotés de la planète… Les Blancs, les Occidentaux, les Européens, et, bien sûr, les Juifs. Imagine-t-on simplement Camus, après s’être rendu en Kabylie en 1937, commettre un livre qui signerait la perspective honteuse d’une «impossible paix avec les Kabyles» ? Qui légitimerait donc de les éradiquer ?

Passer l’ouvrage de Sansal et Cyrulnik au crible bute contre une difficulté. Il y a tant à corriger qu’il faudrait commenter chacune de leurs phrases et leur donner une réplique documentée, référencée, taillée dans le marbre de la logique et de la raison, pour démolir leur œuvre qui prend l’allure d’une coquille vide ; et c’est là le moindre de ses défauts. Mais répondre sur tout pourrait emplir un ouvrage de taille normale qui, pour accablant qu’il serait sur l’indigence intellectuelle de ces deux larrons, tomberait sous le coup de deux travers : primo, il ne trouverait aucun éditeur, pour les mêmes raisons qui font que ces deux individus en ont beaucoup ; secundo, au-delà des horizons désespérants que rencontre quiconque se donne la vérité comme objectif, on ne peut légalement citer au-delà de 10 % du texte initial. Et 10 % de quasi rien que constitue l’ouvrage pourrait ne laisser que peu de matière à se mettre sous la dent. Mais qu’on se rassure, cela fait déjà énormément… Passons à la prétention des auteurs.
Les théoriciens de la foutaise
«Quand j’écris, je m’adresse au lecteur parfait, à l’ami invisible qui comprendra tout ce que j’écris, se pâme Cyrulnik. Parfois, je me laisse aller à mettre la barre un peu trop haut ; ce n’est pas que je pense être plus performant que les autres, mais quand on suit son chemin, on finit par avoir des idées que n’ont pas eu le temps d’avoir les autres, on se coupe un peu des autres.» La prétention à l’excellence n’exonère pas de l’obligation de se faire comprendre. Tentons cependant de nous hisser vers cette exigence du lecteur admissible…

Joseph Lenzini
Sansal ne s’encombre pas davantage de «modestie» mielleuse. Lorsque José Lenzini lui demande s’il faut du «courage» pour être ce qu’il est – forcément l’incarnation de la noblesse humaine –, il se braque : «Courage ? Non, surtout pas ! Le courage est une flamme qui peut pâlir et s’éteindre et vous manquer au moment le plus crucial. C’est même une folie, une exaltation passagère.» Sous-entendu qu’il en a à revendre, mais que ce qui le meut est d’un fer plus trempé. Qu’il s’empresse de nous détailler. «Non, c’est quelque chose de plus fort, de plus vrai, c’est la vie menacée par la ruine, la haine et la souillure qui va puiser dans les profondeurs de l’âme ce qui est sa substance même : la dignité. Un jour, j’ai pris un crayon…»
L’abaissement de son pays quarante ans durant, ponctué par l’assassinat sauvage de 250 000 de ses compatriotes, a de quoi ébranler toute âme sensible, et pousser à se soulever contre «la souillure». Sansal n’a commencé à s’attaquer aux islamistes que quand les militaires les ont éradiqués, salariés, ou chassés hors du territoire ; et il ne s’est faussement démarqué des «dictateurs» que quand la nature crapuleuse du régime est devenue si patente que mêmes ses cercles intimes s’en sont démarqués. Cela fait, pour qui est né en 1949, au moins trente ans de retard à l’allumage (ayant soustrait les temps de l’adolescence où l’erreur et la lâcheté sont, à la rigueur, permises). Ce n’est qu’en 2003 qu’il démissionne d’un poste de haut fonctionnaire au sein du ministère de l’Industrie. Il a donc eu quarante ans pour réfléchir sur la qualité de son environnement et une bonne partie à un poste de si haute responsabilité que la vue de la souillure à l’œuvre n’a pas pu lui échapper. Il a donc dû serrer très fort les narines quatre décennies durant ; cela fait long pour «la dignité» écrasée.
L’on se demande alors ce qu’il s’est produit de si ruineux de l’âme en 2003 qui le conduisit à franchir le pas supra-courageux, pour culminer dans «quelque chose de plus fort, de plus vrai». On désespérera en vain qu’il nous éclaire là-dessus ; l’on ne peut s’empêcher tout même de se dire que cela intervient quatre ans après 1999. Pourquoi cette date ? Elle correspond à la parution de sa première littérature de «la ruine, de la haine et de la souillure» des siens, Le Serment des barbares, qui lui a rapporté assez gros pour se garantir les coudées franches et se chercher des milieux mieux malodorants. Quatre ans, ça laisse le temps au chaland de mordre.
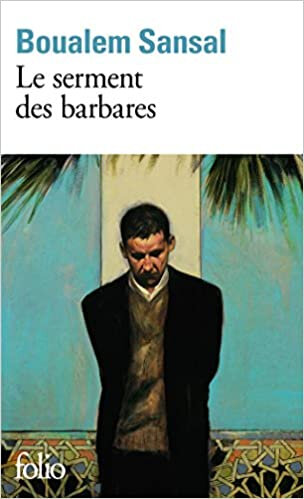
L’«épée» de la haine sans espoir de rédemption
«Je me suis mis à écrire, poursuit-il, avec un immense souci de vérité, de justesse, de précision. La littérature a été pour moi une planche de salut, une épée, une armure, une espérance, tout à la fois.» Ayant lu ses ouvrage, entendu ses discours, subi ses imprécations, l’on chercherait en vain son épée ailleurs que dans le dos des Algériens en particulier, des musulmans en général, emballés dans le qualificatif expéditif de «barbares[8]». Mais, dans ce qu’il perçoit comme un magma intouchable, une populace percluse de haine, y en avait-il qui eussent pu trouver grâce à ses yeux ?
Que pense-t-il de ceux qui, bien avant lui, ont démissionné et fui la souillure de l’âme ? Les exilés, les déracinés, qui ont pu de la sorte échapper à une mort certaine. «Émigrer est une solution, recherchée par beaucoup, les plus dynamiques sans doute, mais à laquelle je me suis toujours refusé. "Rester, c’est mourir, partir, c’est mourir deux fois", me disais-je chaque fois que je me sentais faiblir [sic] devant l’attrait et la facilité [sic] de l’ailleurs. […] Pris entre les islamistes et les dictateurs […], décidés à liquider tous ceux qui ne sont pas avec eux, il n’y a qu’une seule solution, elle s’impose dans l’urgence et la fièvre : relever la tête, résister, s’affirmer.» Une fois l’anacoluthe surmontée, l’on retrouve du Sansal tout craché, selon une déontologie méthodique : concéder cinq mots mi charitables mi sarcastiques, «les plus dynamiques sans doute», avant de déverser ses ignominies, des accusations de vénalité, de soumission, de collaboration, de défaut de personnalité, de lâcheté ou, pour reprendre un mot dont raffole la presse privée – synonyme d’appartenance à un général de connivence – et la presse officielle algériennes : de « félonie».

Pour ces intellectuels corrompus jusqu’à la moelle – en matériel et, surtout, en âme –, ceux qui sont restés en Algérie étaient bons à éradiquer ; ils déplorent seulement que les généraux n’aient pas accompli la besogne de façon plus radicale, terminale ; la faute aux «droits-de-l’hommistes» qui ont crié au scandale trop vite (après dix ans de massacres). Ceux qui ont pu échapper au meurtre à huis clos sont quant à eux des lâches, des traîtres, des fuyards. Doublement coupables, d’être Algériens et, pour les miraculés, d’avoir fui les sabres de leurs bourreaux ; mais qui n’esquiveront pas «l’épée dans la plaie» des écrivains de deux sérails, algérien et français… Bons à haïr.
À l’étranger, un peu moins exposés aux assauts des escadrons de la mort du DRS, la maison mère du terrorisme maghrébin, voilà ces exilés réduits par la littérature des intellectuels faussaires au statut de nuisance pour la France de souche. Y en a-t-il à épargner de ce peuple algérien, étranger en France et étranger en Algérie ? Pour Boualem Sansal : Ceux qui se sont toujours refusés à la souillure, tête haute, résistants, affirmatifs. Et de cette veine il n’y en a qu’un : Boualem Sansal. Mais, nous le verrons, la France qui l’a distingué élite parmi les plus hautes élites, est vite devenue étroite pour son ambition sans mesure. «Bel ami» Boualem ne se sert d’une amitié que comme tremplin à piétiner pour accéder à une amitié de niveau supérieur.
En tyrannie, le condamné subit sa sentence, mais ses juges unilatéraux lui exposent leurs griefs falsifiés. Le monde de Sansal se passe de justifications, fussent-elles fabriquées : là, il n’y a de Transcendance que Sansal et Boualem est son Exécuteur. Mais, le lecteur, qui s’est fendu de 15 euros pour toucher à cette quintessence, brûle d’envie de savoir devant qui précisément notre héros autoproclamé a relevé la tête, contre qui il a résisté, quels brimades il a subies, quelles persécutions il a endurées, auprès de qui il s’est dressé comme un lion, connaître l’identité de ses tourmenteurs ; avoir un nom à se mettre sous les synapses, de sorte que les à-plat-ventrés qu’il condamne puissent recevoir les châtiments qu’il leur inflige avec le sentiment minime de la justice unilatérale accomplie… Il préfère radoter. « Je me sens tout fier de moi quand, oubliant la modestie, je me dis que mes livres ont pu aider certains de mes compatriotes à relever la tête, à résister, à refuser la fatalité de l’échec et de la soumission. »
Sansal aurait donc permis à quelques-uns d’échapper au néant de l’âme et de l’esprit, parmi la multitude des félons potentiels… Comme nous tenons de ces livres dont il est «tout fier», nous allons pouvoir y cueillir les recettes du destin apprivoisé, pour « résister, refuser la soumission ». L’espoir est vite refroidi : «Que décide-t-on au juste dans la vie ? […] Prenons un exemple : celui du passager d’un avion. Que va-t-il faire pendant la durée du voyage ? À l’intérieur de l’avion, on peut décider de ce que l’on va faire pour passer le temps : lire, dormir, faire des mots croisés, ennuyer un voisin. Mais l’avion est entre les mains du pilote, et ce dernier comme son passager sont tous deux soumis aux mêmes aléas de la mécanique et de la météo…» Tout le monde sait : s’il est un endroit où il faut se soumettre, ne pas résister, c’est bien dans un avion où les parachutes sont rares. Existe-t-il des êtres qui, outre les hommes, dominent les mécaniques volantes ? Les volants et les voleurs d’un système abominable qui s’appelle régime algérien et dont Boualem Sansal et tant d’autres, Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, Omar Belhouchet, etc., sont les briques médiatiques élémentaires…
 Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, Omar Belhouchet
Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, Omar Belhouchet
Toutes ces considérations hautement sophistes passant par-dessus la barre posée par Cyrulnik, et, a fortiori, par-dessus nos têtes, quelque peu désappointés par l’entrée en matière en eau de boudin, nous sommes ravis d’entrer enfin dans le vif du sujet : La Paix impossible…, et donc la guerre assurée. Las ! notre intelligence sommaire ne fait toujours pas la maille. Car, partant du slogan «la paix, c’est la guerre» avancée par George Orwell (un de ces géants prostitués dans l’ouvrage), les deux auteurs ont concocté leur propre adage, plus corrosif : la guerre, c’est mieux que la paix. Car, confie Cyrulnik, «en période de paix, on souffre. […] Je pense que l’on ne peut prendre conscience de la paix et en jouir que si l’on a été en guerre, et que, de nos jours, il n’existe plus de procédure pour arrêter la guerre et faire la paix.»
Mais pourquoi arrêter la guerre et faire la paix si c’est pour souffrir de la paix ? Syllogisme pour lequel le psychiatre sans frontières trouve un exemple des plus inattendus : la Suisse, une jungle urbaine inexplorée, qui aurait connu la paix « grâce aux banques » mais qu’il promet à des lendemains tourmentés. Pourquoi ? En Suisse, répond-il, «les employés souffrent, et les banques commencent à souffrir ; donc [non souligné dans le texte], en période de paix on souffre. […] Les Suisses, ajoute-t-il, qui sont en paix sont en guerre intestine, en guerre contre eux-mêmes. Et actuellement, il y a énormément de dépression, de drogue, dans les grandes institutions internationales.» Vite ! une ONG charitable pour secourir les drogués des institutions internationales et des banques suisses…
Dans ce monde filant à toute allure sous la conduite d’un pilote livré aux même aléas que ses passagers, aider son prochain, adoucir le quotidien des autres, tout cela peut être tout de même l’ultime bonheur spirituel dans un monde de gadgets et de «mots croisés». Mais pas du tout, rétorque Cyrulnik : car «nous [sic] sommes incapables de donner sens à notre vie par le bonheur. Le seul bonheur que l’on éprouve, c’est celui de lutter contre le malheur, donc [souligné ici] il faut du malheur. […] La violence est donc [idem] une forme de socialisation.» Oubliés «les bébés qui gazouillent au anges», «les abeilles qui butinent au soleil», les filles aux mauvaises manières, les idiots déconneurs et les «vieux» que ne supportent que les «vieux chiens», qui sont les marques du «bonheur» selon Sansal ; vive le malheur ! vive la violence !
Pour faire court, disons qu’il ne reste à l’homme qu’un dernier espoir, une grâce providentielle, l’entrechat de la dernière chance, pour le salut de son âme, pour échapper au mauvais sort auquel les deux auteurs vouent le monde : se déclarer «étrange » au «nous » auquel ils appartiennent. Adopter la posture de «la rupture». Se déclarer dissident à leur monde effrayant. Inventer l’espace d’une civilisation alternative, fût-ce sur les marécages qu’ils ont abandonnés après saccage, où l’on caserait les valeurs dédaignées par ces élites méprisantes ; une civilisation qui ferait place à l’humanité, où la «paix» en impose à chacun de façon naturelle, où la socialisation ne serait pas synonyme de «violence», où le «bonheur» ne se trouve pas dans la souffrance, où le «luxe» consisterait à panser les plaies de son prochain. Et leur laisser, à eux et à leurs compagnons et commanditaires, le monopole de la barbarie à se partager entre «amis». Mais restons patients, le livre de Sansal et Cyrulnik recèle des « trésors » de matériaux écœurants à passer à la broyeuse…
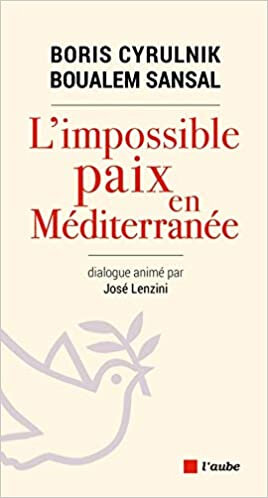
Plus que la guerre, «la paix c’est la mort…»
«La paix et le bonheur sont dans la guerre» pourrait paraître pour le commun des humains – le «nous» dont nous venons d’esquisser quelques prédicats – comme l’adage d’un psychopathe déchaîné, en proie à une poussée délirante. Si ce n’était que ça ! Sansal enchaîne en étant « d’accord avec Boris Cyrulnik» ; avant de surenchérir, citant en vrac des auteurs célèbres, exhumés de leur sommeil du juste pour être souillés ; et, histoire de placer la barre hors de « notre » portée, invoque des abstractions mathématiques de haute volée, des orées scientifiques explosives auxquelles il semble rien comprendre, et à la maîtrise desquelles il n’est nullement tenu d’apporter la moindre preuve : «Ce constat, dit-il, qui a également quelque chose d’orwellien, mais aussi de camusien, est plus que troublant, il nous amène presque à penser que la paix est le contraire de la vie, un arrêt provisoire dans un état de sidération ou, au mieux, de pauvre béatitude. […] Les mathématiques du chaos, les théories quantiques ou relativistes, nous amènent à penser la violence et la paix, et tout le reste, le temps, l’espace et l’identité, sur des plans infiniment différents du plancher des vaches qui est notre plan de vie.»
Après belles lettres barbouillées «à fond la caisse», Sansal «mouille la chemise» et devient «VRP» de la mort, «contraire de la vie», pour avoir la «paix» ; non sans prostituer au passage Orwell, Camus, Einstein, Lorentz aussi : ces grands hommes auraient selon Sansal laissé comme legs de leur passage sur «le plancher des vaches» que «la paix est le contraire de la vie» ! L’on connaissait la rhétorique des fauteurs de guerres qui prêchent auprès de leurs victimes la paix impossible dans le chaos qu’ils ont provoqué ; nous avons là le degré au-dessus de «la barre».
Un être raisonnable qui découvre cette littérature éprouve le sentiment d’une philosophie ratatouille, méli-mélo pour candidat au rattrapage de bac, qui a ingurgité à la hâte des notions éparses durant le week-end et qui les débite en vrac en espérant que l’examinateur s’y laisserait prendre. Fort heureusement, les deux hommes, sans doute soucieux de ménager des lecteurs « imparfaits », ne tirent un sujet par les cheveux que pour aller en saccager un autre, sans accorder la miséricorde de la moindre transition… Car après la prétention pour eux, le mépris pour les autres…
Sansal note que «c’est de là [de Méditerranée] que la vie est partie chercher ailleurs ce que les barbares [souligné ici] ont inventé chez eux sans en comprendre la signification profonde et sans deviner l’usage véritable qui pouvait en être fait.» Ils n’ont donc que ce qu’ils méritent, ces ignares Africains-Méditerranéens ! Leurs plaies ouvertes savent encaisser les coups d’épée ; nul tribunal n’existe qui puisse enregistrer les plaintes, ou écouter les complaintes. Sansal et ses maîtres dominent les agoras publiques où l’on se plaint et les tribunaux où l’on tranche ; et ils trouvent même le moyen de se poster comment des dissidents.
Mais il faut en convenir : Boualem a une maîtrise certaine de la redondance raciste volontaire, pour caser dans une unique phrase «barbares», leur ignorance de «la signification» et une incapacité à l’abstraction qui les empêche de «deviner» un quelconque usage «utile » à leurs «invention» ; des inventions qui n’en sont donc pas, puisque leur fonction est de promouvoir le progrès, quand les «barbares» sont inaptes à l’évolution : en effet, conclut-il, «en Méditerranée, le temps est si long qu’il en est figé, c’est dire si la modernité compte peu dans la vision des choses de l’indigène méditerranéen.» Il manquait le mot indigène» et l’incapacité congénitale à «la modernité» pour ajouter la touche de mépris qui fait le tout ; les voilà prononcés.
 "
"
"indigènes"
Dès lors, l’Afrique, ce monde méconnu, docile, malléable à souhait, se laisse féconder par l’«épée» de Cyrulnik. Il subodore que «la société [y] était facile à organiser. Cependant, remarque-t-il, j’imagine qu’on ne faisait pas trop de social ! Les gens devaient marcher avec le groupe, ramasser des champignons, des fruits et manger des petits animaux et des insectes. […] Dès l’instant où leur nombre a augmenté, il y a eu des frontières, des conceptions de la vie différentes selon les groupes humains – même en France [ouf !], il y a beaucoup de conceptions différentes de la vie… –, l’existence et les comportements se sont modifiés. Pour vivre ensemble, il ne suffisait plus de ramasser des fruits et de manger des vers ou de petits animaux, il fallait cultiver. C’est de la Méditerranée qu’est partie la technologie du Néolithique. La philosophie, le comment vivre ensemble, l’organisation sociale… et la violence sont apparus à ce moment-là.»
On se surprend à déplorer que la technologie soit «partie», qu’elle ne soit pas restée ; car son départ a dû se faire accompagner des ressources minières qui lui sont indispensables ; et l’on éprouve un sentiment de compassion pour ces malheureux Africains tiraillés entre leur «asociabilité» intrinsèque et l’obligation de «marcher en groupe» ; l’on salue aussi l’abnégation de ces «savants» qui s’échinent à hisser leur lecteur au-dessus du «plancher des vaches», hasardant de brasser des idées crypto-racistes qui flattent l’«animal» en le décrétant inventeur de technologie – fût-ce de la pierre taillée. Le savoir dans les entrelacs sémantiques de Sansal et de Cyrulnik est un peu comme la bombe atomique, bourrée de haute technicité, confiée à un dégénéré mental qui trépigne de marquer l’histoire et à qui il suffit, pour concrétiser son rêve, d’appuyer sur le bouton rouge.

Docteur Folamour, de Stanley Kubrick (1964)
On remarquera encore cette technique, la redondance volontaire, comme l’acharnement du sadique sur sa victime impuissante, par matraquage : «Ramasser des champignons, des fruits et manger des petits animaux et des insectes […]» aussitôt suivi d’un «il ne suffisait plus de ramasser des fruits et de manger des vers ou de petits animaux […].» Deux coups d’épée portés sur un sauvage achèvent mieux qu’un… Notons aussi que ces deux hommes ont le don de sillonner les contrées africaines, pour gratifier leurs lecteurs de leur dense savoir, sans quitter le confort de leur salon cossu. Les nouveaux colons ne sont plus de grands aventuriers.
À ce stade de la lecture de ces explorateurs paresseux, l’on a le choix de les abandonner à leurs élucubrations pseudo-intellectuelles, ou tenter de savoir où leurs analyses les conduiront ; histoire de rire un peu. Où veulent-ils en venir, au juste ? Ainsi, ces êtres mangeurs «de vers et de petits animaux» qu’ils suivent à distance respectable sont-ils à leurs yeux dignes d’être des hommes ? «Quand la disputation de Valladolid leur a attribué une âme [ils n’en avaient donc vraiment pas], il a fallu [sic] les baptiser, et non plus les atteler et les dépecer [un moindre mal au final]. Plus tard, on devait pourtant reconnaître le même débat à propos de l’esclavage noir africain. Ce fut une catastrophe [de quel point de vue ?] ! Voilà ce qui illustre [souligné ici] ce que je vous proposais, c’est-à-dire que l’actuelle tragédie du Proche-Orient va répandre sur l’ensemble de la planète et va nous [sic] imposer, après beaucoup de malheurs, une aspiration à… un nouveau malheur. Mais avant d’y parvenir, nous [sic] allons payer le prix fort».
Saperlipopette !
Sansal le démocrate
Récapitulons : le bonheur, c’est dans la guerre, qui apporte le malheur ; et les Arabes vont répandre sur «nous» leur aspiration au malheur, qui nous ouvrira de belles perspectives de bonheur que l’on atteindra à plus ou moins longue échéance, après islamisation ; bonheur dans le malheur pour lequel il faudra d’abord payer le prix fort. En espérant que lesdits Arabes vendeurs de «malheur» ne sont pas trop durs en affaires et qu’ils fixeront un prix modique pour leurs exportations…
Et l’on se surprend à réfréner des idées noires des nostalgiques du temps passé qui déplorent que l’esclavage et les massacres coloniaux n’aient pas eu le bon goût de l’extermination, qui aurait brisé le nœud gordien du malheur et enrayé les fléaux qui se répandent sur «nous». Monsieur Cyrulnik nous avait prévenus : sa barre est placée très haut ; et Sansal a fixé les vaches (nous) au plancher, vouées à ne jamais voler ; clouées au sol, les vaches sont en revanche très disposées à se laisser voler leur lait, leur corps, pour le bien du mauvais esprit…
Si l’on persiste à considérer Sansal comme un Méditerranéen, le sentiment qui prédomine chez lui est une profonde et incorrigible haine des siens. La haine, pleine, entière, dévorante, débordante, viscérale… En doute-t-on un peu ? Hé bien, sur la haine aussi, il s’apprête à nous instruire… «S’il est une chose durable dans les relations entre les peuples, c’est bien la haine.»

de l'homme à la haine
Existe-t-il des statistiques éprouvées attestant le postulat ? On ne le saura pas ! Il faut croire Sansal sur parole. L’homme sait mettre sur le dos des autres les affections dont il est lui-même gravement atteint. De bout en bout, l’ouvrage dégouline de haine envers les petites gens ; mais les évocations de ramasseurs de baies et de mangeurs d’insectes risquent de laisser penser que cette haine vise exclusivement les Africains-Méditerranéens. Très vite Sansal comble le hiatus, toujours avec cette technique «scientifique» qui consiste à sonder les âmes.
«Ce sentiment, explique-t-il, est au cœur [sic] des réflexions [sic] des jeunes Européens issus de l’émigration africaine. Faute de traitement [sic] adéquat, les politiques mises en place pour faire d’eux [sic] des Français de droit et de cœur [sic] […] ont été regardées comme des ruses de marché visant à se constituer à bon compte [sic] une réserve captive [sic] de main-d’œuvre sans véritable qualification [sic] pour occuper les emplois que les Européens de souche [sic] refusent [sic]. La haine déforme tout, les images comme la pensée, mais en même temps, parfois, elle aide à comprendre ce que les mots cachent.» Quand s’exprime la haine, les mots «crachent» plus qu’ils ne cachent.
Mais où finit l’Afrique, où commence l’Europe ? Quid des élus même, les Blancs de col, qui voguent d’ordinaire au-dessus de la barre des lecteurs parfaits ?
«Il faut soumettre les Méditerranéens à des analyses approfondies et des médications sérieuses [sic] avant de les laisser s’asseoir autour d’une table de négociation. […] Ces gens [sic] ne sont jamais aussi dangereux que quand ils siègent à la table des négociations ; il leur vient alors des idées de ruses faisant que la guerre qui sortira des pourparlers sera longue et sanglante. Pour parler de ce que je sais, les négociations gouvernementales entre Algériens et Français ont toujours débouché sur des euphories bruyantes suivies d’une reprise des hostilités à un niveau plus élevé, comme si on s’en voulait de s’être laissé à la naïveté. […] Il faut presque les pousser à se faire une vraie guerre : là, comme dit Cyrulnik, ils rêveraient de paix et s’aimeraient un peu.» On souffle que Sansal ne parle que «de ce qu’il sait» : Français de souche, blanches élites, tremblez aussi ! Vous serez la prochaine pelure à laquelle Sansal administrera en temps opportun ses stupéfiantes «médications sérieuses».
D’où parlent vraiment Sansal et Cyrulnik ? Au-dessus des hommes, lévitant dans les espaces réservés aux divinités grecques, romaines, égyptiennes, ou simplement à Dieu, le vrai, si tant qu’il est de cet univers… Et quand on se prend pour Dieu, l’Histoire et la Science disqualifiées, l’on peut se donner toutes les libertés du monde en matière de cartographie.

Lexique de la haine pour Méditerranéens du Qatar et d’ailleurs…
Pourquoi Sansal et Cyrulnik se permettent-ils de tenir des propos aussi éloignés de la réalité ? Le sentiment d’impunité ; cette toute puissance que confère la certitude que nul ne sera mis en capacité de les confronter à leurs contradictions. Et ce pouvoir immense leur permet de parler de peuples entiers comme un entomologiste d’une colonie de petites bêtes. Le lexique avec lequel ils font le portrait des Africains et des Arabes, «les indigènes méditerranéens» ? «Mangeurs de petits animaux», «mangeurs d’insectes», «barbares , «porteurs de «malheurs», «antisémites chroniques», «souillure», «ordure», «poubelle», «violence», «haine». Ils portent ces accusations directement quand ils le peuvent, par incidence quand une bouffée de mansuétude les saisit. Pour suivre leur raisonnement, il faut localiser les particules de leurs enchaînements qui feraient le bonheur d’un chasseur de paralogismes. «Donc», «voilà pourquoi », «ce qui illustre », etc. Mais ils disposent de toute la palette du parfait illusionniste.

Arabes israéliens vivant dans la seule démocratie du Moyen-Orient : Israël
«On en parle beaucoup, mais sur les 2 millions de musulmans qui habitent en Israël, il y a 5 % d’opposants à Israël, les autres musulmans sont heureux de vivre dans le pays». Remarquons que Cyrulnik ne parle pas de «musulmans israéliens», mais de musulmans «qui habitent» (en attendant leur arrêté d’expulsion) en Israël. Notons aussi que nul n’a jamais dit que les musulmans étaient malheureux d’« habiter en Israël », ils militent même pour le retour au pays de millions de leurs compatriotes chassés naguère de leurs terres. Mais être heureux dans un pays qui s’appelle Israël ne réduit pas les opposants à Israël et à sa politique d’apartheid à la portion négligeable de 5 % ; et on ne saura pas d’où sortent ces statistiques rondelettes et ahurissantes. Il y a en Israël 100 % de Juifs «heureux de vivre dans le pays» ; il y a plus de 5 % d’opposants à la colonisation des territoires par leur État. L’entourloupe tient du paralogisme.
«En revanche, ajoute-t-il, les Palestiniens fuient la bande de Gaza parce qu’ils ne supportent pas la dictature religieuse qui s’y impose.» Un menteur ne ment pas par utilité ; c’est sa nature de mentir : la vérité lui fait horreur. Les Palestiniens ne fuient pas les bombes au phosphore, l’apartheid, une vie de reclus, des check-points à n’en plus finir, l’humiliation permanente, le déficit d’eau, les coupures d’électricité, les hôpitaux détruits, la peur, une déshumanisation et des abus d’autorité qui n’ont pas d’égal dans le monde, mais « la dictature religieuse » ; ils fuient l’Islam. Une « dictature » qu’ils portent au pouvoir par les urnes, depuis des décennies, de façon plus démocratique que ne peut le revendiquer nul autre pays arabe.
Car, outre que les Palestiniens ont autant de latitudes pour «fuir la bande de Gaza» qu’un détenu dans un quartier de haute sécurité, voici un témoignage parmi légion, d’Ygal Sarna, un écrivain juif, qui offre de plus plausibles explication à leur désir d’évasion : « Disons-le pour la millième fois : Gaza, c’est l’enfer. Pendant les quarante ans que la bande de Gaza a été entre nos mains – et elle est toujours entre nos mains, malgré notre départ, grâce à nos avions espions, nos incursions, nos collaborateurs, les clôtures –, on n’y a pas construit une chambre d’hôpital ni un puits d’eau potable. Gaza est un enfer à côté de chez nous ? Et tant qu’elle ne sera qu’un punching-ball pour nos soldats, tant qu’il n’y aura ni aide, ni véritables pourparlers diplomatiques, Gaza nous empoisonnera comme un abcès. Elle sera toujours là, à côté de nous. Et comme tous les lieux en feu, elle continuera de cracher des éclats brûlants tant qu’elle brûlera.[9] »
Ayant achevé de nous convaincre sur les nuisances africaines et leurs retombées européennes, Sansal s’en va chercher la paix impossible sur des méridiens écartés… «Et le petit Qatar voit grand, il fait la guerre au monde entier sans imaginer une seconde qu’il pourrait la perdre, sachant qu’il a du pétrole plein son bac à sable [sic] et la patience d’une armée de chameaux [sic].» Au fil des pages, l’émulation vers le caniveau s’opère.

Telle Ariane avec son fil qui a permis à Thésée de sortir du dédale, Sansal et Cyrulnik sèment des mots à l’adresse du lecteur «parfait», qui pourra suivre les pointillés de leurs affinités – vers des racistes mais qui ont au moins la noblesse de l’assumer –, Michel Houellebecq ou Oriana Fallaci, qui voient dans l’Arabe l’incorrigible «enculeur de chameau» et l’arriéré bédouin des «sables». Qui donc est le minotaure de Sansal ? Une hydre à sept têtes, les barbares africains-méditerranéens, leurs rejetons des banlieues, les islamistes, ceux qui le sont moins mais qui, Français ou Algériens, s’assoient à la table des négociations, etc. À vouer aux enfers de la guerre, histoire de leur apprendre à s’aimer un peu…
Mais n’oublions pas que le livre doit être rentable ; il doit séduire des acheteurs « imparfaits » qui sont les plus nombreux ; il faut donc leur mâcher le travail, leur fournir des recette explicites que de simples «vaches» peuvent ruminer en longueur… Et offrir le relief et le contraste qui permettra d’apprécier à sa juste dimension toutes les nuisances que concentrent les populations de cette région «musulmane» du monde. Des fois que l’heure sonne de pourvoir à leur nécessaire éradication.
Sansal nourrit des haines trempées pour son prochain. Si l’on s’autorisait à user de son style, l’on dirait de lui qu’«il vit de mensonges, il en produit, s’en nourrit, au point qu’il est lui-même [un mensonge], que dis-je, il est [Le Mensonge] tout entier.» Un cercle vicieux fait homme. Un cercle vicieux alimenté par ses victimes qu’il exècre, qu’il flatte d’un mot pour les pousser à acheter sa prose, et qu’il assassine sitôt après de vingt coups d’«épée», pour «faire de la place».
Méprisant, médiocre, raciste. Il est inutile de creuser beaucoup pour trouver le faussaire qui vit en Boualem Sansal…
Le faux de A à Z
Sansal : «J’ai vécu ainsi : j’ai fait une carrière comme enseignant dans un pays gouverné par de sombres dictateurs incultes et incompétents qui n’ont trouvé que la matraque pour faire marcher le pays. […] Pris entre les islamistes et les dictateurs […] décidés à liquider tous ceux qui ne sont pas avec eux, il n’y a qu’une solution, elle s’impose dans l’urgence et la fièvre : relever la tête, résister, s’affirmer […].» Telle est la donc fiche tout en engagement intellectuel volontairement sommaire que Sansal établit de lui-même. Une déclaration en deux volets : l’un pour présenter de lui des faits apparemment anodins, neutres, sans conséquence, l’autre pour affirmer une identité de résistant. Un petit problème ; les deux sont des concentrés de faux.

Commençons par le syllogisme : comment quelqu’un qui est pris en étau entre deux liquidateurs peut-il relever la tête, résister, s’affirmer, et s’en sortir indemne ? D’autres ont essayé et ont eu la tête tranchée. Mais, à vouloir creuser profond, nous risquons de rater l’essentiel. Car même dans son aspect le plus superficiel, anodin (que métier il a occupé), cette biographie est affreusement tronquée, et donc truquée, fausse.
Par son premier aspect, elle recèle un mensonge ; qui en induit un autre, portant sur le second volet de sa présentation, pour faire resquiller une personnalité de grand opportuniste dans l’enveloppe d’un dissident à qui le lecteur doit tout pardonner ; et tout acheter. En effet, s’il a exercé en tant qu’enseignant et ingénieur (passons que nul métier n’existe en Algérie qui permette à un ingénieur de déployer son génie) dans un monde d’obscurantistes, il a occupé des postes bien moins avouables. Sa fiche signalétique fournie par sa principale source d’information, Wikipédia (nous le verrons plus loin), indique qu’«il a été enseignant, consultant, chef d’entreprise et haut fonctionnaire.» Il aurait donc été «haut fonctionnaire» ! à une époque où l’accès à tout poste supérieur ou égal à «chef de Département», dans quelque structure que ce soit, exige la signature auprès des services de renseignement, la sombre SM puis le plus sinistre encore DRS, d’un document, nommé «fiche bleue», qui engage l’intéressé à être agent informateur auprès desdits Services. Sansal est donc un honorable correspondant de l’une des polices politiques les plus brutales de la planète. Cela place l’homme non pas « entre » les dictateurs et les islamistes, mais aux côtés des premiers. Et la SM ne badine pas avec les infidélités de ceux qu’elle considère comme ses rejetons ; en échange d’une prospérité garantie, elle exige une fidélité et un zèle absolus[10].
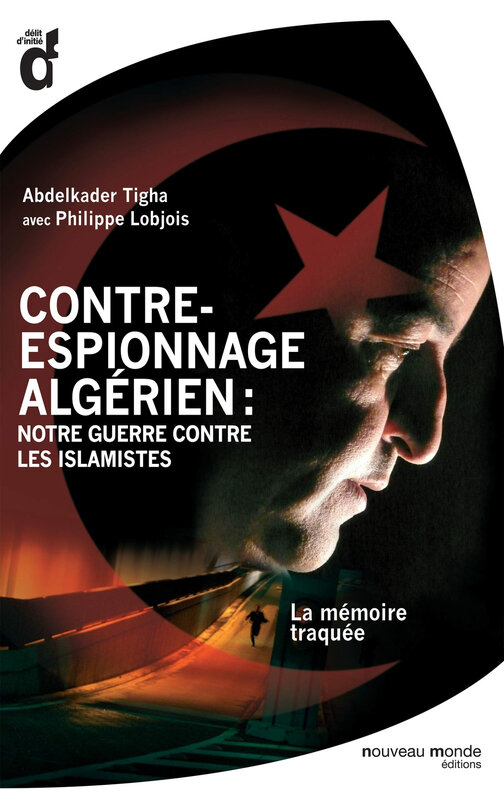
Un examen superficiel montre ainsi un membre à part entière du sérail politico-administratif qui a ravagé le pays. On pourrait à la rigueur admettre que, comme en Union soviétique, on entrait dans le système par nécessité, sans adhérer à ses idées ; mais quarante ans à se faire violence, c’est long, et des dizaines de millions d’Algériens ont surmonté cette avilissante tentation à la facilité ; sans se croire autorisés à aller pérorer sur leur qualité de «résistants» sur tous les plateaux de télévision de France et de Navarre.
Le mensonge se présente sous de multiples formes et, pris par le plus véniel aspect, l’omission, il démystifie la fable monocorde de Boualem Sansal. Durant toute l’époque où il était vital de résister et dangereux de le faire, Sansal était un planqué, dans un confortable poste de haut fonctionnaire d’une administration «dirigée par de sombres dictateurs incultes». Au sortir d’une décennie de violence inouïe, en 1999, tous les Algériens rescapés, quelque trente millions d’âmes de tous âges et genres, étaient des opposants ; y compris parfois dans les cercles intimes du sérail politico-militaro-mafieux.
ue fait alors Sansal, une fois devenu écrivain «iconoclaste» ? Il met sa plume au service des puissants, pour accabler un peuple «barbare». Faussaire donc dans sa biographie en tant que «résistant» face à la dictature. Tort pardonnable dans un monde de Désordre du sens ; si seulement, par équité déontologique minimale, il pouvait l’être de la même manière à l’égard des « islamistes ».
Allons au-delà de Wikipédia et voyons ce que dit de lui, tout en flatterie, le site de la Fnac, qui distribue ses livres et qui semble plus avisé, sans doute dûment informé par l’auteur : «Né en 1949, Boualem Sansal a une formation d’ingénieur (École Nationale Polytechnique d’Alger, École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris) et un doctorat d’économie. Il a été enseignant, consultant, chef d’entreprise et haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie algérien. Il est limogé en 2003 pour ses prises de positions critiques contre le pouvoir en place particulièrement contre l’arabisation de l’enseignement.»
Un grand homme, assurément. Bardé de prestigieux diplômes (abstenons-nous de creuser, sans quoi nous viendrait à l’esprit qu’ils ont peut-être la profondeur de ceux, naguère, d’Helena Ceausescu !) dans un pays où il n’y a pas de boulot. Grandeur à relativiser si l’on tient compte du fait que Boualem Sansal ne se soit avisé qu’en 2003 que la «politique d’arabisation» était à la source de bien des malheurs. Soit 35 ans en retard par rapport aux enseignants, étudiants, lycéens et collégiens, citoyens ordinaires, qui, en 1968, se sont soulevés contre les premières «réformes» d’arabisation de l’enseignement. Conduite qui leur a valu matraquages en règle, arrestations, peines de prison, liquidations sommaires et carrières brisées. Des résistants plus précoces que Sansal d’un tiers de siècle, qui ne se servent pas de leur engagement comme visa pour déverser l’anathème sur leurs concitoyens.
Était-il dans le coma jusque-là, au point d’avoir laissé «des brutes ignares» diriger le pays sans qu’il eût maille à partir avec elles ? Il n’a de preuve à présenter de son « plus que courage » qu’un passé discret, attendant, tapis dans l’ombre comme font les fauves, que l’heure sonne de fondre sur leur proie. En 1968, il avait 19 ans, l’âge de la fougue, l’élan de la révolte. Les trublions (démocrates, modernistes, universalistes, berbéristes, communistes, etc., toute l’élite qui aurait dû conduire le pays hors des pistes de l’obscurantisme) étaient à l’époque repérés, fichés et dûment «traités».
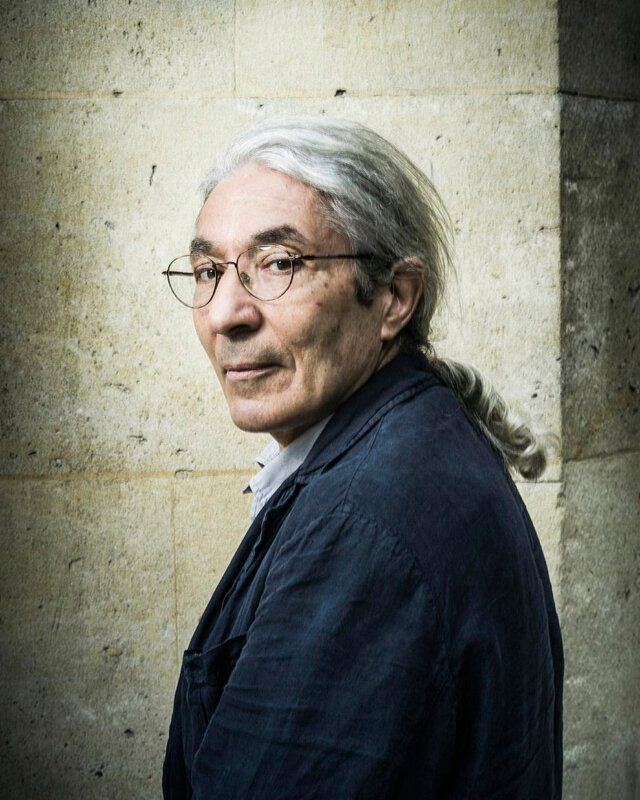
Boualem Sansal
Pour les dissidents, le choix était alors simple : ou ils se ralliaient à la dictature, et ils étaient récompensés d’un avenir prometteur, d’un poste de ministre, de haut fonctionnaire, de directeur de société nationale, de chef d’établissement, d’ambassadeur, doté de formations de villégiature, de soins à l’étranger, de logement et de véhicule, de ravitaillement dans des coopératives ravitaillées de l’étranger, etc. ; ou ils décidaient de «relever la tête, résister, s’affirmer» et ils étaient promis à un destin brisé. Dans ce contexte, un pays où il manquait de tout – on ne le rappellera jamais assez à la décharge de ce peuple malmené –, il est extraordinaire que l’écrasante majorité des citoyens ait préféré leur dignité plutôt que les facilités qu’offrait l’adhésion au parti du FLN et au système policier qui contrôlait tout. À quoi s’est occupé Sansal à l’époque, outre de cumuler des diplômes ? On ne peut que le supputer. En tout état de cause, s’il pouvait présenter le plus petit élément susceptible de le marquer comme résistant, imagine-t-on qu’il nous le cacherait ?
Douze ans passent. L’actualité donne alors aux Algériens l’occasion de se positionner dans le duel entre les menées rétrogrades de la dictature et les balbutiements de la démocratie, de la culture, de la liberté, de la science, de l’appel à la justice sociale. Nous sommes en 1980. Sansal a alors 31 ans, soit la force de l’âge, loin des temps où on soupèse le pour et le contre, entre la soumission à la dictature et la résistance. 31 ans, c’est l’âge de l’identité affirmée : on sait si on est démocrate, adepte de la liberté, avec leur charge d’ennuis, ou plus enclin aux assurances et aux postes de haut fonctionnaire qu’offrent les militaires, les services secrets, le clan de la tyrannie, les tortionnaires. Cette année-là, il y eut les événements du «Printemps kabyle».
On chercherait en vain la trace du crayon de Sansal pour, aux côtés des persécutés, «relever la tête, résister, s’affirmer». Il avait alors suffi de quelques mois pour que la population algérienne dans son intégralité revienne de la propagande du pouvoir qui faisait des Kabyles des «profanateurs de Coran», des «brûleurs de drapeau», des sauvages qui ont lancé des pogroms contre les nombreux arabophones vivant dans la région. Un an plus tard, le temps de vérifier, et un peuple entier s’est mis à entonner quasi en chœur : «Les Kabyles ont raison». L’info n’a en revanche pas dû percer jusqu’aux oreilles de Boualem Sansal car l’adorateur de Camus n’a toujours pas jugé l’heure venue de «relever la tête» et de procéder, de visu, à une réactualisation de Jours de Kabylie. Les Kabyles étaient des pestiférés et un haut fonctionnaire, ça sait faire le calcul de ses intérêts, des dividendes de la soumission.
De 1980 à 1988, pas une année ne s’est écoulée sans qu’une grande ville et ses environs ne se soient soulevés contre une dictature qui ne tient déjà plus – en interne – qu’à un dispositif policier brutal et – en externe – au noyautage des institutions internationales par une armée de hauts fonctionnaires zélés ; des hauts fonctionnaires qui peuvent jouir à volonté de bourses généreuse, pour des formations longues, dans les universités où l’on dispense des diplômes mérités ou de complaisance. Manifestations citoyennes répétées qui ont été accueillies par une répression sauvage ; et toujours le silence de Boualem Sansal.

Arrive octobre 1988. Sansal a 39 ans, l’âge des convictions bien chevillées. C’est sous sa fenêtre que l’armée du général Nezzar et autres Larbi Belkheir ont tiré à la mitrailleuse lourde sur des jeunes algérois qui se soulevaient contre les « sombres dictateurs incultes et incompétents ». Les témoignages et les preuves d’un régime tortionnaire, massacreur, étaient massifs. Les preuves étaient là, sous sa fenêtre. Quand on toise les «barbares» de haut, on a nécessairement l’échine baissée ; l’heure n’avait toujours pas sonné pour Sansal de la relever.
Commence alors la décennie noire. 1990. L’apocalypse. Dix ans durant, l’Algérie, son peuple, sont martyrisés : 250 000 morts innocents, un pays ravagé, une société méthodiquement démantelée. Mutisme total de Sansal. La campagne de meurtres à grande échelle a commencé par l’élimination par les escadrons de la mort du DRS – auprès de qui tout haut fonctionnaire a montré patte blanche et signé «fiche bleue» – de nombreux intellectuels vrais qui ont considéré que l’heure était venue de «lever la tête, résister, s’affirmer» : Djillali Lyabès, Djillali Belhenchir, M’Hamed Boukhobza, Mahfoud Boucebsi, Tahar Djaout, Youcef Fathallah, etc. Toujours pas de signe de vie de Boualem Sansal… Électro-résistogramme plat. Dix ans c’est long, long, long. Mais ils passent.

Nous sommes en 1999 ; il a 50 ans. Apeurés par la perspective d’être livrés au TPI de la Haie, les généraux décident de cesser le massacre systématique de civils, vieux, enfants, femmes ; et, moyennant impunité internationale, d’offrir la présidence à celui qui, quarante ans plus tôt, avait conspiré pour priver les Algériens de l’indépendance : Abdelaziz Bouteflika. Lequel enclenche le second volet de sa forfaiture : offrir le pays qui échoue entre ses mains aux vautours sans frontières. C’est là que Boualem Sansal publie son premier livre qui le propulse intellectuel de premier rang : Le Serment des barbares. Barbares les Algériens ?
Une chose est sûre : la haine des siens est un sauf-conduit efficace, un sésame pour tous les plateaux de télévision de France. Pourquoi le monde entier déciderait de s’allier avec l’une des dictatures les plus affreuses de la planète pour maintenir un peuple innocent sous un joug implacable ? La question méritait d’être explorée ; ce n’est pas l’angle d’attaque que choisit Sansal ; il a préféré la posture lucrative aux côtés de ceux qui accablent le siens. Il en avait le droit ; mais cela ne correspond pas à la définition usuelle du mot «résister».
Il faudra pourtant encore 4 ans pour que murisse enfin en lui l’idée de «résister à la politique d’arabisation». En 2003, l’arabisation n’est plus qu’un lointain souvenir ; l’affaire est entendue, vieille de 35 ans et les stigmates de son irréparable échec sont visibles sur le visage, le corps, l’âme, de tout le pays.
Dans l’intervalle, les Algériens ont vu leur pouvoir d’achat divisé par 20. Le chômage s’est emparé du destin de millions de jeunes qui n’aspirent qu’à braver les flots de la Méditerranée pour échapper à un horizon nihiliste. Les plus hautes institutions nationales sont vassales des puissances étrangères croisées. Le système de santé s’est écroulé. Le système éducatif a sombré dans un profond coma. L’édifice économique est ravagé. L’image du pays est irrémédiablement souillée. La corruption atteint des sommets sans équivalent à l’échelle du monde. La Justice s’est muée en rouage parmi d’autres d’un appareil répressif qui a phagocyté l’ensemble des administrations.
Par monts et par vaux, croyant naïvement qu’en établissant la vérité sur les réalités du régime mafieux et criminel qui les dirige ils obtiendraient enfin un soutien international, des citoyens tentent de briser la carapace médiatique verrouillée autour du principe qu’il n’y a de terrorisme que le terrorisme islamiste. En vain. Sansal est à cet instant dans la maison Médias, sur tous les plateaux, et tous les journaux lui sont ouverts. Aux côtés de qui celui qui veut «relever la tête, résister, s’affirmer» va-t-il se ranger ? Toujours du bon côté du manche, aux côtés des bourreaux.
Boualem Sansal ment en se présentant ; c’est mal élevé. Il falsifie sa biographie mais c’est dans l’ordre des choses d’un faussaire ; celle-ci pourrait se décliner ainsi : Planqué de 1962 à 1999. Publie un livre en 1999 et temporise quatre ans durant, histoire de vérifier que sa carrière d’écrivain lui assurera des revenus confortables. Quitte ses fonctions au sein du pouvoir algérien pour se consacrer à un nouveau sacerdoce : se mettre au service des propagandes ennemies de son peuple et accabler les siens, en les accusant d’être porteurs de tous les maux qui empoisonnent le monde. Ou, plus brièvement, colonisé de 1949 à 1962 ; colonisateur depuis.
Écrivain de fictions, il serait plus que qualifié pour présenter de lui-même une biographie romancée, autour de l’idée d’un traître à la cause des siens pour se sauver à titre personnel : Le Serment [du] barbare en serait un titre idéal. Un seul coup c’est promis, après, on ne l’y reprendrait plus. Mais le traître s’aperçoit vite qu’il est sous le coup d’une double peine : le regard haineux de ceux qu’il a trahis, et celui chargé de mépris de ceux auprès de qui il l’a fait. L’engrenage est enclenché. Une seule issue se dessine, la fuite en avant ; la trahison démultipliée : dépeindre un monde sans rédemption, où les faibles méritent leur sort, où nul ne doit en réchapper. Mais surtout ne pas rester seul, trouver un havre de repli, de préférence très puissant, un cocon où la littérature de la haine de soi est considérée comme la quintessence de l’engagement intellectuel. Un cocon qui commence à trouver la promiscuité des gueux par trop envahissante. Chez qui un «antisémite viscéral» repère-t-il la fortune et la gloire ? Chez les Juifs. Mais patientons encore un peu… L’amour est un sentiment relatif ; celui qu’il va manifester pour les Juifs sera mesurable à la haine qu’il nourrit pour les damnés…
Le génocide en pointillés
La Méditerranée ? «Trop de pays, trop de peuples, de tribus, de particularismes, de dieux, trop de soleil, trop de tout, autour d’une mer minuscule. Gare à la promiscuité. On voit cela dans les banlieues, dans ces grandes barres Babel […] La bonne mesure a été de dynamiter ces barres et de disperser leurs populations, avec l’idée de constituer des ensembles humains gérables et d’empêcher que des bisbilles entre voisins ne dégénèrent en guerre raciales, ethniques, religieuses.» Dynamiter, disperser, (in)humains, gérer des dégénérés… Cela constituerait un titre sur mesures pour un second volet d’une saga d’Olivier le Cour Grandmaison : après Coloniser. Exterminer, «Dynamiter»… Admettons que la dynamite, c’est plus civilisé que le génocide, que les fours crématoires…
Que vient faire la banlieue dans un exposé sur la Méditerranée ? Une incise passerelle, qui offre la recette pour deux coups d’une seule pierre. Et c’est à regret que Sansal concède : «Évidemment, on ne peut rien dynamiter en Méditerranée, ce qui viendrait ainsi aérer la maison et favoriser des visions plus larges des choses».
A-t-il à l’esprit cette demi-mesure que pratiquèrent les coloniaux conquéreurs de l’Algérie, la «compression» ? On peut le supposer en lisant la suite, exégèse géostratégique pour pilier de bar à trois heures du matin. Une vision qui rendrait la compression insuffisante et l’extermination inéluctable, sans laisser au lecteur le loisir d’une larme versée aux victimes transformées d’un tour de phrase en coupables : «La destruction de la Libye et celle de la Syrie, censées [sic] faire de la place, ont au contraire [sic] transformé des problèmes locaux en conflit international, que l’on peut presque qualifier de Troisième guerre mondiale. Puisque vous parlez de flux et de reflux, il faut remarquer que tous les peuples de Méditerranéens ont tour à tour dominé la Méditerranée, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans, puis les Français.

Ce premier tour qui a duré deux mille cinq cents ans s’est achevé dans les années 1950-1960 avec les indépendances des pays du Sud. Et voilà un nouveau cycle qui commence : les Arabo-musulmans ont pris l’initiative et partent à la conquête de la Méditerranée, considérée aujourd’hui, dans une dimension plus vaste, comme englobant toute l’Europe et tout le Sahel.» Qui donc a eu la coupable idée de leur octroyer des «indépendances» ? Comment arrêter le «nouveau cycle» ?
Dynamiter les méditerranéens, ce pourrait être une solution (théorique) à explorer. Ce ne serait après tout qu’un mauvais moment à passer pour débarrasser la planète de ses encombrants barbares, pour «faire de la place» aux peuple civilisés (les auteurs en dresseront le portrait plus loin). Pour empêcher la gangrène, une petite guerre mondiale bien maîtrisée, sous la conduite cette fois, non pas d’un dégénéré comme Hitler mais, d’une portion méritante, «parfaite», de la population mondiale ; à condition de bien la délimiter avant de procéder à l’ablation. Supprimer les membres gangrenés, les Africains, les Méditerranéens, etc. Une gageure, car c’est là tout le berceau de l’Humanité. Leur sacrifice prendrait l’allure d’un parricide absolu.
Qu’à cela ne tienne ; Sansal offre une issue honorable au dilemme : «Si l’on devait tenir compte d’une certaine réalité, de plus en plus réelle de nos jours, on parlerait de Méditerranée au pluriel.» Et de les citer : «la Méditerranée des Olympes […], la Méditerranée occidentale […], la Méditerranée orientale, la Méditerranée centrale […] la Méditerranée cimetière, où viennent mourir les pauvres du continent oublié : la Méditerranée poubelle, où s’amoncellent les ordures d’hier et d’aujourd’hui.» Sansal, c’est un peu ça ; c’est plus fort que lui, il ne peut pas s’empêcher de conclure ses envolées prometteuses par des chutes fracassantes : Parvenir à caser «pauvres africains et «poubelle» dans une même envolée, Oriana Fallaci aura sans doute apprécié. Et que fait-on des poubelles d’ordinaire ? Destination finale : l’incinérateur… Mais soyons clairs, tout cela est théorique, vague reflet d’une « certaine réalité, de plus en plus réelle de nos jours. »
Il n’aura pas échappé au lecteur sourcilleux que cette histoire qui fait de Boualem Sansal un ex-haut fonctionnaire (et donc un membre à part entière de la junte militaro-politico-administrative) ne repose à ce stade que sur des biographies sommaires produites par des sites tiers – même si l’on peut considérer qu’il n’est pas totalement étranger à leur rédaction. Existe-t-il un indice direct que cet homme a exercé comme haut fonctionnaire au sein d’une «dictature de sombres brutes» ? Il y en a un et, par chance, c’est lui qui le fournit. La garantie de l’impunité additionnée à une dévorante volonté exhibitionniste, en marge d’une question expédiée en hâte dans l’ouvrage, le conduit à commettre un lapsus de vanité.
Le processus de Barcelone vu par Wikipédia
Reprenons son exposé complotiste là où nous l’avions abandonné, avec des Arabo-musulmans prêts à submerger le monde de leur «malheur» : «Et voilà un nouveau cycle qui commence : les Arabo-musulmans ont pris l’initiative et partent à la conquête de […] toute l’Europe […]. S’ils réussissent jusque-là, il n’y a pas de raison qu’ils s’arrêtent cette fois-ci à Vienne ; ils viseront plus loin, la Russie, l’Asie, l’Afrique… Les cavaliers d’Allah en rêvent depuis longtemps.»

Sansal accorde aux Arabo-musulmans des initiatives que deux cents ans d’histoire moderne ont réfutées. Leurs dirigeants n’ont jamais su s’accorder sur rien d’autre que laisser des puissances étrangères piller les ressources de leurs peuples en échange d’un soutien à leurs croisades tyranniques. Les présenter comme capables de se coaliser et de se coordonner pour conquérir le monde est proprement sidérant. Au mieux de leurs intentions, au cours de la décennie 1920 où tous les malheurs se sont noués, ils ont été les objets dociles de toutes les manipulations des Turcs, des Britanniques, des Français et des Sionistes (nous y reviendrons). Pourtant, comme dirait Galilée, «elle tourne» la mécanique terroriste et islamo-envahissante ! Et c’est là qu’aurait dû commencer le vrai travail de Sansal et Cyrulnik, pour comprendre cette sorte de machine infernale, travail qui aurait bien valu 15 euros. Mais il leur aurait fallu pour cela consacrer un temps long à des lectures hors Wikipédia plutôt qu’à consommer les rentes de leurs forfaitures et à rédiger des sommes pseudo-journalistiques soustractives de peuples.
Sansal préconise d’«arrêter les Musulmans» totalement, et non qu’«à moitié» ; et ne pas attendre qu’ils soient parvenus à Vienne, ou «à Poitiers». Toute bonne stratégie imposant d’anticiper et non de guérir, il faudrait donc les stopper à la source ; tuer l’embryon à la gestation. Et, dans cette optique, la destruction de Libye est de la Syrie avait, suggère-t-il, une vocation vertueuse : «faire de la place ». Hélas, «au contraire», cela s’est mal goupillé. Les problèmes locaux des «barbares» ont dégénéré en conflit international ; les géostratégies à la petite semaine du duo Nicolas Sarkozy-BHL n’y sont pour rien. On imaginait «les Arabo-musulmans» dindons de la farce néoconservatrice d’une domination pour un siècle (PNAC, ou Plan for a New American Century) du complexe militaro-industriel ; on se trompait : Satan, le Mal, la barbarie, ce sont «les Arabes». A-t-on épuisé toutes les recettes pour faire de cette région un bassin de paix ? Les institutions internationales au service des oligarchies n’ont pas été avares d’initiatives vouées à l’échec, de campagnes mort-nées, de commissions de bonne volonté sans lendemain, de «coopération» pour le développement qui ont accouché de grandes corruptions, de financements occultes, etc. Les Européens n’ont-ils pas tenté, au registre des approches charitables, le processus dit « de Barcelone » ? Sansal nous explique d’abord ce que c’est, après quoi il détaille pourquoi cela n’a pas marché… Une opportunité pour lui d’étaler – ou d’infliger à ses lecteur l’offrande de – son érudition :
«Ce processus, également connu sous le nom de Partenariat Euromed, visait à favoriser la paix et rapprocher les deux rives de la Méditerranée. […] Nous pensions qu’il fallait mettre de la coopération, du partenariat, du développement durable, du transfert de technologie, de la mise à niveau, de la mobilité, des échanges dynamiques.» Quelques passages d’histoire objective…, pompés quasi in extenso dans Wikipédia : «Le Partenariat Euromed, dit aussi Processus de Barcelone […]», etc. S’ensuit une liste d’objectifs, comique de répétition des trois volets de la déclaration officielle : de «politique» et de «sécurité», «culturel» et «humain», avec la définition « d’un espace commun de paix et de stabilité, économique et financier, pour permettre la construction d’une zone de prospérité partagée […] afin de développer les ressources humaines, favoriser la compréhension entre les cultures et les échanges entre les sociétés civiles ». Dans tous les articles, le même encart de public-relations ; suivi d’un même développement où reviennent comme un mantra «pannes», «fragilités», insuffisances», «échecs», «contraintes», «freins», euphémismes pour le détournement de milliards d’euros des contribuables européens pour financer des partenariats affairistes sans lendemain pour les peuples et lourds de rétro-commissions pour les hauts fonctionnaires «donateurs».
Le sujet mérite examen et un survol superficiel suffit pour localiser le ver du fruit : «L’objectif final est de créer une zone de "prospérité partagée"». Partager ? On pourrait citer mille raisons qui expliquent pourquoi des pays du Nord – qui rivalisent d’ardeur pour piller les ressources de l’Afrique et de l’Orient et qui ont le mot «partage» en horreur à l’égard de leurs propres peuples – n’ont aucunement l’intention de se montrer charitables envers les pauvres étrangers. L’on ne comprend pas davantage ce qui motiverait un dictateur du Sud, dont le régime repose sur le rapt, la torture, la corruption exacerbée, l’abus d’autorité, à favoriser l’émergence d’une société civile à la répression et à l’étouffement de laquelle il déploie des efforts insensés.
Sansal aurait pu mener une réflexion sur la cohérence d’une démarche qui reposait sur la bonne volonté du régime algérien de coopérer en matière de paix et de sécurité quand il est le principal terreau et le plus grand pourvoyeur de terroristes de ces trente (sinon soixante) dernières années. Il y aurait tout cela et un nombre considérable de raisons de comprendre pourquoi le « Processus de Barcelone » était vicié et l’on aurait tant aimé entendre Sansal les développer ; car un problème bien diagnostiqué a, si telle est la volonté, de bonne chances d’être résolu.
Mais son exposé se termine là, dans un périmètre sub-wikipédien. S’ensuit une logorrhée «bordélisant» Braudel, imputant à des «pulsions mystérieuses» décrétant un tropisme définitif «de l’indigène méditerranéen» pour lequel «la modernité compte peu». Pour Sansal, l’erreur était d’avoir «pensé à l’économie, au commerce, à la sécurité, mais pas à la vraie [sic] nature des Méditerranéens : le sentimentalisme et le symbolisme complexe mêlant identité, religion, mémoire, et tous les vieux ressentiments que le Méditerranéen adore ressasser, comme il adore s’agacer les dents [sic].» Bref, le Méditerranéen du Sud, l’Algérien plus que tout autre, est un ruminant irréparable, un inconsolable homo-écorché-vifus. Un barbare, une tare, bon à l’équarrissage… À l’éradication.
Le «printemps» maudit
Mais lorsqu’on veut on peut, dit l’adage ; la contraposée vaut-elle en matière de politique ? Peut-on conclure que n’ayant pu faire aboutir le «processus de Barcelone», c’est donc que personne n’a voulu ? Sous diverses appellations, les initiatives foisonnent et remontent au moins aux années 1980 ; rien n’y a fait. Que manquait-il donc pour réussir ? Et là, la pensée de Sansal est soit proprement ahurissante, soit une pièce de plus à mettre au registre des haines recuites qu’il nourrit à l’égard des peuples du Sud : «L’échec, dit-il, vient en fait du surgissement (attendu, pas attendu ? provoqué, pas provoqué ?) du "printemps arabe" qui a chassé les dictatures arabes […] sans faire entrer la démocratie et fait apparaître ce qui était à peine soupçonné [sic] : la profonde et irrésistible réislamisation des peuple arabes et l’inclination de nombre d’entre eux (chez les jeunes, les commerçants, les professions libérales) vers des courants radicaux (salafisme, wahhabisme, takfirisme, djihadisme…) […]. L’idée que la paix est possible si l’Europe fait une large place à l’Islam, lequel fait son chemin en Europe dans les milieux les plus divers, s’impose à gauche, et de plus en plus à droite. La couverture en mosquées du territoire (déjà 2500 mosquées de recensées – NDLR), le halal qui pèse de plus en plus lourd dans le marché et le nombre croissant des conversions à l’islam [aucune statistique proposée par une NDLR] en témoignent, mais l’islamisation n’est pas assez rapide [sic] pour envisager la paix dans un avenir proche.» Il est vrai que les Méditerranées sont intrinsèquement lents.

L’échec du processus de Barcelone viendrait ainsi de ce que les Arabes ont voulu explorer les verdures du «Printemps» et d’avoir «chassé les dictatures ». La meilleure initiative de ces peuples pour se soustraire au joug de toutes les aliénations, internes et externes, est, selon Sansal, la cause rétrospective de tous les malheurs. Et en vrac la « ré-islamisation des peuples » ; leur « inclination » au radicalisme ; la gangrène qui gagne les peuples d’Europe (gauche et droite confondues) ; la « couverture en mosquées » ; le « hallal » ; bref, en lieu et place de la démocratisation du Sud qui n’en veut pas, l’islamisation du Nord qui en redemande mais que l’on ne satisfait pas de façon « assez rapide ».
On ne sait s’il faut déplorer l’islamisation rampante ou au contraire espérer un rapide « grand remplacement » pour mieux « envisager la paix», via le «malheur» qui engendre le «luxe» du «bonheur». On comprend cependant que Sansal, d’abord pris au dépourvu par la question du Processus de Barcelone, retombe au fil des arguments éculés sur ses pattes, poussant la perversion jusqu’à envisager avec hauteur les vertus d’une paix retrouvée dans le cadre d’une Europe islamique. Il conclut ensuite, tout en lapalissade, pour le cas où le lecteur serait un idiot impénétrable, qu’«il est bon de savoir que, selon l’orthodoxie, la loi islamique prend la main dès lors que les musulmans sont majoritaires dans un endroit donné». Le problème n’est donc pas l’Islam, ou le Coran, mais une «loi islamique» indéfinie, portée par «les musulmans» ; et la démocratie qui se conforme à son étymologie. Resterait l’option d’une démocratie sans la volonté de la majorité, d’un Islam sans musulmans, d’un Coran sans lois coraniques et le bonheur et la paix seraient définitivement assurés dans les prés islamiques européens.
Mais si cela illustre bien pour qui roule Sansal, contre qui il «résist»e, un détail essentiel nous a échappé : la trace de l’endroit d’où il s’exprime, son sérail, son identité, l’empreinte digitale de sa compromission. C’était au tout début de sa déclaration : « […] Nous [sic] pensions qu’il fallait mettre de la coopération, du partenariat, du développement durable, du transfert de technologie, de la mise à niveau, de la mobilité, des échanges dynamiques. » Le tout était dans le «Nous». C’était plus fort que lui. Il n’a pas pu s’empêcher de se donner l’importance d’avoir participé à un processus officiel, regroupant des «hauts fonctionnaires» d’Europe et de Méditerranée ; d’avoir contribué à une initiative louable, torpillée par l’irresponsabilité de la plèbe tunisienne, égyptienne, syrienne, libyenne, etc., qui avait la prétention à regagner dignité et liberté et qui a échoué à installer la démocratie. Tant qu’il s’agissait de sites épars affirmant le titre de Sansal comme haut fonctionnaire de la plus tordue des dictatures de la planète, on ne pouvait rien conclure. Accordons à Sansal, sinon d’avoir joué un rôle participatif dans le processus sans lendemain de Barcelone, d’avoir été parmi ces envoyés algériens dans des sommets internationaux, dans le seul but de leur offrir des vacances tous frais payés, et des défraiements en devises étrangères équivalents aux émoluments des dignitaires européens.
Faisons comme Sansal et répétons-le : à moins de développer une nouvelle grammaire des langues où «nous» exclut l’orateur, Sansal a participé au Processus de Barcelone en tant que haut fonctionnaire. Et s’il a échoué, c’est la faute aux prétentions du Printemps arabe à la liberté. Ce «nous» vaniteux pourrait n’être que cela, l’expression d’un arriviste qui veut prouver qu’il a toujours été quelqu’un d’important ; cela peut également être mis sur le compte d’une inadvertance, un lapsus, un fourchement d’« épée ». Mais les occurrences de la fourberie des deux auteurs sont si nombreuses – et nous allons en examiner nombre d’entre elles dans la limites des stocks autorisés – dans leur ouvrage pourtant famélique que cela reviendrait à considérer une goutte d’eau particulière au cours d’un typhon comme la conséquence d’une formation aqueuse purement accidentelle, sans rapport avec les trombes de l’averse ; ce n’est pas totalement impossible, mais…
Pilleurs de mémoire, profanateurs de sépultures
Bien installé dans sa propre littérature comme «résistant», Sansal affine, un coup d’«épée» après l’autre, la fresque d’un itinéraire fabuleux. Mais si, pour un fourbe, être adoubé par des fourbes est aisé, pratique, rien ne vaut l’appui d’un vrai «résistant» comme témoin de moralité, pour donner une assise plus solide à son invention ; un homme de qualité, datant son témoignage à l’époque où, en Algérie, les balles sifflaient et la gégène faisait rage. Quelqu’un de sûr, à «prostituer» ; un homme qui ne peut rien démentir, parce que mort et enterré : «Son ami Rachid Mimouni (1945-1995), l’encourage à écrire», annonce sa biographie pour le moins bidonnée. Si Sansal est l’héritier spirituel de Mimouni, qui sommes- «nous» pour retrousser les lèvres ?
C’est l’un des traits de l’élite algérienne que de faire parler les morts, tel Tahar Djaout qui ne s’est jamais autant exprimé – surtout pour disculper ses meurtriers – que depuis qu’il a été assassiné, par un commando du DRS. Voilà en tout cas Sansal ami de Mimouni par contumace ; ce n’est pas une première : après que, ne pouvant tordre les décennies pour prétendre avoir été ami de Camus, il a virtuellement coulé Camus dans sa peau : N’ont-ils pas respiré le même air ? «N’est pas Camus qui veut, mais quand je me souviens que nous étions voisins, sa famille et la mienne, dans cette cour des miracles qu’était Belcourt, un quartier hyperpopulaire d’Alger, et que je me suis continûment abreuvé de sa littérature et de sa pensée, je suis obligé de reconnaître que quelque part, il y a du Camus en moi. Des "Grands frères" comme ça, c’est autre chose que ces "Grands frères" à qui on a livré les banlieues communautarisées de France.»
Sansal, organisme génétiquement modifié donc, à base de graine de Camus. Et, surtout, admirons la chute qui, en une tournure de phrase, réactualise Camus pour en faire un pourfendeur des banlieues françaises et de leur «communautarisme» viscéral.
Camus est mort en 1961 ; mais l’humanité n’a pas tout perdu car son âme s’est insufflée dans le corps de Sansal, attendant avec la patience de Pénélope quarante ans durant avant de produire son souffle ré-générateur. Comme on aurait quelque mal à imaginer «l’indigène» Sansal à dix ans dissertant, dans la cour de Belcourt, sur les heurts et les malheurs de l’époque avec le génie Camus, qui en avait plus de quarante et qui venait d’être couronné du prix Nobel, il fourgue l’imposture intellectuelle en passant par leurs « familles » partageant un certain espace géographique. Famille de Camus qui était réduite à une portion congrue : sa mère.

Kamel Daoud se sert du même filon, en exhibant une parenté avec Camus par personnage oranais de L’Étranger interposé, pour lui infliger une sévère et lucrative correction via un Meursault, Contre-enquête censé rendre justice à l’Arabe ; arabe qu’il se donne en revanche le droit de rouler dans la boue en toute occasion. Mohammed Sifaoui est plus contorsionniste encore ; il nous fait l’offrande d’un aveu : «Alors oui, je le dis, sans me prétendre expert en littérature ou spécialiste de l’œuvre d’Albert Camus, ni par posture ou preuve de snobisme, les mots ont, comme pour lui, toujours représenté chez moi quelque chose d’important. Et les principes, "les grands principes", je les ai réellement et sincèrement chevillés au corps.» Des chevilles quelque peu flottantes tout de même puisque, dit-il, «je vois déjà certains monter sur leurs grands chevaux et réclamer pour la période actuelle l’adoption d’une attitude camusienne. Mais mon admiration ne vaut pas imitation, et les temps et contextes ont changé. »
Camus, «oui», pas trop s’en faut, cependant ; convenons néanmoins que les mots, c’est important, ne serait-ce que pour faire des phrases mensongères. Quant à Yasmina Khadra, quand il flatte, c’est lui aussi pour mieux poignarder dans le dos (n’était-il pas officier des forces spéciales au moment où elles en étaient au plus fort de leur campagne d’éradication ?) : « Ce livre [L’Attentat], je le porte en moi depuis 1982. Ce n’est pas seulement une histoire de l’Algérie coloniale, c’est aussi une réplique aux travaux de mon idole, Albert Camus. Il n’a traité que de son Algérie à lui, son jouet d’enfant, de petit pied noir. Il n’est jamais allé de l’autre côté. C’est ce côté-là que j’ai raconté, celui des pieds noirs, des racistes, des gens bien, l’Algérie dans sa globalité. » Les coups de pied de l’âne ne se font jamais, mais alors jamais, face à face. C’est toujours par derrière, sournoisement.
Cyrulnik-Sansal, le retour
Dans le second volet de sa fiction biographique avec Cyrulnik, Sansal cueillera avec cette même désinvolture Mouloud Féraoun, Albert Memmi, Aimé Césaire, Edouard Saïd, etc., se contentant en guise d’évocation à l’énonciation de leur nom. France-Algérie, Résilience et réconciliation en Méditerranée sonne comme un repentir à L’impossible Paix en Méditerranée ; nous savons que les deux auteurs ne concèdent un mot gentil en entrée en matière que pour mieux déverser un tombereau d’injures en sortie. Mais comme pourrait dire Lenzini, la contradiction ne tue les contrefacteurs que si l’on parvient à s’en servir contre eux ; or, les plateaux de télévision sont média-« ethniquement » purifiés. Et éthiquement épurés.

Mouloud Feraoun
Comment est né ce second opuscule maigrichon ? Ce sont les manifestations de millions d’Algériens – cinglant démenti à la description que Sansal en fait depuis vingt ans – qui le poussent à rectifier le tir ; non pour les glorifier ou déplorer qu’elles contribuent de façon anachronique à l’échec du Processus de Barcelone, mais pour les récupérer. D’un seul coup, Cyrulnik et Sansal ne voient plus un peuple de «barbares», animé d’un « antisémitisme chronique » (l’organique adjectif de «viscéral» qu’affectionne Sansal pour décrire un supposé antisémitisme des Algériens laisse place à la guérison, quand «chronique» les voue à une damnation perpétuelle), mais des hommes et des femmes ayant provisoirement reconquis le statut «d’hommes et de femmes».
Après le racisme primaire, l’amour fou. On peut supputer que la rechute les guette. D’autres «élites» ont attendu que le peuple qu’ils honnissent en prétendant le guider se soulève pour se mettre à sa remorque.
Kamel Daoud s’est assuré que les marches étaient bien stabilisées dans la durée avant d’arriver essoufflé sur les plateaux parisiens, armé de photographies où il se montre au cœur de manifestations oranaises lourdes de millions de citoyens… plus spontanés. Yasmina Khadra et Mohammed Sifaoui – qui n’ont pas eu à voyager depuis Oran ou Belcourt – ont attendu que les médias français invoquent de mauvaise grâce le mouvement pour apparaître sur les mêmes plateaux, autopropulsés « pionniers » de la révolte populaire. Curieusement, Sansal semblait avoir fait profil bas. L’on pouvait penser que c’était de gêne, face à ces événements qui démentaient de façon magistrale tout ce qu’il raconte depuis des lustres. Eh bien non ! L’idée pour lui était de faire d’une pierre deux coups : montrer son esprit prompt à « résister » avec soixante ans de retard, mais gagner de l’argent en plus. Les Algériens manifestent à Alger, les opportunistes pondent des livres pour se faire des œufs d’or sur leur dos… ; c’est cela l’élite algérienne : les locomotives se font tracter, tout en se déclarant à l’avant-garde, motrices de ceux qui les tirent. Et en cette matière, les pseudo-«dissidents», les «intellectuels» alternatifs, adoptent la même conduite que l’élite «institutionnelle», officielle : le rapt.
Bref, sur la brique élémentaire de son œuvre, se présenter, Sansal commence par l’occultation et le faux : revendiquer avoir été haut fonctionnaire aurait écorné le principe du résistant ; le nier lui aurait ôté la potentialité de la preuve de son importance. Alors il flotte entre deux eaux, comme font les crocodiles, émergeant promptement à la surface quand il faut et s’enfonçant opportunément dans les profondeurs de l’oubli quand l’évocation de toute proximité avec le sérail politico-économique lui serait nuisible. Un faussaire dans toute sa splendeur. De quelle façon va-t-il décliner le reste ? Les mensonges de Sansal seront-ils tempérés par Cyrulnik, et vice versa, ou bien l’émulation vers le pire va-t-elle se poursuivre jusqu’au bout ? La réponse est facile à deviner…
Les intellectuels négatifs gagnent des renforts
Chercher la vérité dans un univers d’opacité congelée nécessite chaleur, temps, moyens et quelque audace. C’est pour cela que les journalistes d’investigation sont rares et que l’on ne saluera jamais assez les mérites des lanceurs d’alertes. Ce sont là des options à très haut risque. Mais, qu’on ne se méprenne pas ! Sur les sujets que l’on va aborder, il est plus aisé de trouver la vérité que d’élaborer un mensonge. La source favorite de Sansal, dans son nouveau filon du document-lucratif-assisté-par-Wikipédia, suffirait pour réunir les éléments essentiels, ébauche à enrichir d’une plus-value justifiant les 15 euros du prix de vente.
Quelques mots clés tapés dans n’importe quel moteur de recherche produisent des milliers de résultats ; un peu de recul et de discernement suffisent ensuite à un individu honnête pour faire le tri et choisir auprès de qui se « ravitailler ». Or, même sur des sujets de notoriété publique, Sansal et Cyrulnik trouvent le moyen de construire des faux ; cousus de grosse ficelle blanche. Leurs mensonges sont donc voulus, calculés, machiavéliques ; qu’ils soient médiocres est accessoire. Qu’ils parviennent à suborner des dizaines de milliers d’acheteurs dénote un savoir-faire certain dans l’art de la manipulation des cancres. On comprend moins qu’ils aient aliéné de grands hommes, au premier rang desquels David Grossman. Est-ce l’effet de l’âge, qui dicte l’urgence et qui pousse à accepter des mains tendues sans les soupeser pour être certain qu’elles ne sont pas de plomb ? Même à cheval donné, il est prudent de regarder la dentition. Les Troyens ont pâti d’avoir mésestimé l’énergie de la haine, le poids de la cupidité, la force de la duplicité, la puissance de la fourberie.

Boris Cyrulnik
Nous avons cité quelques exemples de déductions à l’emporte-pièce de Cyrulnik. Mais il en a à revendre. « Rappelons que les Juifs ont été chassés du Yémen dans les années trente, alors qu’Israël n’existait pas. On peut en déduire [souligné ici] qu’il y a un antisémitisme européen et un antisémitisme arabe qui sont responsables de la création d’Israël. Et actuellement, l’un de ceux qui provoquent en France le plus d’Alya… c’est Dieudonné. » Un vrai IIIe Reich à lui seul Dieudonné.
Ce à quoi renchérit Sansal : «Réglons vite le cas Dieudonné : on a tellement parlé de lui qu’on en a fait un porte-drapeau, une sorte de Che Guevara pour banlieusards qui ont mal aux dents [sic] ou un Don Quichotte qui vient libérer esclaves et émigrés des mains crochues du complexe impérialo-sioniste-mondialiste-maçonnique-capitaliste néocolonial, selon les formules en tire-bouchon qu’affectionne son maître à penser Alain Soral.» Ouf ! On est passé à un poil d’évoquer Dieudonné sans mentionner Soral. Après les Méditerranéens qui « adorent s’agacer les dents », les banlieusards « qui ont mal aux dents ». Mais laissons… Profitons donc pour conclure, à la manière de nos deux compères, par double induction-négation-complémentation, que les impérialistes, les sionistes, les mondialistes, les maçonniques, des capitalistes et les néocoloniaux sont les amis de Sansal. On s’en doutait un petit peu.
On notera aussi quelques autres ficelles du faussaire : d’abord les deux auteurs parlent des trublions Dieudonné et Soral pour ne rien leur reprocher sur le fonds ; sinon qu’on en parle trop. Cela correspond peu ou prou aux débats en vogue à la télé où on parle de violence, des islamistes, du terrorisme, des voyous, des «fake news» pour déplorer qu’on accorde trop de publicité gratuite aux violents, aux islamistes, aux terroristes, et aux diffuseurs de désinformation. Remarquons encore le saut de puce du Yémen plus-antisémite-que-les-nazis à Dieudonné, une autre pratique populiste en vogue : elle consiste à juxtaposer plusieurs affirmations fausses avec une dernière tout aussi fausse mais susceptible d’obtenir l’assentiment du public, par adhésion idéologique, pour les rendre artificiellement toutes vraies[11].
C’est de même une pratique du milieu – au sens mafieux du terme – que de proférer un propos équivoque et de laisser un protagoniste ami le reprendre, laissant inférer qu’il est une vérité indiscutable. Le premier faux qui documente un autre faux devient en bout de course vrai ; et vérifie le second. On ignorait naguère combien de fois il fallait répéter un mensonge pour en faire une vérité officielle ; la réponse est désormais connue : deux fois. «Rappelons» : le préfixe «re» ou la clé à mollettes du contrefacteur. Rappeler veut dire que c’est nécessairement vrai et que ceux qui ne le savent pas devraient en rougir de honte. Quand on est adoubé par le microcosme médiatique, on dispose d’un sauf-conduit qui nous exonère d’apporter la preuve de ce qu’on avance. Il suffit de le dire pour que cela soit vrai. Si on le répète, c’est que c’est deux fois plus vrai. Outre de dire deux fois la même chose, de répéter ce que l’autre a dit, d’insister sur le fait qu’ils sont d’accord l’un avec l’autre, Sansal et Cyrulnik réitèrent eux-mêmes leurs propos en insistant sur le fait qu’ils les «redisent», qu’ils les «rappellent». Dans un livre de si peu de lignes, ça permet de faire couler plus d’encre. Et cette redondance est si enracinée dans leur approche que quand Sansal évoque Camus, au lieu simplement d’énoncer entre guillemets ce que dans la pensée de Camus est essentiel, nous enjoint de «relire Camus». Sans indiquer ce qui, pour qui a déjà lu Camus, a pu lui échapper d’essentiel.
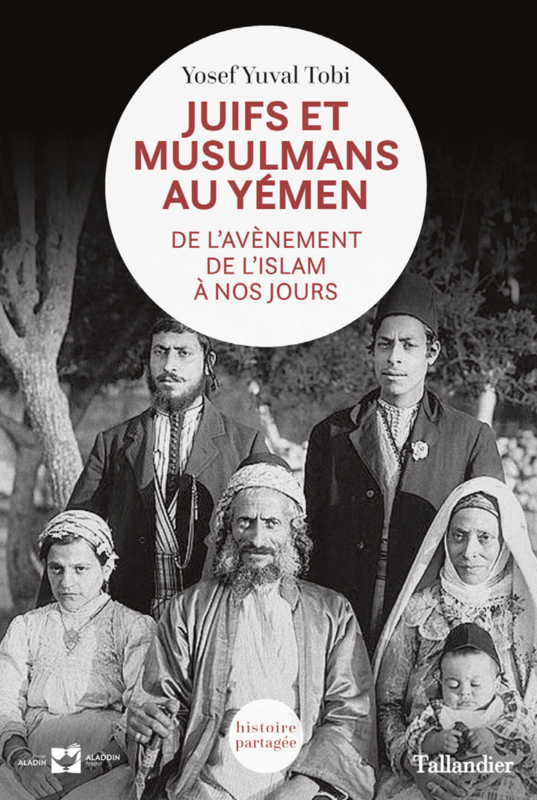
Vivre au Yémen et mourir
Ainsi va l’œuvre falsificatrice, coup de pinceau après coup de pinceau, substituer un mensonge à la vérité, encore et encore, de sorte qu’à terme tout repérage dans le continuum historique devienne impossible. Pousser de plus en plus de monde, par défiance, à préférer les théories les plus abracadabrantesques à la vérité officielle, ce qui place l’ordre établi à une posture de vertu, de rectitude ; de seule information crédible ; un peu comme ces forces spéciales qui créent des groupes terroristes pour se légitimer à les combattre, arguant de protéger le citoyen d’un fléau dont elles sont la seule véritable source. Un grand intellectuel avait décrit le processus, George Orwell ; on ne s’étonnera donc pas que Sansal ait décidé de réécrire son œuvre ; de la souiller en quelque sorte. L’on pourrait reprendre les mots de Sansal : «il faudrait des milliers d’ouvrages pour» rendre la connaissance collective totalement impropre ; mais dit-il « à ce jour, je n’ai réussi, pour ma part, à n’en écrire qu’une petite dizaine. » Il ne faut pas désespérer : avec cette saga méditerranéenne, cela fait déjà douze. On peut parier que plein d’éditeurs lui en ont commandé de pleins rayons.
Mais revenons à la déclaration sibylline de Cyrulnik qui, comme toujours, recelait un loup. Et, à moins d’être un spécialiste de toutes les généralités ou vérificateur compulsif de tout ce qu’on lit, on ne peut que rater le mensonge grossier qu’elle aide à resquiller. La mention de Dieudonné permet à ceux qui haïssent Dieudonné de tenir ce que dit Cyrulnik pour vrai ; ceux qui l’aiment s’époumoneront à le défendre et passent à côté de l’essentiel : «Rappelons [donc] disait-il que les Juifs ont été chassés du Yémen dans les années trente.» Un mensonge haut comme l’Everest.
Un faux que la seule lecture de Wikipédia aurait suffi à éviter. Un faux islamophobe, arabophobe, orientalophobe ; de petite facture, mais à l’efficacité aussi redoutable que Le Protocole des Sages de Sion pour un antisémite primaire : de savoir que les Arabes du Yémen n’ont jamais été des chasseurs de Juifs compte peu ; il n’y a plus de faits objectifs ; «Si l’on devait tenir compte d’une certaine réalité, de plus en plus réelle de nos jours, on parlerait de» vérités ajustables aux discours, malléables selon les exigences «pragmatiques» du moment. Cela suggère encore que, outre que ce qu’ils racontent est faux, Sansal et Cyrulnik savent que c’est faux.
Mais vrai, faux, ce ne sont là que considérations anecdotiques, «des épiphénomènes sans intérêt [dont on] fait de l’histoire». Ce qui importe, c’est que la télé, la radio, les journaux, présentent ce qu’ils disent comme la vérité et ces médias savent reconnaître les leurs. Ils leur ont fait acte d’allégeance, pour devenir les rentiers d’une situation, les opportunistes d’un contexte. D’ailleurs, ils ne peuvent même pas se targuer d’être des pionniers ; ils ne sont que les tout derniers arrivés dans le cercle des pillards, dans un nouveau registre : accentuer l’effondrement des repères.
Et, pour empêcher le lecteur de s’écarter des sentiers balisés, Sansal et Cyrulnik leur rappellent les consignes. «Quand le Président Sissi a interdit les Frères musulmans, et saisi leurs biens, il a été salué par les Égyptiens mais critiqué comme dictateur partout ailleurs dans le monde.»
Le Bien, ce sont les USA porte-flambeau de la démocratie dans le monde, le général al-Sissi paravent des libertés, le PS dans les habits flottants de la gauche, BHL dans celui du philosophe, un monde sens dessus dessous. Empruntons la description de Pierre-André Taguieff de ces élites qui se disent l’incarnation du Bien du moment qu’ils se disent opposés au mouvement lepéniste. Le contexte, c’est «la forme mixte ou hésitante prise par le discours néo-fasciste des "intellectuels" (définis autoréférentiellement, à savoir : "Ceux qui se désignent en tant qu’‘intellectuels’") […]. L’anathème, par criminalisation ou bestialisation de l’adversaire, est un acte auto-suffisant […]. Par la montée aux extrêmes qu’il engendre, le maximalisme est une méthode de guerre civile, il relève du discours de propagande. Il faut choisir entre l’analyse et l’anathème, entre l’argumentation et l’injure.»
Et il est, bien sûr, plus payant d’opter pour l’anathème, l’injure, «la violence polémique». Le tournant de l’intellectuel de l’ancienne veine, rangé aux côtés du faible vers le «crépuscule des intellectuels» s’est opéré vers la fin de la décennie 1980 ; avec la pipolisation du journalisme et de la vie politique, la bascule de la civilisation de la connaissance vers la société du spectacle. « Plus significative encore quoique moins visible, la généralisation quotidienne des faits, rapportés avant d’être véritablement recoupés, impose par sa précipitation une règle, celle du scoop approximatif. À elle seule, tautologique, mais incontestable. Comment CNN, CBS, NHK, BBC, TF1, France 2, France 3, la RAI et les autres pourraient-elles se tromper toutes ensemble ?

De toute façon, mieux avoir tort en chœur que raison tout seul. Un journaliste de feu la Cinq, présent dès le début des événements roumains à Timisoara, en fit l’amère expérience lorsque, téléphonant à sa rédaction pour minimiser les commentaires en cours, il entendit son rédacteur en chef lui rétorquer qu’il n’avait rien compris puisqu’il se trouvait être le seul de son avis. Sans s’interroger un instant sur le fait que ce témoin était effectivement «l’unique Occidental sur les lieux.[12]»
Le faux, c’est le vrai, l’ordre, c’est le Désordre du sens et quiconque l’accentue gagne son ticket d’intégration dans le cercle très sélect des intellectuels adoubés, «faussaires[13]», pour qui tout est admis. Toutes les chaînes de télévision du monde ne peuvent pas se tromper sur le compte de Sansal et de Cyrulnik ! Les promouvoir, les célébrer, vendre leurs livres, vrais, faux, équivoques, honteux, médiocres, tronqués, éculés, dangereux, tout cela contribue à la bonne tenue du marché, à l’essor « du complexe impérialo-sioniste-mondialiste-maçonnique-capitaliste néocolonial. » Et ça, c’est le Bien.
Fort heureusement, dans le monde rêvé de ces élites faussaires, tout n’est pas à jeter. Après avoir balayé de quelques coups d’épée les Arabes, Sansal et Cyrulnik s’attachent à décrire le versant lumineux de l’humanité, réunissant ceux qui à leurs yeux sont dignes d’être rescapés.
Une société mono-monothéiste, mono-ethnique, mono-culturelle :
le Graal de Sansal et de Cyrulnik
Après avoir rabaissé avec méthode tous les peuples faillis de Méditerranée, du Sud ou du Nord, les deux auteurs en arrivent enfin au volet en « positif» de leur démonstration. Ils n’ont pas de mots assez doux pour décrire ce peuple élu des dieux, la crème de l’humanité ; les Juifs, que les Arabes empêchent d’exprimer toute l’étendue de leur grandeur et de leur bonté. Il fallait simplement attendre le signal de départ de l’interviewer pour que la digue cède.
José Lenzini aurait-il pu éviter la question ? Impossible, tant les deux auteurs se sont escrimés à ponctuer leurs commentaires sur des sujets les plus anodins d’une référence à «Israël», à «Jérusalem», aux «nazis», à l’«antisémitisme», aux «Juifs», aux «Hébreux», aux Ashkénazes et, mieux que les Ashkénazes, les Sépharades («il serait long d’en parler ici, explique Sansal, mais on peut penser que le problème aurait été d’une tout autre manière si la question juive avait été traitée par des Sépharades»), à la Judée et à la Samarie, à Hébron, à la Shoah, etc. Il ne pouvait donc pas, dans ce corps malade de la Méditerranée, faire l’économie de la mention de « l’écharde israélo-palestinienne ». Et, autant le dire tout de suite, des trois intervenants, José Lenzini est celui qui s’efforcera le plus de retenir ses coups.
«Le 26 février 1930, commence ce dernier, Sigmund Freud écrivait à Chaim Koffler, membre de la Fondation pour la réinstallation des Juifs en Palestine […] pour lui dire notamment : "… Je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif, ni que le monde chrétien comme le monde islamique puissent un jour être prêts à confier les lieux saints à la garde des juifs. Il m’aurait semblé plus avisé de fonder une patrie juive sur un sol historiquement moins chargé".»
Bien évidemment, les deux auteurs ne sont pas, mais alors pas du tout d’accord avec Freud. À partir de là, c’est l’avalanche. En 18 pages, 94 mentions de «Juif» et d’«Israël», sans compter les innombrables «Jérusalem», «sionistes», «antisémitisme», «Shoah», « Nazis », « Hitler », les 29 « Palestine » et bien d’autres « judaïsme ». Il y aura en tout plus de 160 occurrences de «Juif» dans tout l’ouvrage (soit en moyenne 3 par page normale), sans qu’à aucun moment les Juifs en question aient eu droit à la plus petite critique. L’ouvrage se clôt par une lettre de Sansal à ses amis (réels ou imaginaires) pour s’expliquer – un comble pour qui dit n’avoir de compte à rendre à personne – de sa visite subreptice en Israël : « Le fait est, dit-il, que dans ce monde-ci il n’y a pas un autre pays et un autre peuple comme eux. […] Jérusalem est une vraie capitale avec des rues propres, des trottoirs pavés, des maisons solides, des voitures dynamiques, des hôtels et des restaurants attirants, des arbres bien coiffés, et tellement de touristes de tous pays… sauf des pays arabes […]. » Est-ce cette dernière qualité qui contribue à la beauté des lieux ?

Une fois que l’on a surmonté la forme qui augure d’une inspiration famélique, l’impression qui s’impose en parcourant les pages – qui prennent l’allure d’une approche épistolaire pour mariage arrangé – de ce duo inouï, c’est que le fonds a été puisé à « bonne » source, assorti tout de même du style laborieux de leur cru. Avant de retrouver son « peuple élu », « i l’on met de côté, écrit-il, l’aspect religieux de l’affaire, la Palestine a vécu ce que beaucoup – sinon toutes les régions du bassin méditerranéen – ont vécu : elle est continument passée d’une domination à l’autre. Depuis la naissance du christianisme, elle a tour à tour été romaine (-Ier siècle au IIIe siècle), byzantine (IVe-VIIe siècles), musulmane (VIIe-XIe siècles), musulmane et chrétienne au gré des croisades (XIe-XIIIe siècles), musulmane (XIIIe-XVe siècles), puis ottomane (XVIe-XXe siècles).[14]»
Rendons grâce à Wikipédia qui, outre ce bref exposé, offre des éclaircissement annexes. Pour Sansal, il faudra se contenter de ces cinq lignes, qui en font dix dans son texte (sur une demi-largeur de page). Investigations à haut risque dans Wikipédia donc. Mais qu’à cela ne tienne ! Si l’on fait abstraction «de l’aspect religieux», la Palestine aurait été selon Sansal affaire religieuse depuis le VIIe, soit peu ou prou depuis l’avènement de l’Islam dans le secteur. L’on se demande parfois des hommes politiques et médiatiques s’ils sont pervers ou simplement incompétents. On néglige souvent qu’ils peuvent être l’un et l’autre à la fois ; que la combinaison de deux produit des effets voulus plus ravageurs que la somme de leurs influences séparées.
Mais les dominations sont passées. Cette terre a enfin retrouvé ses légitimes propriétaires. Voilà donc le Graal pour Sansal : Israël, et sa capitale, Jérusalem, et son peuple, les Juifs. Mais le nettoyage ethnique n’est pas encore total ; il y a encore des empêcheurs de tourner en rond. Tous leurs déboires, les Juifs les devraient aux Arabes, et à ceux qui les défendent : Cyrulnik se plaint qu’on soit «en train de falsifier l’histoire, en la justifiant par la propagande. Face à ce conflit historique, on est en train de falsifier l’histoire : c’est une arme de guerre, et je pense même que l’islamisme modéré est une ruse de guerre.»
- Les Algériens, les Maghrébins, les Banlieusards, les Arabes, les Musulmans, les islamistes, les terroristes, tout ceux-là forment une sorte de magma humain indissociable pour lequel les deux auteurs ne conçoivent que des «solutions» expéditives. Écoutons encore Pierre-André Taguieff : «Telle est […] la vision pathologisante des néo-antifascistes "radicaux" qui prônent la méthode chirurgicale, l’ablation des "membres gangrenés" ou des "tumeurs malignes".» Assimiler les Arabo-musulmans «à un groupe néo-nazi, c’est […] opérer l’amalgame grossier fournissant un semblant de justification à une mesure d’interdiction, "totale et définitive", unique objet du désir fou des éradicateurs idéologiques.[15]»
(Taguieff parlait alors de la diabolisation du Front national comme moyen de mettre fin au racisme ; l’argument vaut à l’identique, sinon dans une grande mesure, pour l’éradication des islamistes, des musulmans pour assainir l’Europe.)
Pour éviter la «contamination», le lecteur scrupuleux serait tenté de rejeter d’emblée l’œuvre sans ouvrir l’emballage. C’est un des torts des élites arabophones : ne pas lire assez en général, et s’interdire de lire leurs ennemis surtout. Or, c’est là que se trouvent les preuves des impostures qu’ils veulent dénoncer, et ils se privent ainsi de les démasquer preuves à l’appui. Nous allons donc accompagner Sansal et Cyrulnik auprès de ceux qui resteront debout une fois que les Arabes auront été dûment traités pour «faire de la place» ; pour voir dans quels marécages ils auront entraîné ceux qui à leurs yeux incarnent la vertu, la grandeur, la bonté, la qualité, faites chair : les Juifs.
Mais, auparavant, un autre son de cloche sur cette vision idyllique de la Jérusalem juive.
Le dernier combat : exterminer l’impur
Ce sont les partis religieux qui ont offert à Sharon et à Netanyahou la majorité nécessaire pour diriger le pays, pesant lourdement dans son programme. Pour un gouvernement alliant des sionistes forcenés avec des adeptes d’une vision apocalyptique du monde… Qu’adviendrait-il si les ultra-orthodoxes parvenaient à s’assurer d’une majorité à la Knesset ? Imagine-t-on les laïcs se convertissant aux rigueurs de la piété rigoureuse ? Pour comprendre à quel point cela est impossible, cette scène saisie dans les transports en commun… «Des maisons basses et lépreuses, des cours pavés, traversées de cordes sur lesquelles sèche du linge, le quartier de Me’a She’arim de Jérusalem, qui défile derrière la vitre de l’autobus, évoque inévitablement un ghetto d’Europe Centrale du XIXe siècle.

juifs hassidim
Les rares passants, tous des hommes vêtus de noir, des papillotes encadrant leur visage barré de lunettes épaisses, avancent rapidement. À l’arrêt de la rue Hayyé-Adam, un hassidim monte dans le véhicule presque vide. Il se dirige droit vers le seul goy présent, assis sur une banquette pour deux personnes, derrière la porte centrale. D’un ton froid, appuyé d’un regard noir et d’un geste de la main qui se veut autoritaire, l’homme exige que l’étranger cède sa place. Devant l’incompréhension, puis le refus du goy, le religieux marmonne des propos sans doute peu aimables, déplie un journal qu’il dépose contre son épaule, et s’assoit lourdement sans plus se préoccuper de son voisin.
Aucune insulte dans l’attitude du juif orthodoxe. Simplement une grande indifférence quelque peu méprisante et un souci : se protéger de l’impur. […] Cette séparation du pur et de l’impur est une notion absolue, consignée dans le Lévitique, le troisième des cinq livres de la Torah. […] Impur, le juif ne peut participer au culte. […] La Toumah (impureté) désigne non seulement la septicité qui se transmet par le contact avec l’objet souillé, le fait de porter l’objet souillé, ou même l’aire de la pièce où se trouve l’objet souillé […] mais également l’impureté orale. Les pensées malsaines souillent autant que les objets. […] Pourquoi s’isoler des gens atteints de maladies infectieuses et non de ceux qui communiquent aux autres les maladies intellectuelles et morales."[16]» Mais qu’importe, du moment que les arbres de Jérusalem sont «bien coiffés» ?
Depuis plus de vingt ans, le personnel politique n’hésite pas à instrumentaliser le peuple, sa sécurité, la mémoire de la Shoah, le devenir à long terme du pays, l’image qu’il renvoie au reste du monde, pour se mettre à titre individuel à l’abri de poursuites judiciaires. La chronique à cet égard est édifiante : «Moshé Katsav [… a] terminé son mandat en lambeaux, dans l’opprobre et sous les quolibets communs de la presse et de l’opinion […]. Le patron de la police israélienne annonçait, après plusieurs mois d’enquêtes et cinq interrogatoires de l’intéressé, qu’il avait réuni des preuves accablantes contre le président et qu’il allait recommander au conseiller juridique du gouvernement (sorte de procureur général) Menahem Mazouz de l’inculper pour "viol, harcèlement sexuel, écoutes illicites, subornation de témoin, obstruction à la justice et prévarication".» Un homme horrible à la tête de l’État hébreu, qui conduit Ilan Greilsammer à soulever « une question qui est restée enfouie pendant tout le mandat de Moshé Katsav : "Comment se fait-il que les médias n’ont pas osé révéler ce que tout le monde politique et journalistique, apparemment, connaissait depuis longtemps ?". […] Les scandales sexuels ou financiers ont nourri la chronique politique des années 2000.
L’affaire Katsav a été la partie la plus visible d’un iceberg israélien entaché. En 2001, le général Yitzhak Mordechaï, ancien ministre de la Défense, avait été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis pour agression sexuelle contre une employée de son ministère. La même année, à l’issue d’un procès interminable, Arié Déri, ancien leader du parti religieux orthodoxe Shas, écopait de trois ans de prison ferme pour corruption et abus de confiance. […] Plus récemment, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset, Tsahi Hanegbi, a été accusé de corruption, fraude, abus de confiance et parjure, délits qu’il aurait commis entre 1999 et 2003 lorsqu’il était ministre de l’environnement. Faut-il rappeler le cas d’Omri Sharon, député du Likoud et fils du Premier ministre, condamné à neuf mois de prison […] pour "faux témoignages" sous serment, "faux et usage de faux" dans l’affaire du financement du parti de son père, pour les primaires du Likoud ? Ehoud Olmert et certains de ses ministres ne sont pas en reste. [Il] a été soupçonné de transactions immobilières frauduleuses […]. Quant à son ancien ministre de la Justice Haïm Ramon, il a dû démissionner de ses fonctions en août 2006 pour cause de "harcèlement sexuel". […] Que dire de l’affaire Dan Halutz ? […]

Dan Halutz
Il semble qu’à l’heure où les dirigeants de l’État hébreu étaient en réunion de crise, le chef d’état-major de Tsahal lui s’inquiétait du niveau de ses pertes boursières. Dan Halutz ne démissionnera que six mois plus tard, laissant entendre qu’il préfère assumer ses responsabilités dans la gestion de la guerre "alors que d’autres" semblent vouloir fuir. […] Devant la publication des scandales, Zeev Sternhell dresse un premier constat : "La qualité de la vie politique et sociale s’est nettement détériorée." Une détérioration que le célèbre historien attribue notamment à une baisse de qualité du personnel politique israélien : "Les hommes politiques du début de l’État n’étaient pas des minables alors qu’aujourd’hui, c’est la médiocrité au pouvoir, c’est pire que la IVe République au creux de la vague […] Pour [Denis Charbit] professeur de sciences politiques à l’université ouverte de Tel Aviv […], "à n’en pas douter, la crise est profonde. Tout le monde en prend pour son grade : la Knesset, le gouvernement, la Justice, la presse, et même la présidence de l’État. Tous les pouvoirs sont ébranlés.[17]»
Il semble qu’à mesure que l’idéal qui a animé les pionniers s’éloigne, les leaders recentrent leurs ambitions autour de leurs intérêts propres et de leur libido. Le plus spectaculaire exemple de cette prévarication morale qui frappe les élites est donné par Benyamin Netanyahou, qui parvient à prostituer le parti travailliste de Benny Gantz pour former un gouvernement de coalition qui, sous des dehors de fuite en avant et de politique de la terre brûlée, ne vise qu’à lui offrir l’immunité dans une avalanche de prévarications. Mais qu’importe, du moment que les arbres de Jérusalem sont «bien coiffés» ?
Nous pourrions rallonger à l’envi la liste des faits de sociétés qui gangrènent la société israélienne. Pour ne citer qu’un cas parmi légion, L’Histoire de M. C’est dans la bulle moderne de Tel-Aviv que Menahem Lang a réussi à se reconstituer une vie brisée par une enfance où le viol a succédé au viol. Ses agresseurs, des rabbins, avec la bénédiction de son père. Revenu à Jérusalem pour exorciser le mal, il découvre qu’un grand nombre d’enfants dans les milieux ultrareligieux subissent le même sort. La loi du silence est évidemment la norme. La victime se renferme sur elle-même, et subit l’emprise du galgal. « En hébreu : la roue. On pourrait dire le cercle vicieux par lequel l’agresseur inocule sa perversion à l’agressé. À Bneï Brak, il suffit de prononcer le mot, tout le monde comprend de quoi vous parlez, la roue sinistre qui transforme des violés en violeurs. Ici comme partout, l’abus sexuel est une maladie transmissible.[18] »
- À Bneï Brak, de «nombreuses organisations plus ou moins clandestines, […] sous différentes appellations (Comité pour la Pureté ; Police de la pudeur, Comité de vigilances et autres Escadrons de la modestie), se posent en gardiennes de la vertu. Plus ou moins agréées par les rabbins, ces organisations sévissent contre les femmes "impudiques", poussent à la séparation des sexes (par exemple dans les bus), mettent à l’amende les commerçants ne disposant pas d’entrées séparées pour les hommes et les femmes, combattent les "mœurs dissolues" et poursuivent les individus qualifiés de "dangereux" : homosexuels, délinquants et pédophiles.[19]» Un peu comme les unités spéciales algériennes protègent du terrorisme ; au bout d’un certain temps, on ne sait plus s’il faut redouter le terrorisme ou les unités spéciales, deux revers d’une même médaille.
M. parle… « D’une voix d’outre-tombe, comme au ralenti, il dit qu’il n’a pas divorcé à cause de ses violeurs, il n’a pas échoué dans son travail parce qu’on l’a violé, il ne s’est pas transformé en provocateur parce qu’on a abusé de lui, non… Il s’interrompt, se paupières retombent, le temps s’étire. Ses lèvres recommencent à bouger au bout de quelques minutes, il faut se pencher vers lui et approcher le micro de sa bouche pour pouvoir l’entendre : – … Mais quand le violeur m’a violé, murmure-t-il, le regard des autres sur moi a changé… […] Et c’est ce regard […] qui m’a brûlé ! […] Tu as trois masques sur le visage, reprend-il, et personne ne te voit comme tu es. Mon père, je lui ai dit ce que j’ai vécu et j’ai ôté mes masques… Mais c’est lui, alors, qui en a mis un. À ses yeux, je n’étais plus un garçon cacher !... Je lui ai dit : "Papa, je n’ai rien fait de mal !" Il a répondu : "Oui, bien sûr, je sais ! On t’a attrapé, et tout…" Mais deux jours plus tard, on devait porter chez le rabbin un ustensile à purifier. Je dis à mon père : "Papa, laisse-moi le porter, je vais le purifier, je fais toujours ça pour le rabbin." Il a sèchement répondu : "Non, pas toi !" J’ai crié : "Pourquoi, pourquoi pas moi ?" J’ai senti qu’il ne me voulait plus. […] Il m’a alors dit, et c’est comme une sentence qui tombe : "Parce que tu es impur !" Et depuis ce mot, "impur", je suis entièrement devenu un autre.[20] » Mais qu’importe tout cela dans le regard de Boualem Sansal, du moment que les «arbres sont bien coiffés» à Jérusalem !
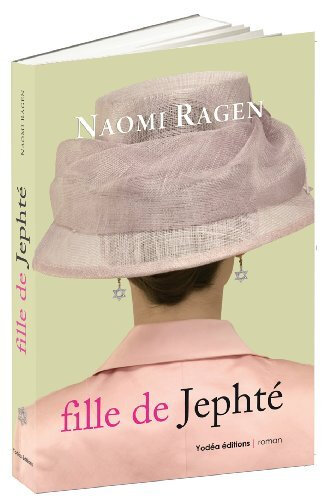
Martine Gozlan aborde elle aussi ce douloureux problème d’une société entrée en névrose. «Le premier roman de Naomi [Ragen], Fille de Jephté, repose sur une histoire vraie. Une jeune femme de vingt et un ans se jette dans le vide avec son enfant. Le mari violait sa femme et son fils. […] Violence cachée. Pathologique. Car des pans entiers de la communauté ultra-orthodoxe sont saisis par une démence qui n’a plus rien à voir avec les comportements habituels des juifs religieux. […] Dès que le comportement déviant d’un ultrareligieux est connu, la communauté rejette […] la faute sur sa descendance. Ses enfants, marqués du sceau de l’infamie, auront d’énorme difficultés à se marier.[21]»
Le péché originel : le pacte de David Ben Gourion avec la secte ultra-orthodoxe du Rabbin Ravi Kook, pour assurer obtenir l’adhésion de tous les Juifs au projet sioniste en Palestine. La facture arrive maintenant à échéance. Le ghetto se referme.
- «Rien à voir avec la situation dans le ghetto ou le village juif d’Europe centrale, le Shetl, où tous les hommes travaillaient sauf quelques sages. On allait à la yeshiva, mais on avait un métier. Sauf les personnalités exceptionnelles, de très grand talent. L’idée selon laquelle la communauté doit vous faire vivre est complètement étrangère à la Torah, qui a toujours insisté sur la dignité du travail. La femme, dans ce système aberrant, doit non seulement s’occuper de ses dix enfants, du ménage et du mari, mais, en plus, trouver un petit travail décent pour améliorer le triste ordinaire de son foyer. Si on va à la yeshiva, on ne va pas à l’armée. Il y avait quinze mille étudiants au début, et Ben Gourion pensait que le nombre n’augmenterait pas. Grave erreur. Ils se comptent aujourd’hui par centaines de milliers.[22]» Mais qu’importe, du moment que les arbres de Jérusalem sont «bien coiffés» ?
Les pieds bien accrochés sur terre, certains tentent de faire éclater les bulles. «À l’été 2011, en particulier […] les premières manifestations des classes moyennes israéliennes […] protestaient contre le coût de vie trop élevé et s’insurgeaient contre ces étudiants ultra-orthodoxes qui vivent de subsides de l’État. Amos Oz, dans une lettre de soutien aux protestataires, n’a pas hésité à attribuer une grande partie du déficit budgétaire du pays à ces "générations de clochards ignorants, remplis de dédain pour l’État, sa population, et la réalité du siècle."[23]» Mais les religions n’ont cure des mécréants. Ils sont persuadés que le temps et leur nombre jouent pour eux. Mais qu’importe, du moment que les arbres de Jérusalem sont «bien coiffés» ?

Ben Gourion
«Ben Gourion leur a offert, dans un document appelé "La lettre du statu quo" un certain nombre de privilèges, le premier concernant en particulier le service militaire. Il confiait aussi aux tribunaux rabbiniques orthodoxes l’exclusivité en matière de statut personnel. Alors que le mariage, le divorce, la paternité, etc., sont en principe du ressort de l’État, ces compétences ont donc été livrées aux seules mains des rabbins et soumises de ce fait à la Halakha, la loi religieuse. […] Dès l’origine, Israël s’est ainsi doté d’un dispositif schizophrénique – obéir à la loi (démocratique), de la terre en même temps qu’à celle (divine) du ciel. Le système électoral israélien fondé sur la représentation proportionnelle intégrale a placé les partis religieux en position d’arbitre chaque fois qu’il s’est agi de former un gouvernement ou de prendre des décisions importantes.
Ainsi, en 1993, pour gagner leur ralliement au accords d’Oslo avec les Palestiniens, le gouvernement de Rabin a tout simplement autorisé les ultra-orthodoxes à prendre contrôle du grand rabbinat d’Israël. Immergés dans la bulle de Bneï Brak, on a parfois l’impression de ne plus tout à fait être en Israël. Sans télé, sans journaux, sans Internet, on n’entend plus parler ni de politique, ni des Palestiniens, ni d’occupation, ni des affaires du monde, ni même de crise gouvernementale.[24]»
Israël tout entier est une mosaïque de bulles, coupées les unes des autres, braquées les unes contre les autres. Celle dans laquelle vit Boualem Sansal d’un Jérusalem pays de cocagne, que seule perturbe la présence des Palestiniens, empêcheurs impénitents de réaliser le rêve éveillé de «l’âme juiv», est peut-être plus éloignée que toute autre « des réalités bien réelles » de la vie en Israël.
Le Yémen et les Juifs : version pile avec le faussaire Cyrulnik, et version face telle que racontée par un intellectuel juif du «vrai»
Affabulateurs, calculateurs, les deux auteurs ne reculent pas devant le ridicule. Ainsi, Boris Cyrulnik ne se contente pas de lire dans le passé et dans les pensées rusées de forces occultes se passant pour des islamistes modérés ; il psychanalyse aussi le futur : «Quand la tragédie du Proche-Orient sera terminée [autant dire pas demain], il faudra refaire de nouvelles frontières, et les gens qui en auront la responsabilité mettront en place des frontières abusives [personne n’en sait fichtrement rien]. Des chiites vont [ou pas], par exemple, se retrouver dans un clan sunnite, ce qui va [ou pas] créer un germe de guerre religieuse. Il paraît qu’il ne faut pas le dire [qui l’interdit ?], mais j’ai du mal à en être convaincu du contraire !»
Quand on a mal, faut se soigner, pourrait-on dire, et la vérité est le meilleur des remèdes à ces maux. «Quand la Seconde Guerre mondiale s’est terminée, poursuit-il, en Europe comme au Proche-Orient, il y a eu également des frontières abusives. Des Allemands se sont retrouvés en Roumanie, où ils étaient mal vus : un million d’Allemands ont été chassés de chez eux, et personne n’a protesté. Un million et demi de Juifs ont été chassés des pays arabes, il n’y a pas eu, non plus, de protestation. […] Je le redis, un million et demi de juifs ont été chassés des pays arabes. Où sont-ils ? […] Rappelons-nous également que les Juifs ont été chassés du Yémen, dans les années trente, alors qu’Israël n’existait pas. On peut en déduire qu’il y a eu un antisémitisme européen et un antisémitisme arabe qui sont responsables de la création d’Israël.»
«Où sont-ils ?» Un génocide arabe des Juifs aurait-il échappé à la sagacité de ses journalistes ? La réponse est prosaïque : une grande majorité, les Sépharades du Maghreb, se sont établis en France. Une minorité s’est installée en Israël. Certains ont préféré les États-Unis. Aucun génocide arabe. On peut évoquer le massacre du 5 juillet 1962 à Oran[25], et il y avait parmi les victimes des Juifs ; mais c’est moins ce caractère qui a guidé les massacreurs que la taxe d’Européen ; massacres et enlèvements qui se sont déroulés sous l’œil bienveillant de l’armée française du général Katz. Tant de confusion mentale, de désordre cognitif, de distorsions historiques, de la part de Cyrulnik, à peine passables dans un oral du bac, est presque… attendrissant. Des raccourcis et des approximations que ne se permettraient même pas les sites conspirationnistes les plus caricaturaux.
Peut-on «déduire» que «chasser un million et demi de Juifs des pays arabes» est à mettre sur un pied d’égalité avec la Shoah et ses six millions d’exterminés ? Mais, à trop baigner dans les condensés de faux de Cyrulnik et Sansal, on perd un peu la hiérarchie des normes. Il faut se remettre les idées d’aplomb, auprès de sources plus fiables. Car, quatre-vingts ans après les faits, la vérité a eu le temps de faire son petit bonhomme de chemin. On peut considérer qu’elle se trouve notamment dans cet article intitulé : «La Seconde Guerre mondiale et les Juifs du Yémen», de Menashé Anzi, paru dans la Revue d’Histoire de la Shoah. Une publication qui, au vu des idées du couple Sansal-Cyrulnik, prend l’allure d’un nid d’islamistes radicaux, animés par un incurable «antisémitisme chronique».
- «Au cours de la première moitié du XXe siècle, vivaient au Yémen environ soixante-dix mille Juifs. Quelques milliers de Juifs étaient installés à Aden, ville toujours sous domination britannique. L’imam Yahya imposait le respect des lois de l’islam et exigeait que les relations entre Juifs et musulmans soient régies par les principes de la charia. En fait, l’imam rétablit le pacte d’Omar, acte juridique traditionnel réglementant les relations entre les dhimmis – protégés croyants dans le Dieu unique et dans le Livre, c’est-à-dire les Juifs et les chrétiens – et les autorités musulmanes […]. Ainsi, en dépit de la liberté religieuse dont ils bénéficiaient et du strict maintien de leur sécurité, les Juifs du Yémen étaient soumis à de nombreuses restrictions. Ces restrictions encouragèrent les Juifs à quitter le Yémen, la grande majorité pour Eretz Israël, et une minorité d’entre eux pour les pays bordant la mer Rouge ou l’océan Indien. Le regain de tension entre Juifs et Arabes en Palestine conduisit l’imam Yahya, dès les années 1920, à intensifier sa politique de repli sur soi et à interdire aux Juifs de quitter le Yémen. À partir de l’année 1934, le mufti de Palestine Hadj Amin al Husseini (1895-1974) se rendit au Yémen et exhorta l’imam à durcir cette interdiction. Néanmoins, de nombreux Juifs gagnèrent clandestinement la frontière vers des territoires du protectorat britannique où ils attendirent des visas leur permettant d’immigrer en Eretz Israël. […]»
Les Juifs n’étaient pas «chassés» du Yémen ; au pire, étaient-ils empêchés de le quitter. Avec une vigueur toute relative d’ailleurs, car «l’imam Yahya, qui ne parvenait plus à assurer la subsistance de son peuple, ferma les yeux sur l’émigration des Juifs et des musulmans vers Aden. L’Agence juive envoya même Yossef Ben David au Yémen et ce dernier encouragea nombre de jeunes à immigrer en Eretz Israël. En conséquence, de 1943 à 1945, plus de cinq mille Juifs immigrèrent en Eretz Israël, et environ autant partirent pour Aden et s’y installèrent. Ils exercèrent des métiers qui existaient dans cette ville, à l’instar de milliers d’immigrants musulmans du Yémen employés à des travaux d’intérêt public dans la ville. La fin de la guerre mondiale interrompit l’émigration en Palestine. Les réfugiés juifs demeurèrent au Yémen au cours des années suivantes et n’immigrèrent en Israël qu’après l’indépendance de l’État. […]»
- Nous sommes loin du pogrom. Pour autant, le Yémen était-il un eldorado pour les Juifs ? Ni plus ni moins que pour les autres Yéménites. (Le principe qui consiste à considérer les «restrictions» qui frappent les Musulmans dans les dictatures arabes comme plus tolérables, plus admissibles, plus normales, que celles dont sont victimes les autres confessions mériterait psychanalyse, mais Freud est, hélas, mort.) « L’éloignement du Yémen des principales zones belligérantes, ainsi que la neutralité affichée par l’imam Yahya dès l’ouverture des hostilités, aboutirent au fait que l’influence directe de la guerre sur le Yémen fut des plus limitées. Mais, du fait de la guerre, la situation économique et physique au Yémen se détériora considérablement, et plusieurs centaines de milliers de personnes périrent entre 1941 et 1943. La plupart s’enfuirent vers la zone britannique et dans la ville d’Aden. La conjonction de ces circonstances et de la situation en Europe permit à des milliers de Juifs du Yémen d’émigrer à Aden, puis en Eretz Israël.[26] »
L’article est long et riche. Ceux qui veulent en savoir plus sur ces Juifs du Yémen (dont un descendant, Ygal Amir, tua l’un des plus grands hommes de paix qu’Israël a enfantés, Yitshak Rabin) pourront le consulter sur le site Cairn.info[27]. Au pire de la répression, les dirigeants du Yémen empêchèrent sans zèle excessif les Juifs de s’en aller. Cela se transforme dans la glose de Cyrulnik en croisade pour les « chasser ». Si ce psychiatre lisait dans la tête de ses patients aussi bien qu’il interprète une documentation écrite et foisonnante, il serait prudent de vérifier la santé de ceux qui sont passés par son cabinet. Cyrulnik ment ; et il sait qu’il ment. Ses mensonges ne portent pas sur une menue question. Il vise à montrer que les Palestiniens et les musulmans de la région sont responsables de tout ce qu’il leur arrive. Pour preuve, disent-ils, n’ont-ils pas été les inspirateurs de la solution finale ?
Le nazi en maître : le Mufti de Jérusalem
Parfois, «relire» et «rappeler» deviennent superflus, tant la vérité semble s’imposer d’elle-même : «On ne va pas, explique Sansal, rappeler les liens entre le régime nazi et l’association des Frères musulmans, et au-delà avec l’ensemble du mouvement islamiste à travers le monde dirigé en ces temps-là par le Grand Mufti de Jérusalem. Entre nazisme et islamisme, il y a donc une proximité idéologique et un fondement historique. Aujourd’hui encore, chez les islamistes, on évoque avec sympathie Hitler et sa légendaire haine de la démocratie, du Juif, du faible, du cosmopolite.»

Benyamin Netanyahou a frayé dans les mêmes eaux. Il avait expliqué, dans un discours mémorable, que si Hitler a entrepris d’exterminer les Juifs, c’est un peu de mauvaise grâce, simplement parce que le Mufti de Jérusalem le lui demandait. C’est cela le propre des idéologues forcenés. Quand la vérité dérange, il faut l’ignorer et lui substituer un mensonge commode, à répéter un nombre de fois suffisant pour qu’il soit pris pour la vérité. Concernant Netanyahou, ce sont ses compatriotes qui l’ont rappelé à l’ordre, scandalisés qu’on fasse si peu cas de la mémoire des six millions de Juifs exterminés et des monuments mémoriaux que ses propos voueraient à la démolition, fondés qu’ils seraient sur un substrat erroné. Qui se soucie de faire ravaler ses mensonges à Sansal ?
Personne. Pas même David Grossman avec qui il préside une association «pour la paix» impossible ; Grossman qui découvrira peut-être s’être engagé avec un encombrant partenaire, dans une dynamique qu’il lui sera difficile de stopper sans écrouler sa propre crédibilité. «Les mots ont un sens» proclamait Sansal sans en être convaincu ; oui…, et « les faits sont têtus ». Sansal ne peut en aucun cas contribuer à la paix. Dans une paix – sinon des cimetières –, il y a deux protagonistes. Sansal serait parfaitement indiqué pour servir de passerelle entre les ultra-sionistes et les ultrareligieux dont il partage les idées, les idéaux et les objectifs et les pacifistes tels que David Grossman ; il ne l’est pas du tout pour restaurer les liens entre des Palestiniens qu’il tient en horreur et les Juifs. Il est parfait pour dynamiter les ponts et ériger des murs ; inadapté pour toute entreprise de paix avec les Arabes, les Musulmans, les Palestiniens, les Méditerranées, les « cueilleurs-chasseurs », les mangeurs d’insectes, etc.
- La collusion arabo-nazie. Les Arabes responsables de la Shoah. Le Mufti de Jérusalem qui hérite rétrospectivement d’un pouvoir incroyable sur le Führer ! C’est commode par les temps qui courent ! La France avec Daladier, Pétain, Laval et Vichy, l’Angleterre avec Chamberlain, les russes avec Staline et ses charniers, les Italiens avec Mussolini, les Espagnols avec Franco, le Vatican avec Pie XII, les Suisses avec leurs banquiers, les Croates avec les Oustachis, les Ukrainiens avec leurs miliciens, etc. ; le monde entier conspirait à qui mieux mieux avec Hitler. Dans de nombreuses capitales, on espérait secrètement que les Nazis mèneraient à bien leur projet d’extermination des Juifs. Le Mufti de Jérusalem devrait-il être le seul à s’interdire le «pragmatisme» qui s’est emparé de toutes les nations du monde ? D’autant que les dirigeants des capitales occidentales ne concevaient la Palestine comme destination de choix pour les Juifs que parce qu’ils n’en voulaient strictement pas chez eux[28]. Mais, au fait, quelle était l’attitude des Juifs même, qui permettrait de mesurer par comparaison l’inconséquence du Mufti de Jérusalem ?
«C’est […] l’une des pages les plus ambiguës de l’histoire d’Israël avant Israël. En juin 1933, Ben Gourion envoie en effet à Berlin Victor Haïm Arlozorov, trente-cinq ans, chef du département politique de l’Agence juive, une des figures centrales du Yishouv. Un leader brillant, séduisant, que Ben Gourion apprécie tout particulièrement. Objectif : négocier avec le régime nazi le transfert vers la Palestine des Juifs allemands et de leurs biens. Le mot "négociation" semble parfaitement fou entre les représentants d’un peuple qu’Hitler, chancelier depuis quelques mois, destine alors secrètement à la mort et ses futurs bourreaux. Néanmoins, c’est bien de cela qu’il s’agit : l’opération Ha’avara ("transfert" en hébreu). Certains officiels nazis y sont favorables. Un accord est signé, qui sera abrogé par Hitler en 1937. Pourtant, quelques milliers de juifs allemands parviendront à gagner la Palestine, moyennant ce que Tom Segev appelle un "marché avec le diable".
Le journaliste Marius Shattner, auteur d’une Histoire de la droite israélienne, résume le dilemme : "L’accord aillait permettre le transfert de capitaux juifs allemands d’un montant de 40 millions de dollars, en échange de l’achat d’équipements agricoles et industriels allemands. Sur les quarante-cinq mille juifs allemands qui immigrèrent en Palestine entre 1933 et 1939, vingt mille bénéficièrent directement de la Ha’avara, qui contribua de façon substantielle au développement du Yishouv. L’organisation sioniste devenait ainsi la première à ouvrir une brèche dans le boycott des produits allemands, décrété en réaction à l’antisémitisme du nouveau régime nazi par différentes associations juives. Jabotinsky avait été l’un des seuls dirigeants sionistes à soutenir le boycott". En effet, dès que le leader de la droite révisionniste apprend les rumeurs sur la Ha’avara, il s’y oppose de toutes ses forces, au nom de la dignité juive. Le journal du groupuscule d’Abba Ahiméir se déchaîne contre Arlozorov, le "diplomate rouge qui se roule aux pieds des nazis". Le 16 juin 1933, quarante-huit heures après son retour de Berlin, Haïm Arlozorov est assassiné alors qu’il se promenait, vers 22 h 30, sur la plage de Tel-Aviv avec son épouse Sima. […] Le meurtre de Haïm Arlozorov restera le premier assassinat dans l’histoire politique du sionisme.[29] » Contre les siens, bien entendu.
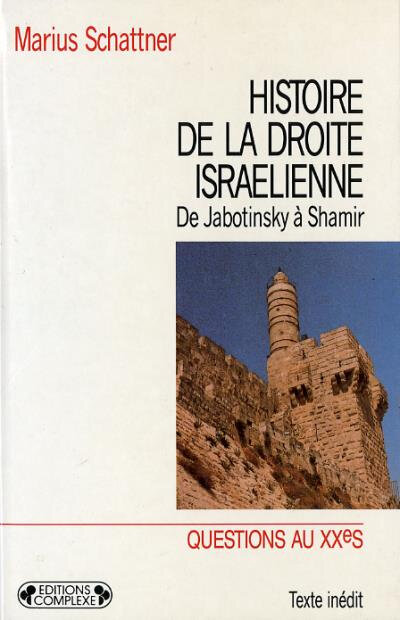
Mais peut-être que les leaders juifs ignoraient quels étaient les projets d’Hitler à leur égard. Peut-être n’ont-ils simplement pas lu Mein Kampf où ce qui les attendait était écrit noir sur blanc. Ils auraient à leur décharge que Wikipédia n’existait pas encore… Ils mettront du bout des lèvres le meurtre d’Arlozorov sur le dos large des Arabes. Lorsque Yitshak Rabin est assassiné, son épouse Léa dira que ce meurtre est le second du genre ; le premier : celui d’Haïm Arlozorov.
- La première organisation terroriste dans la région, coupable de tant d’attentats et d’exécutions sommaires, avait pour nom Irgoun. Son chef, Menahem Begin, deviendra le Premier ministre d’Israël qui dédaignera la main tendue d’Anouar el-Sadate ; il freinera des quatre fers les pourparlers qui pouvaient alors déboucher sur la paix. «Différents groupes s’agglutinent autour de l’Irgoun : celui d’Abraham Stern, abattu par un policier anglais en 1942, et celui des combattants de la Liberté d’Israël, le Lehi, autour d’Itzhak Shamir, futur Premier ministre de l’État d’Israël. Le groupe Stern considère qu’il faut se battre contre les Britanniques, même s’ils sont les adversaires des nazis. Abraham Stern ira jusqu’à tenter une démarche auprès d’émissaires du Reich à Beyrouth pour proposer un engagement aux côtés de l’Allemagne, pourvu qu’on l’aide à créer un État juif en Palestine.» Chaïm Weizmann occupera les plus hautes fonctions en Israël. En 1947, il dit « au journaliste C.-L. Silzberger qu’il regrette le terrorisme juif, que le Stern se compose "d’idéalistes dévoyés" mais l’Irgoun de "bandits ordinaires", et que Ben Gourion est un "damné fasciste".[30] »
Le terrorisme est aujourd’hui devenu si quotidien que l’on oublie comment il fut introduit dans cette région. L’administration britannique en Palestine avait un parti-pris flagrant pour les Juifs. Pourtant, « cette coopération cesse le 21 juillet 1946 quand l’aile gouvernementale de l’Hôtel King David est soufflée par une gigantesque explosion. Des décombres, on retire 99 morts et 50 blessés. La Haganah, qui a participé à la préparation de l’attentat, dégage ses responsabilités en accusant l’Irgoun, maître d’œuvre de l’exécution de l’opération, de n’avoir pas prévenu en temps voulu, comme cela était prévu. […] L’Irgoun applique en effet la logique implacable du terrorisme, reprise plus tard par les résistants palestiniens. Un attentat doit frapper l’opinion publique par son horreur même.[31] »
Les lectures a posteriori sont dangereuses ; entre les mains d’un faussaire, elles provoquent souvent des dégâts plus importants que ceux qu’elles prétendent prévenir. Il y a ainsi le passé sans cesse ré-écrit par Sansal et Cyrulnik, à la mode orwellienne, pour coller aux conjonctures biaisées du manipulateur ; et il y a le présent plus malléable encore…
La Judée, la Samarie, Hébron, sites juifs en danger selon Cyrulnik
« […] Ce qui m’amène à penser que l’ONU n’est pas fiable, et l’Unesco non plus. Ce sont des institutions internationales complètement noyautées, qui prennent des décisions invraisemblables, trafiquant l’histoire… Dans ce domaine, je rappellerai une décision récente consistant à affirmer qu’il n’y a jamais eu de Juifs au Proche-Orient avant Israël, alors qu’un million et demi de Juifs ont été chassés des pays arabes sur ordre de Nasser tandis qu’ils se croyaient égyptiens. […] » C’est Boris Cyrulnik qui s’exprime ainsi ; déclaration au vu de laquelle les institutions internationales seraient devenues des nids antisémites et négationnistes. L’ONU et l’Unesco auraient affirmé « qu’il n’y a jamais eu des Juifs au Proche-Orient avant Israël » ! C’est aussi sidérant qu’invraisemblable. C’est bien évidemment faux. Et deux ou trois clics suffisent pour connaître l’intégrale vérité, y compris, si l’on franchit le désormais « obstacle » Wikipédia pour écrivain paresseux, en consultant par exemple les sites du Point ou du Figaro, qui ne sont pas de farouches pro-palestiniens…
- Avant de remettre les pendules à l’heure, on peut tenter de comprendre comment fonctionne la Science selon Cyrulnik. Car sa saillie survient quelques pages après que Sansal a souligné l’incongruité de voir la présidence de la commission des Droits de l’homme de l’ONU accordée à l’Arabie saoudite, pour disqualifier l’ensemble de l’œuvre de l’organisation internationale dont les résolutions condamnent la politique israélienne de colonisation des «Territoires» palestiniens. Des résolutions signées par l’écrasante majorité des pays, mais qui butent systématiquement contre le veto US. La conception de l’objectivité selon Cyrulnik consiste à donner foi aveugle (au sens religieux du terme) à la partie vers laquelle son cœur balance, y compris dans les déclarations les plus iniques. Voici l’information factuelle : «L’Unesco a déclaré vendredi la vieille ville d’Hébron, en Cisjordanie occupée, "zone protégée" du patrimoine mondial en tant que site "d’une valeur universelle exceptionnelle en danger". L’agence onusienne s’est aussitôt attiré les foudres d’Israël.»
Puis la réaction sans nuance de Benyamin Netanyahou : «Cette fois-ci, ils ont estimé que le tombeau des Patriarches à Hébron est un site palestinien, ce qui veut dire non juif, et que c’est un site en danger». Et voici enfin le commentaire d’un journaliste neutre : «Hébron abrite une population de 200 000 Palestiniens et de quelques centaines de colons israéliens, retranchés dans une enclave protégée par des soldats près du lieu saint que les juifs appellent Tombeau des Patriarches et les musulmans Mosquée d’Ibrahim. Les Palestiniens estiment que le site est menacé en raison d’une montée "alarmante" du vandalisme contre des propriétés palestiniennes dans la vieille ville. Ils l’attribuent aux colons israéliens. Un vote favorable de l’Unesco "aiderait à soutenir le tourisme" et "les efforts des Palestiniens à empêcher toute tentative de destruction", avait estimé avant le vote de vendredi Alaa Shahin, membre de la municipalité d’Hébron. En un demi-siècle d’occupation israélienne, Hébron est devenu un lieu de conflit permanent. Quelques centaines de colons protégés par des centaines d’autres soldats vivent dans un réduit au centre-ville qui est partiellement interdit d’accès pour les Palestiniens. »
Rappelons a minima que Hébron se situe en Cisjordanie, territoire revenu à la Palestine lors du partage qui a donné lieu en 1948 à la création d’Israël. Disons aussi que c’est le seul endroit au monde où la colonisation qui fleure bon l’apartheid se déroule à visage découvert, justifiée par cette unique et étrange raison pour qui se prétend laïc : c’est Dieu qui a dit aux Juifs que cette terre, extensible à l’infini, est la leur. Pour y assurer la sécurité des colons, l’armée israélienne ferme des quartiers entiers, après en avoir expulsé ses habitants palestiniens ou simplement en leur coupant le passage. Sous les effets d’une loi naturelle qui s’appelle « entropie », les lieux se dégradent ; ce qui justifie aux yeux des colons de se les approprier, puisqu’inhabités ; de les réhabiliter, après les avoir annexés.

Sauve-toi, la vie t'appelle
Même le plus acharné des sionistes qu’est Benyamin Netanyahou se montre plus modéré que Cyrulnik. Cyrulnik, plus indécrottable royaliste que le roi ; et plus menteur qu’un arracheur de dents. Pour expliquer que la paix est impossible en Méditerranée. Au même moment où sort le livre du duo Cyrulnik-Sansal, un autre de ces adeptes de la « résistance» contre les impuissants, Mohammed Sifaoui, publie un ouvrage de même veine. Peu avare en philosémitisme appuyé, Sifaoui n’en prétend pas moins se méfier «toujours lorsque l’"amour" s’exprime de façon ostentatoire et dégoulinante. "Le m’as-tu vu comme je t’aime !" cache souvent des failles psychologiques liées à des pères ou des aïeux ayant torturé (des Algériens) ou déporté (des Juifs).[32]»
L’amour pour Israël selon Sifaoui se doit d’être relativement discret quand Sansal en rajoute dans le « m’as-tu vu ! ». Sur cette « terre promise » au « peuple élu », les Arabes semblent relever d’entités abstraites, en attendant qu’une solution plus expéditive à leur égard soit élaborée pour permettre aux injonctions divines de se concrétiser. Les pogroms et les génocides n’attendent que les circonstances…
- La guerre de 1948 en Palestine a jeté hors des frontières plus d’un million d’âmes. Il restait quelque 150 000 Arabes en Israël. Un numéro des Temps Modernes de Jean-Paul Sartre donne sur 992 pages la parole à des personnalités arabes et israéliennes. En voici un : «Je ressens parfois une gêne à écouter les Juifs parler dans la rue. "Que font donc les Arabes dans ce pays ? disent-ils. Ce sont tous des espions", et mille autres choses de ce genre. Je dois faire un effort pour ne pas abonder dans leur sens, parce que c’est dans cet esprit que j’ai été élevé, et cette réaction m’est naturelle.
Pourtant, ces mêmes Juifs, que n’ont-ils souffert lorsqu’ils vivaient au sein de la diaspora ? Qui ne se souvient des calomnies raciales ? Si un Juif de Damas commettait un délit, les Juifs du monde entier en étaient les complices. Aujourd’hui, lorsqu’un Arabe saute clandestinement d’un train, le lendemain, tous les Arabes sont coupables, tous sont des espions. Autrement dit, le citoyen arabe en Israël est victime, aujourd’hui, des mêmes préjugés et des mêmes généralisations que le peuple juif autrefois." […] On trouve aujourd’hui une loi qui n’a pas d’équivalent dans aucun autre pays – pas même en Afrique du Sud et en Rhodésie – c’est la loi de l’absent-présent. Aux termes de cette législation, toute personne ne pouvant faire la preuve de sa présence physique en Israël à la date du 29 novembre 1947 (jour de l’approbation du plan de partage de la Palestine par l’Assemblée générale des Nations unies) doit être considéré comme absente. Ce qui signifie que les Arabes ayant quitté, pour des raisons contraignantes, leur résidence habituelle, sont catalogués comme des "présents-absents". […] Les Arabes étaient donc tenus de prévoir, dès avant le 29 novembre 1947, qu’ils seraient déchus au rang de "citoyens fantômes" par le caprice d’un texte rétroactif qui viendrait sanctionner, avec trois ans de retard, des déplacements dont ils n’avaient à rendre compte qu’à eux-mêmes.
À ce sujet, voici l’opinion du Dr. Amnon Rosenstein, juriste israélien, telle qu’il l’exprime dans le quotidien Haaretz (La Terre) du 3 septembre 1965 : "Arrêtez dix passants dans la rue de Tel-Aviv et demandez-leur : qui sont ces… absents ? Neuf d’entre eux hausseront les épaules et vous regarderont comme un fou. La grande majorité de la population israélienne croit que les ‘réfugiés arabes’ sont des gens qui ont quitté Israël pour les territoires arabes avoisinants, au cours de la guerre de Libération. Rares sont ceux qui connaissent l’existence, parmi nous, d’une catégorie de réfugiés ‘absents’, bien qu’ils n’aient jamais franchi les frontières d’Israël. […] Les absents ont le droit de posséder un passeport, ils payent leurs impôts, ils sont astreints à l’obligation de loyauté envers l’État d’Israël, mais ils vivent néanmoins dans un vacuum juridique. Il y a même des députés arabes au Parlement, qui participent à la préparation et au vote des lois, et qui sont considérés comme ‘absents’ d’après ces mêmes lois à l’élaboration desquelles ils contribuent."[33] »
Les contraintes de la paix israélo-palestinienne sont soumises à la même tension qu’une ligne de haut voltage par rapport à la terre qu’elle franchit sans encombre à condition de garder ses distances avec elle. Le tout tient à cette bande d’isolation… Il y a d’une part les nécessités de la colonisation, qui riment avec apartheid, massacre, expropriation, un racisme anti-arabe sans équivalent. Et il y a – si tant est qu’il existe une mission divine allouée aux Juifs – la mission de paix, de Lumière, de justice sociale. Une injonction qui dit : «Tu n’opprimeras point l’étranger ; vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous avez été étranger dans le pays d’Égypte.» (Exode 23, 9.)
Sous quelque angle que l’on examine la question, Israël est le fruit d’un péché originel.
Un péché à trois volets, la décision d’octroyer aux Juifs persécutés en Europe une terre d’asile sur le territoire d’un autre peuple était le moindre. La manière dont cette implantation se déroula en fut un autre. Le troisième constitue le poison qui, une fois que les Palestiniens se sont fait une raison de la scission du pays, empêche Israël de devenir un pays normal. Un pays où le peuple peut vivre en paix ; avec ses voisins certes mais, surtout, avec lui-même. L’engrenage s’est enclenché dès le départ : pour assurer la viabilité de l’entreprise, il fallait coaliser des tendances qui nourrissent les unes aux autres une hostilité séculaire. Les laïcs et les religieux ; et dans chacune des tendances, les modérés et les radicaux. Avec à terme le triomphe du paradigme religieux au détriment du politique, l’ascendant des belliqueux sur les pacifiques : le seul registre qui permette aux leaders de justifier la poursuite du conflit, découlant de ce péché originel, consiste à mettre leur aventure collective sur le compte de la volonté divine. Et, en cela, la classe politique israélienne a fait siens les méthodes de leurs homologues arabo-islamistes les plus radicaux. À un point tel, explique Martine Gozlan, que « le sacré des ultra-orthodoxes, en Israël, oscillerait entre le mimétisme chrétien et le mimétisme islamique des Juifs orientaux et du Shass, le parti séfarade […] à l’obscurantisme crypto-iranien.[34] »
- La bascule s’est opérée en 1967. «Depuis cette victoire "trop facile", due à de bons soldats ou à de très mauvais ennemis, mais due surtout au fait qu’Israël n’a d’autre alternative que de vaincre ou de mourir, les Israéliens ont appris à leurs dépens que les retournements de tendance se font toujours en faveur de l’humilié. Ainsi, à l’isolement politique et géographique, s’est ajouté l’isolement psychologique. La nouveauté politique qui a découlé de ce troisième affrontement entre Juifs et Arabes fait qu’Israël – qui pourtant en a les moyens – ne peut aller au-delà de ce que cette victoire de juin 1967 lui a permis d’acquérir sur le terrain. Occuper Amman ou Damas, voire Le Caire, ne serait pas impossible, quand bien même les Arabes auraient reconstitué, avec l’aide des Russes, des Américains ou des Français, leur potentiel militaire d’avant juin 1967. Mais ce serait pour un Israël isolé et déjà condamné par l’ONU courir le risque d’un véritable suicide.[35]»
Pour éviter un «véritable suicide», les leaders israéliens s’engagent dans un suicide à petit feu. Ils iront bien au-delà des territoires conquis en 1967, mais par expansion aussi lente qu’inexorable. Nous sommes en 2020 au stade de l’annexion de la Judée et de la Samarie, de la vallée du Jourdain dans son intégralité. Avec, au terme de chaque victoire-annexion, une excroissance qui grossit au sein de la «pureté juive» : une population arabe israélienne que l’on ne veut pas intégrer mais que l’on ne peut chasser sans atteindre le dernier degré du suicide : un suicide analogue à la solution finale préconisée par les Nazis pour exterminer les juifs mais qui fut la goutte qui déversa le vase de l’alliance pour leur propre destruction.
La pomme croquée contenait un «ver»
Après la défaite de 1967, les leaders palestiniens mettront deux décennies pour se résoudre à partager cette terre ; les Israéliens n’ont pas attendu si longtemps pour reconsidérer leur position ; mais en sens inverse : ils veulent maintenant le gâteau entier. La victoire de Tsahal sur une large coalition arabe était miraculeuse ; pourquoi s’arrêter à si bon chemin ? Mais «l’inclusion d’un grand nombre d’Arabes dans l’État d’Israël, après la guerre de juin 1967, constitue une réelle menace pour l’avenir de notre pays[36]», prévient d’emblée Moshe Dayan. Ils étaient 150 000 en 1948 qui ont échappé aux pogromes ; ils sont déjà 300 000 avant la guerre de Six jours ; l’annexion des territoires palestiniens a porté leur nombre à plus de 1,3 million. Des arabes avec un taux de fécondité de plus de 5, parmi une population juive qui peine par la sienne à maintenir ses effectifs constants. Une victoire à la Pyrrhus ? Les élites civiles juives ont cela de particulier que leurs résistants ont droit à la parole ; et ceux-ci plaident pour la paix. Mais ce sont les politiques et les militaires (les premiers étant les seconds) qui décident ; et eux poussent pour une colonisation à outrance. La fracture entre les intérêts du peuple et ceux des élites vient d’apparaître. Elle ira s’élargissant.

Moshe Dayan
Les réalités objectives et les arguments rationnels sont impuissants face à ceux que meuvent les élans messianiques ; quand Dieu est à la manœuvre, que peut redouter l’homme pieux ? Quarante ans après, les craintes de Moshe Dayan ont débouché sur des perspectives cauchemaresques. «Si rien ne se passe dans dix ans, prévient Daniel Bensimon, Israël cessera d’être un pays juif ! Les Arabes sont cinq millions, nous sept millions. Sans solution politique, en 2035, les Palestiniens seront cinquante-cinq pour cent et nous quarante-cinq. Le rêve sioniste sera anéanti. Est-ce que je suis venu ici pour vivre comme au Maroc ? Ce n’est pas pour ça qu’on a fait la révolution sioniste ! La politique, c’est le compromis. Si on ne sépare pas cette terre avant 2030, c’est fini ! Il y aura un Premier ministre palestinien et une majorité palestinienne à la Knesset ! Ce serait une insulte à Herzl et aux vingt mille soldats tombés pour l’État juif ! Pour garder le caractère juif de l’État, je répète qu’il faut une solution politique.[37]» La Politique, c’est le compromis. Quand la paix est impossible, la politique cède le pas à la guerre inévitable. Les Juifs seront alors réduits à fonder leur existence sur la capacité des monarques du Golfe passés dans leur camp à résister à la vague populaire, islamiste ou révolutionnaire, qui menace de les submerger. Ils devront surtout compter sur un soutien indéfectible d’une puissance US devenue un géant aux pieds d’argile.
L’Histoire récente a montré aux Israéliens que les USA n’étaient pas un allié des plus fiables. Ce qui les motive, ce qui meut l’oligarchie qui les commande, c’est l’intérêt pragmatique. Les USA ne sont plus qu’une armée mercenaire[38] au service du commanditaire le plus solvable. Ils ont compris que la bipolarisation entre deux blocs surpuissants qui se neutralisent n’est plus lucrative ; ils préfèrent désormais s’attaquer aux plus faibles[39]. Il serait injuste de mettre sur les temps présents les torts qui furent ceux du passé ; mais le racisme est un mal insidieux ; il s’efface quand il faut, pour rejaillir plus virulent encore au moment opportun ; le racisme a besoin de boucs émissaires ; une bonne campagne de relations publique et le tour sera joué : le bouc émissaire d’hier peut vite devenir le bouc émissaire de demain. Ce sont quelques images de massacres qui n’ont jamais eu lieu, avec des cadavres réels mais exhumés des cimetières pour les besoins de la manipulation, qui ont permis aux dirigeants roumains à Timisoara[40] de berner l’opinion mondiale et de consolider un régime seulement délesté de ses encombrants Ceausescu. Ce sont les larmes de crocodile d’une fausse « infirmière » mais vraie nièce d’un dignitaire de l’ambassade du Koweït à Washington, relatant la façon dont les soldats irakiens ont extrait de leurs couveuses des nourrissons pour les jeter à terre, qui ont ébranlé le Sénat américain au point de le pousser à donner son vert à une guerre du Golfe dont il ne voulait pas.
- Les soldats irakiens n’ont jamais jeté le moindre bébé à terre mais la guerre du Golfe a bel et bien eu lieu. Les Irakiens ont même eu droit à un deuxième round, encore plus meurtrier, fondé sur des armes de destruction massive inexistantes[41] ; Colin Powell, le chef d’état-major US, en a pourtant apporté la « preuve » devant l’instance internationale la plus sublime, en brandissant une fiole censée suffire pour provoquer l’hécatombe. La fiole ne contenait qu’un liquide coloré inoffensif mais la guerre qu’elle documentait n’a pas fini d’allonger la litanie de ses millions de victimes. Si une vague barbare devait fondre sur Israël, dont il doive absolument se prémunir, pourra-t-il compter longtemps sur un soutien indéfectible des USA ? La combinaison d’une force ultrareligieuse et d’une autre, mue par un sionisme exacerbé, pour sauver un peuple poussé dans ses derniers retranchements, la Bible et la mémoire de la Shoah réunies, les haines recuites, le souvenir de massacres dont les charniers exhalent encore les tourmentes, tout cela est en passe d’ouvrir la boite de Pandore de tous les holocaustes. Et dans cette région du monde, c’est le fonds et les technologies qui manquent le moins.
1947 : voilà les Juifs installés de jure par les Nations unies, selon la décision du prince. 1967 : les voilà devenus une puissance militaire implacable. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît », telle était la ligne de conduite initiale. Elle s’est transformée en ceci : invoque une loi qui arrange les tiens, et la loi contraire pour tes ennemis. Ou encore : Justifie la création d’Israël, renforcée par une alya incessante, par « la loi du retour » ; et interdis à ceux que tu expulses de leurs maisons de se faire prévaloir d’un droit équivalent. La contradiction n’échappa pas aux pères fondateurs de l’État hébreu. Elle rendait impossible l’élaboration d’un Constitution claire sur la base de laquelle ses citoyens peuvent trouver des repères légaux. Israël avance donc comme un éléphant dans un magasin de porcelaine sur la « foi » d’une simple « déclaration d’Indépendance », floue et modelable à souhait, sans frontières ; qui se donne le monde entier comme possible horizon.
Si Dieu a prescrit cette terre pour les Juifs, l’humanité n’exonère pas de quelque miséricorde pour les « étrangers » qui y vivent. La raison du plus fort est toujours la meilleure, et Israël est sans conteste le plus fort. Militairement, politiquement, médiatiquement… Comment justifier le mauvais sort réservé à une population dont on ne veut pas ? Il suffit de la dire barbare… Au mépris des réalités.
Géostratégie du condamné
Voici un épisode relaté par David Ben Gourion lui-même, qui témoigne mieux que tout du degré de « férocité » des Arabes au moment même où se déroulait la campagne de leur expulsion sauvage : «À 11 heures du matin nous avions reçu la nouvelle que quatre de nos colonies de goush Etzion avaient été occupées par les Arabes. Les femmes, les blessés et les non-combattants avaient été libérés puis renvoyés dans les quartiers juifs de Jérusalem et les hommes faits prisonniers.[42] » De quoi relativiser lourdement la barbarie des Arabes.

Goush Etzion
Les banlieues de France, dans la glose de Sansal, sont des nids d’antisémites, grouillant de fanatiques islamistes désireux d’exterminer les Juifs. Il faut à ces derniers une terre l’élection et l’alya présente le double avantage : un havre en Israël pour les Juifs persécutés et des Juifs en nombre pour renforcer les effectifs d’Israël : un pari gagnant-gagnant, pour contrecarrer la tendance qui fait des Juifs une petite minorité dans un océan d’Arabes. Il y a ensuite la natalité. Le taux de fécondité des juifs orthodoxes, qui enfantent de 6 à 12 enfants par couple, en fait depuis des décennies les arbitres dans la formation des gouvernements. Ils pourront à terme accéder eux-mêmes aux commandes. Seule la natalité des Arabes israéliens rivalise avec la leur.
La démocratie présente ainsi un double danger : si les Arabes disposent de la pleine citoyenneté – en admettant le présupposé que les élections se règlent sur des critères ethniques –, ils pourront dans quelques décennies acquérir la majorité des suffrages ; dans le cas d’un double collège d’électeurs, ce sont les Juifs orthodoxes qui l’emporteront. La composante sur laquelle repose l’État aujourd’hui, avec une natalité de 2, peine à renouveler ses effectifs ; on sait ce que vaut sa « pureté » dans l’esprit de ultrareligieux. Le salut viendrait d’un État où les critères religieux et ethniques sont négligés au profit de l’intérêt bien entendu de citoyens égaux et libres, dans une démocratie véritable ; ce n’est pas la trajectoire que dessinent Sansal et Cyrulnik.
Il reste, pour peupler le pays, le réservoir sur le point de se tarir de la diaspora. Et chaque vague d’immigration qui arrive est confrontée à l’exiguïté des lieux ; pour installer les nouveaux venus, il faut ouvrir de nouvelles colonies, annexer plus de territoires, enfermant plus d’Arabes. La dynamique statistique défavorable se poursuit, inexorable, pour laquelle il faut plus d’alya, plus d’annexions, plus de colonies, plus d’occupation ; l’alya appelle l’alya, pour une ligne de fuite qui ne désigne pas la paix au terme de la politique de la terre brûlée. Il est suicidaire pour la Méditerranée de suivre les segmentations, prescrites par Sansal et Cyrulnik, qui la réduisent à Israël. Il l’est tout autant pour les horizons d’Israël dans leur optique arabophobe calquée sur les Juifs ultra-orthodoxes. Et si la paix y est effectivement impossible, ce n’est pas la faute des peuples Musulmans. On ne génère pas un environnement de paix en accumulant sur une petite terre tous les antagonismes du monde…
L’alya. Prenons la projection optimiste que tous les Juifs du monde se donnent la main pour migrer vers Israël. Avec quinze millions de soldats bien armés, rien ne les effraiera plus. Il y a ceux qui proviendraient d’Europe occidentale, de France justement, où des campagnes d’incitation sont régulièrement menées[43].
- Peut-être se souvient-on de la crise diplomatique provoquée par Ariel Sharon qui invitait les Juifs de France à fuir « l’insécurité des banlieues » pour trouver une terre sûre, en adéquation avec «leur âme». «Un soir de juillet 2004, raconte Emmanuel Faux, nous fûmes conviés sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. […] Il y avait là quelques correspondants français et un bon bouquet de journalistes israéliens […] Il faut dire que les personnalités annoncées étaient rien de moins que le Premier ministre de l’époque, Ariel Sharon, et l’un de ses prédécesseurs (et vieil ami) Shimon Peres […] L’événement qui réunissait les deux hommes […] l’arrivée d’un avion spécial de Paris, avec à son bord deux cents passagers, candidats à l’alya. […] Interrogés sur les motivations de leur émigration vers Israël, tous les passagers du vol spécial – absolument tous – expliquaient qu’ils n’avaient en aucun cas cherché à fuir un quelconque climat d’antisémitisme en France et que les raisons de leur alya étaient bien plus personnelles, religieuses souvent. […] On connaissait le chiffre des arrivées, impossible d’avoir ceux des départs. […] D’après les chiffres que nous avons, confie la responsable de l’opération, "il y a 37 % des familles qui repartent dans les trois premières années. – Plus d’un tiers restent moins de trois ans ? – Oui, c’est à peu près mais, attention, ce n’est pas du tout officiel, je ne vous ai rien dit […]. – En plus, j’imagine que toutes les familles qui rentrent en France ne le font pas forcément savoir, donc c’est peut-être plus. Approbation silencieuse.[44] » En 2007, le taux d’échec est passé à 43 %. L’ouvrage d’Erik H. Cohen propose une étude exhaustive de ces nouveaux pèlerins dont on disait qu’ils étaient Heureux comme Juifs en France[45].
Il y a ceux qui repartent, mais il y a ceux qui restent ; et ces derniers ne se soumettent pas à une aventure aussi lourde pour supporter en Israël le voisinage des Arabes qu’ils ont fui en France. « Pour la majorité des citoyens juifs, il ne fait désormais aucun doute que c’est le "caractère juif" de l’État qui est essentiel, et non son caractère démocratique. » Mais, sans Constitution, il revient à chacun de voir le midi de l’identité juive à sa porte.
« On emporte un peu sa ville, aux talons de ses souliers »
« Mon vœu le plus cher est de voir, un jour, Israël peuplé de trois millions de Juifs » disait David Ben Gourion au pied du Mur des Lamentations en juin 1967. « Quand Israël comptera quatre à cinq millions de Juifs, rien ne pourra l’atteindre ou menacer la réalité de son existence », renchérit le général Yitshak Rabbin la même année. « Ce dont Israël a le plus grand besoin, c’est une immigration massive de Juifs. Nous devons doubler notre nombre avant la fin du siècle », estimait de son côté Lévy Eshkol, Premier ministre au moment des faits. « Si Israël avait compté un million de Juifs de plus, la campagne du Sinaï et la guerre des Six jours auraient certainement pu être évitées », notera quant à elle Golda Meir en juin 1968.
L’ex-URSS a longtemps constitué un vivier immense pour combler le vide d’Israël. L’effondrement du mur de Berlin ouvrira la porte à qui veut partir et les Juifs se ruèrent sur les frontières. « Le flot de ces immigrants – pour beaucoup économiques – des années 1990 s’emble s’être pratiquement tari aujourd’hui avec la stabilisation, voire le renouveau économique en Russie. Mais, qualitativement, ils ont apporté plus de problèmes que de solutions. Tout d’abord, près de 40 % d’entre eux ne se définissent pas comme juifs. Nombreux sont profondément laïques, voire athées et peu empressés d’apprendre l’hébreu. Ils ont conservé leur mode de vie social et culturel avec leurs chaînes de télévision, leurs radios et leurs journaux en russe. Ils constituent, de fait, une nouvelle communauté distincte des Juifs et des Arabes. Certains de ces immigrants étaient des gens hautement qualifiés – des informaticiens, des ingénieurs, des médecins, des monteurs vidéo. Cependant, la majorité ne possédaient pas de telles qualifications. Ils appartiennent à la "racaille blanche", pour reprendre l’expression israélienne. La mafia russe, très active en Israël depuis leur arrivée, est soupçonnée de fournir des armes aux Palestiniens.[46] » Il manquait un problème à la société israélienne déjà bien embarrassée ; l’immigration russe venait de l’importer : la mafia.
Ils sont ainsi quelque 1,2 millions d’immigrants russes en 2007. «Dans l’ensemble, les Russes et les Ukrainiens ont très bien intégré le marché du travail israélien. Mieux que d’autres communautés, venues d’Afrique du Nord notamment. En même temps, les immigrants russes ont cherché à se protéger, en cultivant un fort communautarisme et en refusant d’apprendre l’hébreu. Très vite s’est développé un important réseau médiatique russophone, avec des radios émettant toute la journée et une cinquantaine de journaux dont certains ont atteint le million d’exemplaires vendus dans les années les plus fastes. […] Promenez-vous dans certaines rues d’Ashkod ou d’Ashkelon et, si vous oubliez le métro, vous pourrez parfois vous demander si vous n’êtes pas en Russie. Cela est si vrai à Ashkod qu’un quartier est connu sous le nom de Little Russia. Non seulement tous les commerçants sont originaires des anciennes républiques de l’ex-URSS, mais surtout, sur les enseignes, les vitrines, les vêtements, les portes de magasins, tout est écrit en alphabet cyrillique. Et, souvent, l’hébreu a complètement disparu.[47]»

fraternisation entre soldats israéliens et égyptiens
En scrutant une photographie de l’ouvrage de Patrick Mercillon, fixant pour l’éternité un instantané de «fraternisation entre soldats israéliens et égyptiens» au lendemain de la guerre de Six jours, l’on peut se demander si la distance qui les sépare n’est pas plus mince que celle qui existe entre les immigrants venus de Russie et ceux qui les ont accueillis au pied de l’avion à Tel-Aviv. Il y a certes la bonne santé physique de l’un et son treillis impeccable, qui contrastent avec la maigreur et la tenue quelque peu débraillée de l’autre[48] ; mais rien, vraiment rien de si rédhibitoire qu’il faille vouer des dizaines de millions d’êtres à un destin inhumain.
Quand l’être vaut plus par le décompte statistique de sa personne, la société qu’il compose peut vite perdre la «pureté» qu’elle cherche désespérément. La plupart des Juifs de la diaspora vivent dans des pays dont les conditions économiques sont meilleures que celles qu’ils trouveraient en Israël. Quel désespoir frappe celui à qui s’ouvrent les portes de ce pays parce que sa venue ramène un Juif de plus ? Quel accueil ce pays doit-il offrir à ces individus qui lui font le don de leur unité de personne ? Les incidents sont légion qui attestent que l’horloge de la « pureté » ne tourne pas si rond.
L’épisode qui suit ne se passe pas dans les Années 1957 où Dwight Eisenhower doit faire accompagner par l’armée neuf étudiants dans leur classe d’une école de Little Rock en Arkansas au milieu d’une foule hostile. Pas davantage dans celle de 1962 où J.F. Kennedy fait appel à la garde républicaine pour faire admettre James Meredith dans l’université du Mississipi.
L’affaire est autre et « lle a fait grand bruit en Israël. Elle est remontée jusqu’à la ministre de l’Éducation. En pleine année scolaire, quatre nouvelles élèves rejoignent l’école élémentaire Lamerchav de Petah Tikva où la famille vient d’aménager, après avoir vécu dans la région d’Haïfa. Mais quatre jours après leur arrivée dans l’école, les petites filles sont retirées de la classe où on les avait placées, et se sont retrouvent isolées, avec un instituteur à part, dans une salle à part, au fond du couloir, comme mises en quarantaine. Précisons que ces quatre élèves ne ressemblent pas aux autres, elles sont enfants d’immigrés éthiopiens. "Qu’avons-nous fait de mal ? Quels crimes avons-nous commis ?", demandent les parents qui protestent évidemment contre ces discriminations. "On nous traite ainsi parce que nous sommes Noirs et Sans-pouvoir", tonne le père qui s’entend répondre par la direction de l’école que les fillettes ont été séparées des autres élèves car elles n’étaient "pas assez observantes" de la religion et qu’elles ne pouvaient donc "pas s’intégrer pleinement à la communauté scolaire". Dixit le principal Yishayahou Granwich. Pour faire bonne mesure, ce dernier a même imposé aux jeunes éthiopiennes des récréations décalées par rapport à ceux des autres enfants et il a demandé qu’un les fasse raccompagner chez elles en taxi, pour éviter qu’elles puissent se faire des copines dans le bus.[49]»

école primaire de Tel-Aviv, avril 2020
Jadis les lépreux portaient des clochettes. Dans un pays sans repères stables, les scandales sont courants. Comme lorsque les mêmes éthiopiens déferlent dans les rues en apprenant que leurs dons sanguins sont systématiquement jetés. Leurs corps pour gonfler les statistiques, oui ; leur sang, non ! fût-ce pour sauver la vie des patients juifs dont le corps «pur» ne doit pas être profané. Si, du fait de pluralité de la presse, ces questions trouvent un espace au sein de la société, plus que tout autre peuple au monde, les Juifs devraient savoir que les yeux vite détournés sur une horreur n’atténuent pas la douleur infligée aux victimes. Mais les Éthiopiens d’Israël ont aussi leur propre Boualem Sansal. «À plusieurs reprises, le journaliste Dani Adino Abbeba fustige "le comportement inadmissible" de ses compatriotes. Un jour, il n’hésite pas à écrire : "Au lieu de manifester, vous feriez mieux de commencer à utiliser le préservatif et à vous faire soigner."[50]» Il faut dire que le ministre de la Santé a justifié ce refus des dons sanguins éthiopiens par le fait que les populations concernées venaient de régions à «risque». Potentiellement porteuses de Sida s’entend.
«Israël beytenou», disent les uns ; «Falestin beytena» rétorquent les autres. Beytena, beytenou… À une lettre près, cela veut dire que cette terre est «notremaison à nous». Mais quelle est donc cette terre ? Ou commence-t-elle et ou finit-elle ? Quelles sont ses règles, celles de la Bible, celle de la Torah, celle du Talmud, celles de «Moshe Halbertal, professeur d’éthique et de droit internationale de la guerre à la fois à l’université hébraïque de Jérusalem et à l’université de New York. Il joue un rôle capital dans le renouveau de la pensée orthodoxe. Dans ses discours au nom de la paix et d’un État palestiniens aux côtés d’Israël, comme dans ses écrits académiques, il s’évertue à défendre une éthique et une morale juive contre les "idolâtres" juifs qui placent la vénération de la terre biblique au-dessus des intérêts du peuple, réinventant ainsi un nouveau "veau d’or".[51] » On ne saurait, hors yeshiva et autres sectes ultrareligieuses, trouver plus grande « idolâtrie » des Juifs, plus grande vénération de la terre biblique que chez Boualem Sansal.
Israël prend l’allure d’un patchwork instable. Fort heureusement, loin du tumulte, des intellectuels de l’ombre travaillent à baliser les pistes que des hommes de bonne volonté pourront un jour emprunter. Jusqu’en 1947, la population autochtone a été tour à tour athée, païenne, juive, chrétienne, musulmane, sans que des invasions massives et des exils forcés aient conduit un « peuple » particulier à en remplacer un autre. C’est ce que s’est efforcé de montrer Shlomo Sand dans son ouvrage au titre provocateur : Comment le peuple juif fut inventé[52].

L’aventure israélienne court tête baissée vers le précipice. Sans Constitution, quand on est juge et partie, on choisit les jurisprudences qu’on veut… Ni la natalité ni l’alya ne pouvant déboucher sur des horizons certains, il reste la fuite en avant. Et une stratégie coloniale efficace : quand elles prescrivent des dispositions qui arrangent les Juifs, les résolutions des institutions internationales, les déclarations officielles (celle de Lord Balfour), sont considérées par les leaders israéliens comme des documents impératifs, auxquels les Palestiniens ne peuvent se soustraire. Elles deviennent illégitimes, nulles et non avenues lorsqu’elles ne correspondent pas à leurs visées évasives et fluctuantes.
Comme sur une route de montagne, entre Israël et la Palestine, une double ligne ; l’une du côté israélien, continue, ferme, jaune, rouge même, infranchissable, hérissée de baïonnettes, de barbelés, de mines et de soldats zélés et de propagandistes acharnés (Boualem Sansal en fait partie) ; l’autre discontinue, friable, poreuse, du côté palestinien, que les Juifs peuvent piétiner à leur guise, repousser plus loin, encore et encore, effacée, retracée, remplacée par des barbelés, des murs, des routes interdites aux Arabes, des colonies à protéger par des zones tampon qui deviennent de facto interdites à leurs propriétaires, etc. Les frontières sont étanches dans un sens, évanescentes dans l’autre.
La Science, l’Histoire, les fouilles archéologiques, leurs conclusions, valent textes sacrés quand elles vont dans le sens des colons ; elles sont inaudibles, balayées d’un revers de coude, quand elles les contrarient.
Les Arabes palestiniens ont leurs torts ; des torts qui sont ceux des faibles. Les Juifs ont la puissance des armes, de la stratégie, des technologies, de la diplomatie, de la politique, de l’argent, de la communication. Face à une telle situation, auprès de quelle partie se rangent les intellectuels ? Sansal et Cyrulnik quant à eux n’ont aucune hésitation. L’Histoire est écrite par les vainqueurs, les conquérants, les colons, les envahisseurs ; et leurs collaborateurs, les opportunistes, ceux qui ne répugnent pas à vivre en parasites, pourvu que cela soit vivre bien. Mais Israël est, de fait, un pays singulier. Il réunit mille factions belliqueuses ; il recèle aussi autant de pendants lumineux, animés par les descendants de ce peuple qui ouvrit jadis, comme le dit si joliment Martine Gozlan, «la boite de Pandore de la raison».
Quid des autres, légitimes et plusieurs fois millénaires, résidents de cette terre ?

"Armée de libération arabe" 1948
Crimes contre l’humanité : Imprescriptibles
«La création de l’État d’Israël a débuté par une épuration ethnique. L’ouverture des archives israéliennes et britanniques publiques et privées a permis l’éclosion de "nouveaux historiens" israéliens tels que Simha Flapan, Tom Segev, Avi Schlaïm, Ilan Pappé et Benny Morris. […]
Par-delà leurs différences de sujets d’études, de méthodes de travail et d’opinion, le dénominateur commun entre ces chercheurs a été de lever le voile sur les mythes de l’histoire d’Israël, et en particulier sur le déroulement de la première guerre israélo-arabe, contribuant ainsi, au moins partiellement, à rétablir la vérité sur l’exode des Palestiniens. Ils ont été suivis par des historiens arabes qui estiment que l’immense majorité des réfugiés palestiniens ont été contraints au départ au cours des affrontements israélo-palestiniens puis de la guerre israélo-arabe, dans le cadre d’un plan politico-militaire d’expulsions jalonnées de massacres. […]
En avril-mai 1948, les unités de l’Haganah [organisation paramilitaire modérée par rapport à l’Irgoun aux méthodes terroristes assumées] reçurent l’ordre précis d’expulser les villageois palestiniens et de détruire leurs maisons. Vingt-quatre massacres, dont la moitié dans le cadre de l’opération Hiram en Galilée, auraient eu lieu selon l’historien Benny Morris. […] Benny Morris évalue l’influence des différents facteurs qui expliquent le départ des Palestiniens : "Au moins 55 % du total de l’exode ont été causés par nos opérations", reconnaissent les experts militaires israéliens, qui ajoutent à ce pourcentage les opérations des dissidents de l’Irgoun et du Lekhi "qui sont responsables de 1 % de l’émigration". Si l’on ajoute les 2 % attribués aux ordres d’expulsion explicites donnés par les soldats juifs et le 1 % dû à la guerre psychologique, c’est donc un total de 73 % de départs qui ont été directement provoqués par les Israéliens, la peur expliquant les autres cas. […] Une escarmouche, avec des blindés transjordaniens servit de prétexte à une violente répression qui fit deux cents morts, dont des prisonniers désarmés. Igal Allon et Yitshak Rabin, qui commandaient les opérations militaires, interrogèrent David Ben Gourion sur le sort des civils palestiniens prisonniers. "Expulsez-les !" répondit-il. […]
Cette réponse fut suivie de l’évacuation forcée, accompagnée d’exécutions sommaires et de pillages de quelque soixante-dix mille civils palestiniens. Benny Morris affirme que des scénarios similaires furent mis en œuvre en Galilée centrale et du nord, dans le Néguev, sans oublier l’expulsion, postérieure à la guerre, des Palestiniens du port d’Al-Madjal, qui deviendra Ashkelon.
Autant d’opérations souvent ponctuées – sauf la dernière – d’atrocités. L’histoire du village de Deir Yassine est connue : 250 hommes, femmes et enfants, furent massacrés, en avril 1948, par un commando de l’Irgoun. Publiquement accusé d’avoir été l’instigateur de ce carnage, au début des années 1950, Menahem Begin, ancien chef de l’Irgoun, n’avança pour sa défense que deux arguments : premièrement, dit-il, le massacre de Deir Yassine a semé la panique et la terreur dans le cœur des Arabes et a, ainsi, provoqué l’exode de 100 000 d’entre eux de la région de Jérusalem ; deuxièmement, la Haganah, qui avait elle-même un plan pour vider la terre d’Israël de ses habitants arabes, n’a pas de leçons à donner, ayant commis elle-même, au cours de la guerre, de très nombreux massacres de population civile. Le ministre de l’Agriculture Aharon Zisling déclara, au conseil du 17 novembre 1948 : "Je n’ai pu dormir de la nuit. Ce qui est en cours blesse mon âme, celle de ma famille, celle de nous tous. Maintenant, les Juifs aussi se conduisent comme les nazis, et mon être entier en est ébranlé."[53]»

départ de population du village de Deir Yassine
Comment concilier la science à la mystique de la Bible ? Comment concilier le principe d’une terre promise d’où les Juifs auraient été expulsés avec des découvertes archéologiques qui en contestent les conclusions ? L’Histoire éclaire les hommes de bonne volonté ; elle est hélas impuissante face aux fondamentalistes qui, confrontés à une vérité dérangeante, pourront toujours chercher la plus « vraie » dans des temps plus lointains ; et, en Histoire, plus on explore, plus on s’enfonce vers des orées équivoques, des terres inconnues, qui obligent à explorer plus et à cheminer dans des territoires encore plus énigmatiques ; où les principes de la science se perdent et s’étiolent. Mais, indubitablement, les historiens défrichent des domaines qui ébranlent sérieusement les fondements sur lesquels les leaders israéliens ont construit l’identité de leur pays et justifié les méthodes avec lesquelles ils sont parvenus à conquérir des territoires. Le mythe de la «terre promise» que les Juifs seraient légitimés à reconquérir s’effondre aussi peu à peu.
La disparition des Juifs de Palestine n’aurait essentiellement à voir ni à des exils forcés ni à des massacres, mais à des raisons prosaïques : La conversion des Juifs au Christianisme d’abord, à l’Islam ensuite, aux préoccupations temporelle de tout temps. « Aucune politique concertée des conquérants [arabes] n’entraîna l’expulsion et l’exil des paysans judéens attachés à leurs terres – ni de ceux qui croyaient en Yahvé, ne de ceux qui commençaient à obéir aux commandements de Jésus-Christ et au Saint-Esprit. L’armée musulmane, surgie des déserts arabes en un typhon tourbillonnant, qui conquit la région entre 638 et 643 de notre ère, était de taille relativement réduite : selon les évaluations maximales, elle comptait quarante-six mille soldats au plus. Une partie importante de cette force militaire fut transférée par la suite pour combattre sur d’autres fronts, aux frontières de l’empire byzantin.
L’assignation sur place d’une garnison de quelques milliers de soldats entraîna évidemment le transfert ultérieur de leurs familles, et les conquérants accaparèrent sans doute des terres confisquées, mais cela ne pouvait en aucun cas causer le remaniement en profondeur de la composition démographique locale – si ce n’est, peut-être, en transformant un petit nombre de vaincus en métayers. De plus, la conquête arabe fut bien à l’origine d’une interruption décisive du commerce florissant qui s’était développé auparavant autour du littoral méditerranéen, et il s’ensuivit une lente baisse démographique qui affecta toute la région, mais aucune indication ne vient confirmer que cette réduction de population eut pour résultat un changement de "peuple".
L’un des secrets de la force armée musulmane résidait dans son "libéralisme" et sa modération à l’égard des croyances des peuples assujettis, bien entendu uniquement dans le cas où celles-ci étaient monothéistes. Les instructions de Mahomet reconnaissaient les Juifs et les Chrétiens comme des "Gens du Livre" et leur accordaient un statut protégé reconnu par la loi.
Une fameuse lettre adressée par le prophète de l’Islam aux chefs militaires en opération dans le sud de l’Arabie précisait : "Tout converti à l’islam, qu’il soit juif ou chrétien, doit être accepté comme un fidèle – ses droits autant que ses devoirs sont égaux aux siens. Et celui qui veut conserver son judaïsme ou son christianisme ne doit pas être converti, il doit payer la capitation imposée à chaque adulte, homme ou femme, libre ou esclave." Ainsi, ne faut-il pas s’étonner si, face aux persécutions sévères subies sous l’empire byzantin, les juifs accueillirent les conquérants arabes favorablement, et même avec enthousiasme. Les témoignages juifs aussi bien que les sources musulmanes mentionnent l’aide que les juifs apportèrent à l’armée arabe victorieuse.[54]»

Boualem Sansal et Boris Cyrulnik
Bref, il n’y a pas les bons d’un côté et les mauvais de l’autre ; il n’y a pas les démocrates et les barbares. Il y a un peuple, que ses élites empêchent de chercher les voies de la paix. Quant à Sansal et Cyrulnik, qui ont apporté la preuve de leur insondable ignorance, que leur recommander sinon de lire. Non pas Camus qu’ils ne semblent pas en mesure de comprendre en dépit de leurs nombreuses relectures, mais toute la littérature mondiale d’actualité brûlante, pour tenter de comprendre un monde complexe dont la subtilité leur échappe. Lire au lieu d’infliger à des lecteurs non avertis une littérature dégoulinant de haine de soi, et de haine pour son prochain. De s’octroyer une longue halte pour apprendre. De suspendre l’écriture de leur littérature niaise que des lecteurs innocents paies de leurs deniers si durement gagnés, et qui méritent meilleurs conseilleurs que des ignares patentés.
Nous avons vu que ces deux hommes sont mégalos et narcissiques. Nous avons vu aussi qu’ils étaient des faussaires. Nous avons de même compris qu’ils étaient médiocres. Et enfin qu’ils étaient dangereux. Autant de pathologies qui sont d’ordinaire le propre des tyrans. Il en est une qui les définit encore davantage : celle de grands usurpateurs.
Lapins charognards, et crème des usurpateurs
Les lapins aiment tant la lumière qu’ils dorment les yeux ouverts. La facilité avec laquelle les élites algériennes trouvent des plateaux pour s’exprimer, des journaux pour écrire, des éditeurs pour se faire publier est inversement proportionnelle à leur qualité morale et à la probité intellectuelle. Leur credo : se planquer quand les balles sifflent et jaillir pour cueillir les lauriers quand les soldats éreintés pansent leurs blessures. On ne peut pas être fourbe sans quelque talent à usurper les qualités de «résistant , d’«engagé» ; mieux, de « anceur d’alerte». Que des millions d’Algériens, las d’attendre des guides, prennent l’initiative de lancer un mouvement de résistance, et les voilà qui s’en proclament l’avant-garde.
Qu’un journaliste se fasse incarcérer et les voilà exigeant à blanc sa libération, pour ajouter une ligne à leur pedigree de «révolutionnaire », tribune à leur propre gloire. Qu’un intellectuel meure sous la torture en prison et c’est l’occasion rêvée de déplorer sa disparition pour usurper le statut de héros que le vrai héros mort ne peut plus revendiquer. Que, lasse de s’en remettre à ses élites, la population batte le pavé, et les voilà dégainant des livres rédigés en quelques semaines pour s’installer aux avant-postes de la lutte avec soixante ans de retard.
- Quant aux vrais résistants, aux opposants historiques, ils doivent s’effacer. Au résistant qui tombe mal, «une fois la porte au nez, il tombe dans l’escalier. Et l’autre passe dessus à grande enjambées. Quand il regagne la rue, après s’être relevé, il passe inaperçu. La pluie tombe sur lui, et tombe aussi la nuit» Mais les fables de Prévert sont ainsi… Ses hommes « tombent, tombent. Ils tombent comme la nuit et se lèvent… comme le jour. » Ils se lèvent, car si les édens florissants où les usurpateurs cueillent les lauriers immérités sont réservés, les terrains de guerre sont nombreux, dans un monde où l’imposture crasse détient le monopole de la culture, de l’information, de la communication ; les élites ne sont plus affectées pour élever la société, épanouir les esprits, développer la connaissance, libérer les prisonniers, soigner les blessés, désaltérer des assoiffés, mettre un peu de nourriture dans l’écuelle des démunis ; rien de tout cela, seulement gagner un pécule usurpé au moyen d’une littérature fétide, et décréter que « la paix [est] impossible » ; que la guerre est garantie.
Il est rare qu’un seul ouvrage, maigrelet de surcroît, soit si prolifique en matériau établissant autant de faits accablants sur ses auteurs. Nous avons tenté, en nous appuyant sur de nombreux auteurs à l’éthique bien forgée, de rétablir un peu de vrai là où ils se sont échinés à déverser des flots de faux ; à instiller le désordre du sens. Des auteurs bien souvent Juifs, pour désamorcer le soupçon d’antisémitisme qui permet de balayer d’un revers de clignement d’œil les innombrables griefs qu’il suffit de se pencher pour jeter à la figure d’.
Juifs aussi parce que c’est là que l’on trouve les meilleurs arguments pour réfuter la propagande en vogue, qui passe pour la quintessence de l’engagement intellectuel tout simplement parce qu’elle vocifère plus que les autres contre les démunis. Juifs encore parce que leur peuple est au cœur d’un conflit réunissant tous les ingrédients d’une crise mondiale profonde qui risque d’entraîner l’humanité vers le néant. Une crise qui peut vraiment se passer de philosophes ignorants ; une crise que des écrivains n’ont choisie comme thème de prédilection, aux côté des vainqueurs, des puissants, des riches, des initiés, toujours, que pour «parvenir» ; parvenus en empruntant des raccourcis, escamotant les dangereux parcours du combattant que doit franchir un intellectuel, un vrai pour le coup, pour faire avancer une cause d’un petit souffle d’espoir, de justice, de vérité. Il est ainsi des métiers dont les rendements sont exceptionnels ; le trafic d’armes, la récolte de diamants, le vol, le rapt, l’extorsion. Il y a dans une société saine des lois pour les mettre hors d’état de nuire. Ils sont dans le monde présent aux commandes de tous les pouvoirs de tous les pays du monde. Sansal et Cyrulnik, et tant d’autres hélas, sont les rentiers de ces commanditaires affreux. On ne peut que constater qu’ils gagnent tout, sans courir le moindre risque… Une morale glauque, des idées lugubres, des desseins abominables, et ils prétendent être les héritiers des Lumières. Il était urgent de réagir.
Outre les Juifs, les Occidentaux comme panacée
On a vu des Juifs (Yitshak Rabin) participer à l’aventure sioniste, parvenir à de hautes fonctions, et reposer leurs pieds sur terre. Elie Barnavi, ex-ambassadeur d’Israël en France, en est également un. Mais on mesure toute la difficulté qu’il y a à garder la tête froide quand tout autour de soi il n’y a que des hommes qui vous chauffent. Les mémoires de Yehuda Lancry en témoignent : Lorsqu’il rencontre Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur de Jacques Chirac, celui-ci lui confie que son empathie pour Israël a pris corps à l’occasion de l’épisode Sabra et Chatilla ; cela n’incite pas à la modération. « Pour un ambassadeur d’Israël à Paris, la communauté juive de France représente un véritable enjeu. Première au sein de l’Union européenne par son importance démographique avec plus de six cent mille membres, elle se signale aussi par une élite intellectuelle hors pair dans la diaspora juive.»
- Notons au passage que si les Juifs sont plus nombreux en France que n’importe où ailleurs en Europe, c’est qu’ils s’y sentent chez eux plus que nulle part ailleurs. Ils auraient pu être plus nombreuse encore si, au sortir de la Seconde guerre mondiale, il n’y avait pour les Juifs beaucoup à craindre d’un pays qui s’est vautré dans la compromission avec le régime nazi. Les Pieds noirs et les Juifs d’Algérie ont quant à eux préféré la France aux USA et à Israël, ce qui explique que la communauté sépharade est une minorité en Israël.
«Si le primat du judaïsme américain réside essentiellement dans son énorme pouvoir financier, poursuit Lancry, celui de France s’illustre, surtout, par son assise intellectuelle prédominante. Certes, on trouvera au sein du judaïsme américain pléthore de brillant universitaires, dont certains prix Nobel, ainsi que des écrivains de renommée internationale – Philip Roth ou Paul Auster –, mais peu d’intellectuels engagés à la française. Exception faite de Noam Chomsky et d’Elie Wiesel, aux antipodes l’un de l’autre idéologiquement, mais fortement engagés dans leur siècle, l’élite américaine agissante et influente s’exprime dans la politique par sa puissance financière. […] Dans son écrasante majorité, la communauté juive française manifeste un soutien permanent à Israël. Même son élite intellectuelle, ou du moins l’essentiel, [traditionnellement] en retrait, voire critique par rapport à la politique israélienne, finira par basculer, lors des années dures de la seconde Intifada, dans le camp du soutien. Le soulèvement palestinien orchestré par Arafat, générateur d’une vague de violence islamiste dans les franges de la communauté musulmane de France contre leurs concitoyens juifs et leurs institutions, marquera un tournant parmi les intellectuels.
À cette onde de choc bouleversante qui semble pulvériser les repères et balises du juif français en terre de France, les intellectuels naguère distants comme Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, ou ceux plus proches, à l’instar de Daniel Sibony, Alexandre Adler ou Shmouel Trigan, opposent une défense et illustration d’Israël retentissante[55].» On reconnaît là quelques-uns des «intellectuels faussaires» et «négatifs» qui ont pignon sur rue dans les médias français…
L’ambivalence des Juifs aux USA à l’égard de la politique israélienne est expliquée longuement par un auteur juif, J. J. Goldberg[56], dans un ouvrage remarquable de rigueur intellectuelle. Une longue dynamique qui a conduit l’écrasante majorité des Juifs américains, tout en tenant à la sécurité d’Israël, à s’éloigner du noyau dur des lobbys qui les représentaient. L’«engagement à la française» que célèbre Yehuda Lancry est le ver dans le fruit d’une cause israélo-palestinienne qui mérite de meilleurs ambassadeurs que Bernard-Henri Lévy et autres Alexandre Adler. Mais, outre leurs coreligionnaires qui basculent dans le «soutien inconditionnel» à Israël, Bernard-Henri Lévy et les institutions juives de France ont obtenu le renfort de bien des opportunistes, attirés par «l’élite […] agissante et influente [qui] s’exprime dans la politique par sa puissance financière» ; Boualem Sansal, Mohammed Sifaoui, etc. Faire la part des choses dans un tel environnement expose au bannissement médiatique. Une élite épurée dépeint un monde binaire : le Bien et le Mal. On sait qui incarne le Mal à leurs yeux. Mais qui n’excluent-ils pas du Bien ?
Tout sauf l’Islam ; cela laisse un milliard et demi d’humains hors champ médiatique, et dans le champ de tir
«Permettez-moi une petite digression avant d’en revenir au sujet qui nous occupe», demande Cyrulnik ; approche de pure forme, mais qui gagne deux lignes d’un ouvrage à épaissir au possible : «Je pense que l’Amérique du Sud a une typologie : l’amour de la couleur, l’amour de la musique. Ses populations gèrent ça plus ou moins bien, mais elles ont des valeurs communes qui caractérisent et font le ciment des sociétés de ce continent – y compris au Chili et en Argentine, qui sont très occidentaux. On peut quasiment tenir le même raisonnement pour les pays d’Europe du Nord ; même s’ils sont différents, on reconnaît une typologie spécifique de l’Europe du Nord – le goût de l’éducation, la lutte et la résistance au climat […]» Bref, au contraire des Arabes et des Africains, les Latino-américains et les Européens du Nord sont méritants, à épargner donc ; car ils sont «amour», «musique », «couleurs», «valeurs», «éducation», «résistance», etc. La qualité des Occidentaux se passe bien sûr de commentaire, puisque, comme les Argentins et les Chiliens, ils sont eux aussi «très occidentaux». Qui reste-t-il après avoir enduit les Africains et les Arabes de toutes les salissures ? Les Asiatiques, loin de la Méditerranée, échappent au dépouillement, et laissent la place à une potentielle «impossible paix dans le Pacifique Nord».
Toute règle a cependant son exception. Si Sansal méprise les Arabes en général, les banlieusards en particulier, les islamistes plus que tout au monde, y en a-t-il parmi eux qui trouvent grâce à ses yeux ? Nous l’avons entendu dire : «Quand le Président Sissi a interdit les Frères musulmans, et saisi leurs biens, il a été salué par les Égyptiens mais critiqué comme dictateur partout ailleurs dans le monde.» Interdire les Frères musulmans, les éradiquer au besoin, dans la rhétorique des élites médiatiques algérienne, c’est la quintessence même du Bien ; et le Bien, ça se passe de commentaire. L’on ignore comment les Égyptiens lui ont ainsi communiqué leurs pensées intimes ; des pensées sanctificatrices de la politique de celui qui leur a confisqué leur révolution et reporté sine die leurs rêves d’émancipation. Notons qu’au regard du «nous» de la civilisation que nous avons esquissée, le général al-Sissi est un tyran ; et la tyrannie y est l’œuvre de psychopathes.
Est-ce cela que Sansal apprécie chez les dirigeants Arabes, remparts contre l’islamisme ? Pas que… Il semble éprouver une prédilection pour les puissants et se montre disposé à fermer les yeux sur toutes leurs «bavures», prendraient-elles l’allure de massacres de masse, de crimes contre l’humanité : «Ce n’est pas par la guerre que les USA ont abattu l’empire soviétique, dit-il, c’est par la culture, instrument de paix par excellence, c’est en exaltant les valeurs de la liberté, de la démocratie, c’est en donnant de l’American way of life une image idyllique, c’est en accueillant royalement les dissidents de l’Est. Les armes de la paix ont gagné sur les armes de la guerre.» Les USA porte-flambeaux de la paix ; faut bien écarquiller les yeux pour le voir. Pour ceux qui veulent connaître quelques traités de paix à la mode CIA, il y a bien, pour qui veut sortir de son salon pour constater, le spectacle vivant de continents ravagés… ; il y a aussi quelques ouvrages, dont ceux de Howard Zinn, de Noam Chomsky et William Blum, ou encore de Gordon Thomas, et pléthore d’écrits de Juifs qui semble avoir échappé à la sagacité de Yehuda Lancry.
Pour avoir un regard par-dessous des réalités qu’occultent les fictions énoncées par Sansal, il y aurait l’ouvrage d’Alvin Snyder, l’un des ex-directeurs de l’agence de propagande USIA (United States Information Agency). Son titre suffit : Warriors of Disinformation. How lies, Videotape, and the USIA won the Cold War. Ou « Les guerriers de la désinformation. Comment mensonges, enregistrements vidéo et agence USIA ont permis de gagner la Guerre froide ». Quant à la propagande telle qu’elle se développe dans les médias aujourd’hui et à laquelle Sansal se donne corps et âme, il y a tant d’antidotes, dont quelques petits bijoux et indispensables lectures : Information War, de Nancy Snow[57], Blur, de Bill Kovach et Tom Rosenstiel[58] (par ailleurs auteurs de The Elements of Journalism qui pourrait instruire plus d’un éditorialiste), et tant d’autres travaux de journalistes de haute voltige ; des auteurs engagés, juifs ou non juifs, dûment censurés et placardisés, dont on peut trouver quelques articles dans des ouvrages collectifs publiés par la revue Project Censored[59] aux USA, qui trouvent quelque écho chez les éditions des Arènes[60] en France. Autant de lectures à dégoûter définitivement le plus grand épicurien de l’American way of life.
Rien de tout cela chez nos deux auteurs, qui assurent préférer l’efficacité des «coquins».
La galerie des grands hommes, selon Sansal
À la remarque de Cyrulnik sur Donald Trump, supputant sa capacité à «changer les choses», et les nécessités conjoncturelles qui font que « les coquins sont plus efficaces que les penseurs », Sansal place la barre plus haut que «l’Amérique et la Russie». Juxtaposant tautologies et anachronismes comme on enfile des perles synthétiques, il annonce : «L’Amérique est toujours l’Amérique, après un Reagan qui a libéré la monnaie de tout garde-fou et lancé la guerre des étoiles […]. La Russie est toujours la Russie, après tous les soubresauts qu’elle a connus après sa sortie de l’URSS. Le souci, c’est l’Europe ; elle n’est plus l’Europe. […] La maison Terre est mal assurée, mal gardée, voilà ce qui inquiète. Ceux qui ont l’influence, c’est le minuscule Qatar, c’est l’Arabie saoudite.»
De la «haute» irrévérence, mais tout en prudence tout de même ; sait-on jamais ! On cherchera en vain un petit détail, un nom de prince, une filiation certaine avec un événement terroriste concret, qui justifie cette hantise obsessionnelle des monarchies du Golfe. Il n’en manque pourtant pas. La dictature, c’est critiquable ; les dictateurs non ! Mais reprenons la déclaration et observons à quel point elle ruisselle d’incorrections, servies avec la désinvolture de celui qui énonce des évidences.
Primo : La Russie n’est pas sortie de l’URSS ; c’est elle qui a accordé une indépendance frelatée aux autres républiques, dont la plupart sont restées dans sa sphère d’influence ; la Russie de Vladimir Poutine a gardé le contrôle sur leurs dirigeants, leur territoire, leurs ressources, tout en se débarrassant de toute responsabilité vis-à-vis des peuples. Du grand art mais l’on ne peut pas qualifier cela de «sortie».
Secundo : On ne peut pas dire de «L’Europe qu’elle n’est plus ce qu’elle était» puisqu’elle était inexistante avant. Après, ses institutions ne sont que les balbutiements d’une Union de pays qui se sont toujours fait la guerre, sans pouvoir d’aucune sorte sinon pour servir d’écran de fumée et de bouc émissaire aux faillites et aux prévarications de leurs dirigeants.
Tertio : Le Qatar et l’Arabie saoudite ne sont dans l’échiquier mondial que des enfants gâtés à qui la mère CIA accorde des jouets fabuleux (missiles, drones, avions de chasse, technologies de surveillance, moyennant des centaines de milliards de dollars) et un terrain pour s’amuser : des populations civiles libyennes, yéménites – en attendant celles d’Iran – sur lesquelles ils peuvent déchaîner toute la sauvagerie du monde. Leur influence ne dépasse pas celle que le Pentagone leur autorise, dans la limite de ses stocks de matériel militaire autorisés.
Quarto : Reagan n’a pas libéré la monnaie : la monnaie est une matière inerte ; il a libéré les vautours, autorisés à en accumuler sans limite, et privatisé la sphère publique pour la livrer à leurs rapacités[61]. Mais si aligner des contresens peut être mis sur le compte de stratégies des auteurs en manque d’inspiration pour conduire l’acheteur à la dernière page, l’affaire de «la guerre des étoiles» est révélatrice d’une ignorance autrement plus insondable. Sansal révèle là une autre facette de son «savoir», acquis par recyclage du discours de café de commerce.
Reagan aurait donc selon lui «lancé la guerre des étoiles». Celle-ci n’a tout simplement jamais eu lieu. Entre le zéro et l’infini de la guerre des étoiles, on ne peut concevoir plus grande fumisterie. Les seuls rayons envoyés par les satellites US sur le territoire russe, et ailleurs, sont des programmes de radio et de télévision[62]. Une connaissance sommaire de l’histoire du monde suffit pour savoir qu’il s’agissait, au mieux, d’une propagande du Pentagone déclamée par l’ex-acteur Ronald Reagan pour pousser les dirigeants de l’Union soviétique à la surenchère et la ruine ; la seule réalité opérationnelle de cette guerre des étoiles qui fait fantasmer Sansal tient à une conséquence sans cause réelle : des tiraillements au sein du Kremlin qui ont précipité l’effondrement de l’URSS, rendant au final service à sa Nomenklatura qui pourra s’adonner aux délices de l’oligarchie déchaînée. C’est cela, le but d’une propagande… Mais qu’est-ce au juste que la «Guerre des étoiles» ?
SDI, pour Strategic Defense Initiative, tel est le nom officiel du programme en question. C’est la presse qui lui donna le sobriquet de «Star Wars», soit Guerre des Étoiles, signifiant clairement qu’elle lui accordait autant de crédit qu’aux œuvres de science-fiction de George Lucas. Un grand numéro de gesticulation. Reagan était un ignorant, au grand talent orateur et aux convictions religieuses bien trempées, qui croyait à la vocation messianique des USA ; en entamant son mandat, il était déjà au bord de la sénilité mentale et son corps était en pleine décrépitude ; autant dire une proie idéale pour des vautours qui ne manquaient pas à Washington. Il était entouré des néoconservateurs qui s’apprêtaient à entrer en action, d’abord lorsque George Bush père lui succédera, et de façon plus explosive encore en 2000 avec George Bush fils.
Et eux avaient un vrai programme dans leurs tablettes (dont deux déclinaisons en Irak). Reagan ne comprenait rien à la politique. Lorsqu’il évoque la SDI, la plus grande préoccupation de son cabinet était de stopper son délire avec délicatesse, comme on fait avec un patriarche gâteux. Voici le témoignage d’un insider : «Bush ne partageait pas la ferveur de Reagan pour la SDI. En mars 1983, le directeur de cabinet du vice-président, l’Amiral Daniel Murphy, a fait irruption dans son bureau avec une copie du discours du Président où il comptait annoncer le programme. Murphy dit : "Nous devons absolument supprimer ça ! Si nous mettons un pied là-dedans, nous allons provoquer la plus grande course à l’armement que le monde ait jamais vue."[63]» Car si la course à l’armement minait l’URSS, elle ruinait de la même façon les États-Unis.
Si l’entourage de Reagan freinait des quatre fers, au moins ses ennemis soviétiques ont-ils mordu à l’hameçon ? Même pas. « Les conseillers de Gorbatchev comprirent que Bush ne partageait pas la passion de Reagan pour le Guerre des Étoiles ; ils doutaient que l’administration Bush fût encline à poursuivre le programme. » Pour cause, les intéressés eux-mêmes ne faisaient pas secret de la nature chimérique du projet. « À titre d’exemple […], le premier secrétaire à la Défense nommé par George Bush, John Tower, balaya de la main comme "non réaliste" le rêve de Reagan d’un système de défense intégral et imprenable basé dans l’espace. Dick Cheney répéta à maintes reprises que le programme SDI a été "survendu" et, deux jours après sa prise de fonction, Ben Scowcroft, qui a ouvertement critiqué le SDI à titre privé, affirma dans l’émission "This Week with David Brinckley" sur ABC qu’il refusait de s’engager "dans ce programme massif tant que nous ne comprendrons pas comment il s’intégrerait dans ce que nous essayons de faire." Dans sa conférence de presse, Bush déclara que le SDI ne fournirait pas un "bouclier si impénétrable" qu’il se passerait "du besoin de toute autre défense". Avec cette déclaration prudente, Bush répudia l’essence même de ce qui avait attiré Reagan dans le SDI. » La foi de Reagan en ce programme tenait à une philosophie qui veut que « la défense, c’est "moral", l’attaque c’est "immoral".[64] » Outre le caractère irréaliste du dispositif – couvrir l’espace de lanceurs de missiles antimissiles exposés à d’irréparables pannes et à tous les piratages à distance –, les faucons néoconservateurs qui s’installaient aux plus hautes fonctions de l’État fédéral préparaient une Amérique de « l’attaque préventive ». Aux antipodes de la philosophie de la défense, une Amérique impériale. Pour financer ce SDI, il fallait de surcroît obtenir l’aval du Congrès, question qu’il n’a tout simplement jamais eu à débattre ; le projet est resté au stade du vœu pieu d’un homme en plein délire mental. La Guerre des Étoiles a pourtant bien existé ; mais c’était dans les salles de cinéma où, nous le savons, l’aventure était promise à un inégalable succès. Avant de s’aventurer à réécrire l’Histoire, Boualem Sansal aurait été bien avisé de la lire d’abord.
Tant d’ignorance en un si petit passage qui se veut grande hauteur de vue relève de l’exploit. S’il se trompe à ce point sur une époque récente, révolue et documentée, peut-être que le présent l’inspirera davantage ! Imperturbable, Sansal ne redoute pas les extravagances du rutilant Donald Trump devenu Président ; il déplore simplement qu’il ne parvienne à les accomplir : Il « est élu pour quatre ans, ce n’est pas assez pour lui pour comprendre le monde, encore moins ce monde ancien et poussiéreux qu’est la Méditerranée. Je pense qu’il va vite se fatiguer les méninges avec la politique étrangère. Il va se replier sur les problèmes internes, l’Amérique profonde va le requérir. » On a entendu des «philosophes» envinés au petit matin produire des analyses plus convaincantes. Sansal eût aimé que Trump disposât de temps pour « dépoussiérer la Méditerranée » et la mettre à la page ; celui-ci devra se contenter d’exprimer ses talents au service de « l’Amérique profonde »… Nous connaissons la suite.
On ne s’étonne en tout cas plus que Boris Cyrulnik trouve de nouveau que «Boualem Sansal a parfaitement raison». Lequel en rajoute une couche dans l’apologie du capitalisme des «coquin» : «Quand on voit ce que le protectionnisme a commis comme perversions, on en viendrait presque à accepter une certaine dose de guerre pour tenir la société éveillée. Le principe de précaution érigé en loi est l’ennemi absolu [sic] de la paix. Plusieurs pays européens l’ont pourtant adopté. La trop grande protection dont jouit légalement la société européenne est débilitante et castratrice. Nous devrions avoir de la paix et de la sécurité une vision virile, aventureuse, philosophique, sinon comment quitterions-nous notre berceau mité pour nous aventurer dans le étoiles puisque là est notre futur, la Terre que nous avons épuisée ne pouvant plus nous supporter pour longtemps ». Cyrulnik ne peut qu’acquiescer : «C’est avec la guerre qu’on arrive à résoudre les problèmes en détruisant l’autre. […] En fait on ne peut rêver de paix que si l’on est en guerre. Et à la fin du processus, on se suicide»
Sansal et Cyrulnik sont un peu les gourous d’une secte apocalyptique, qui vouent l’univers à la damnation ; par le suicide ou le Suisse-ide, mais à la mort ; sauf les plus détraqués des Américains comme Trump et les généraux arabes « virils » comme Sissi. Pour un monde de guerre pour permettre aux gueux d’apprécier la paix. Un monde dominé par le « cosmopolitisme ». Extrapolation hasardeuse ? Absolument pas. « Aujourd’hui encore, dit-il, chez les islamistes, on évoque avec sympathie Hitler et sa légendaire haine de la démocratie, du Juif, du faible, du cosmopolite.» La laborieuse et décousue démonstration ne sert que de mise en condition avant d’en venir à ceux que les deux auteurs apprécient par-dessus tout : « le Juif, le faible, le cosmopolite ». Nous sommes au cœur du sujet. L’Histoire, vue à travers les loupes déformantes de nos aventuriers documentalistes instructeurs d’un dimanche après-midi de déprime. Se contentent-ils de remplir à demi des livres ? Non ! Sansal a une vocation universelle à accomplir…
Sansal copréside une association pour un but auquel il ne croit pas
Dans ce livre de moins de 140 demi-pages émaillées de vides, Sansal et Cyrulnik en consacrent 20 pour un chapitre imprudemment intitulé La Solution des coquins», où ils exposent les leurs. Sansal y joue le rôle du proscrit modeste qui « profite du micro qui lui est tendu » pour annoncer la création de l’organisation « pour la paix » ; puis il racole l’adhésion de Cyrulnik (qui explique que « Boualem Sansal est un homme de bonne volonté, donc il risque sa vie simplement en disant qu’il veut la paix », s’envase dans un méli-mélo pseudo-historique où se télescopent «Valmy», «la bataille de Montenotte de 1796 en Italie », le Diable au corps de Radiguet, « le régiment des cocus », «la Guerre mondiale», « les militaires français avec qui [il] travaille à Toulon, etc.) ; l’obtient : «Je rejoins Sansal et les écrivains pour la paix, aujourd’hui, car je crois également que son Rassemblement est un frein au système totalitaire. […] C’est pour ça que je rejoins dès aujourd’hui Sansal, pour ne pas avoir honte et pour freiner un peu.
Des gens comme Sansal freinent.» ; s’en félicite : « Ce que dit Boris Cyrulnik de notre mouvement me touche beaucoup. Il est lui-même une personne engagée, forte en parole […]. Ce n’est pas sans raison que ses livres sont des best-sellers. […] À lui seul Boris est un rassemblement de penseurs. » L’ouvrage se clôt avec l’amputation-épaississement de 20 autres pages pour diffuser deux tracts : l’un est la transcription intégrale de « l’appel pour la paix » ; l’autre est un peu une réplique « du micro qui est tendu » à Sansal pour s’expliquer de son voyage en Israël. Il faut un aplomb certain pour faire la promotion d’une «Association pour la Paix» dans un ouvrage qui porte le titre L’Impossible paix en Méditerranée ; mais, de l’aplomb, Sansal en a à vendre, et à revendre !

Voici un extrait de la proclamation de l’association qu’il préside avec David Grossman : «Il est urgent que la communauté internationale intervienne fermement pour mettre sous contrôle le programme nucléaire iranien et s’engage résolument dans le règlement du conflit israélo-palestinien, en poussant les parties à ouvrir immédiatement un vrai dialogue direct devant aboutir à la création d’un État palestinien à côté de l’État d’Israël, les deux dans des frontières sûres, sur la base de compromis douloureux pour les deux parties mais nécessaires à la paix, comme l’abandon des colonies ou leur échange contre des terres, l’abandon du droit de retour des réfugiés de 1948, le partage de Jérusalem. C’est une solution possible, et des deux côtés, il existe des hommes et des femmes capables de la réaliser. Aidons-les à le faire.»
Laissons de côté l’Iran et sa bombe : subordonner le règlement du conflit israélo-palestinien aux bonnes volontés de l’Iran, ou la paix à la capacité de la communauté internationale à y ouvrir un nouveau front de guerre après l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie et la Libye, c’est se tirer une balle dans le pied en s’apprêtant à disputer un marathon. Il paraît plus sérieusement évident que Sansal n’a pas pu être associé à la rédaction de cette déclaration ; pour une raison simple : elle plaide pour une cause qui est l’antithèse de tout ce pour quoi il milite. Ce passage, qui transpire le vœu pieux – mais ne sommes-nous pas au carrefour de toutes les fois ? – fait suite à un long développement qui met en exergue l’inexistence d’une « communauté internationale » susceptible de s’engager, de peser, de décider. Des femmes et des hommes, il y en a, et ils sont majoritaires, qui aspirent à la paix et qui sont « capables de le faire » ; Boualem Sansal n’en fait pas partie. Un, pour lui, «la Palestine, la Judée et la Samarie» sont l’âme des Juifs et la Judée et la Samarie sont en Cisjordanie, là où David Grossman espère voir naître un «État palestinien viable», condition impérative pour un État hébreu libéré de ses peurs. Deux, pour Sansal, Jérusalem (et bien au-delà) est terre juive et David Grossman espère y instaurer le partage. Trois, comment cet homme qui use de termes comme « poubelle », « indigènes », etc., à l’égard de son propre peuple, peut-il contribuer à régler avec objectivité» le problème le plus complexe du monde, entre deux entités séculairement adverses, quand son cœur saigne unilatéralement pour l’une d’elles ? Comment quelqu’un qui respire le mépris de soi peut-il plaider pour l’amour de son prochain ?
C’est Ibn-Khaldoun, inventeur de la sociologie, qui souligna l’une des plus grandes pathologies des élites politiques arabes depuis des siècles : Attafaqa el-arabou en la yettafiqu. Les Arabes se sont mis d’accord pour ne jamais se mettre d’accord. Il semble que les Juifs souffrent de cette même propension à poser les problèmes de sorte que tous les pourparlers du monde échouent à les résoudre. L’objectivité repose sur un souci de vérité à toute épreuve. Nous avons montré sur quelques-unes des questions soulevées par Sansal dans son ouvrage avec Cyrulnik qu’il prend sans nuance le parti-pris des puissants et, de préférence, celui du mensonge. Boualem Sansal est un intellectuel faussaire et David Grossman compte sur lui pour faire jaillir la lumière et la paix dans une région que les plus grandes puissances de la planète s’acharnent à plonger dans les ténèbres et la guerre ? Il y a comme qui dirait maldonne…
Si Grossman plaide pour le jour, Sansal appelle la nuit…
Quand les renards flattent, les fromages tombent. Il est aisé de comprendre pourquoi Sansal s’est associé à David Grossman. David Grossman est un Juif ; et un ambitieux sait s’allier à partie puissante, influente et fortunée ; c’est le fil avec lequel se tisse l’antisémitisme, mais – nous allons le voir plus loin – l’antisémitisme est une géométrie fluctuante. David Grossman est, surtout, un intellectuel de grande probité, un journaliste de grande valeur et, last but not least, un homme d’une grande humanité. Du fait de cette coprésidence, Sansal hérite gratis de toutes ces qualités, par osmose, et profite de tous les dividendes d’une entreprise à qui on « tend des micros » : un homme aussi avisé que Grossman pouvait-il s’associer à lui s’il le savait piètre individu ?
Plus contingente est la question de savoir pourquoi Grossman s’est acoquiné avec Sansal. La viabilité de leur projet commun tient dans l’intitulé de l’ouvrage de Sansal : L’Impossible paix en Méditerranée. Faisons abstraction qu’un rassemblement d’« écrivains », si ça permet de rencontrer des gens célèbres, influents, dans des assemblées fastueuses, tous frais payés, ça n’a pas le plus petit soupçon d’embryon de chance d’engendrer la paix dans un monde dominé par les belliqueux. Ceux qui la veulent, les peuples, ne sont pas conviés aux banquets, et ceux qui décident, les oligarchies politico-militaires, n’ont que faire des conseilleurs de paix. Mais, avant de reprendre le cours tortueux du savoir selon Sansal, arrêtons-nous un instant sur son imprudent partenaire d’aventure… dans la futilité.
- Ils sont nombreux, en Israël, dans la diaspora, dont le cœur bat pour la paix, la fraternité, l’amitié ; nous en entendrons quelques-uns. Dans son ouvrage sur Le Nouvel Israël, Emmanuel Faux recense quelques initiatives de Juifs, en Israël même ou s’aventurant sur les sentiers piégés des « territoires occupés », qui réconcilient l’homme avec son humanité. Quelques-uns sont journalistes – la face noble de ce métier dénaturé bien évidemment ; certains écrivent dans Haaretz, un quotidien injustement qualifié de «gauche », celle-ci ayant perverti partout dans le monde les valeurs dont elle se revendique. Parmi eux, Gideon Lévy, David Grossman, Amos Oz. Il y a Yeshayahou Leibowitz, Avraham Yehushua, « ces romanciers qui sont l’honneur d’Israël[65]». Il y a aussi Shlomi Eldar, le «premier correspondant de la télévision d’État dans la bande de Gaza. Ce sont ses reportages qui ont apporté au public israélien les premières preuves par l’image des actions menées dans les territoires palestiniens. […] La caméra se posait enfin au cœur de la rue palestinienne. Et les habitants de Gaza qui n’avaient de l’Israélien que l’image du soldat, généralement hostile, découvraient soudain, à travers Shlomi Eldar, un nouveau spécimen en provenance de l’État hébreu.[66] » Il a apporté images à l’appui les preuves d’opérations de l’armée israéliennes qui confinent au crime contre l’humanité. Daniele Kriegel a rédigé un reportage, à arracher des larmes aux pierres, sur ce que le mot check-point plein de désinvolture recouvre comme terrible réalité pour une population palestinienne réduite à vivre «pignon sur mur.[67]» Il y a Michel Warschawski, «écrivain et musicien de talent». Il a créé le Centre alternatif à Jérusalem, qui propose des visites un peu particulières : Plusieurs fois par mois, il remplit des cars entiers de visiteurs étrangers, de chercheurs ou d’Israéliens "en révolte" qui veulent voir de près cet objet si terriblement symbolique à leurs yeux d’un "apartheid moderne"[68]» : Le Mur. Il existe une autre initiative de même veine, celle de « Yehuda Saul, un jeune homme en colère qui organise dans la ville un tourisme singulier : ses "Hebron tours" ont pour but de faire découvrir aux Juifs, Israéliens ou non, comme aux non-Juifs, l’envers du décor. Témoignages et explications dénoncent les certitudes des huit cent colons, leurs exactions et celles de l’armée israélienne contrainte de couvrir leurs débordements. C’est suffisant pour que David Wilder, président de la communauté juive de Hébron, surnomme Yehuda Shaul le "Hamas en kippa".[69] » Un antisémite en quelque sorte…
Comment oublier ces Médecins pour les Droits de l’Homme, autour du docteur Raphaël Walden ? Ils sacrifient leur jour de repos hebdomadaire pour aller soigner bénévolement dans les villages des territoires occupés et, surtout, coupés par la colonisation du plus petit système sanitaire possible. Il y a ces « rabbins au pied des oliviers » de l’association Rabbins pour les Droits de l’Homme, parmi lesquels le rabbin Yehiel Grenimann : «Fin 2006, un groupe de volontaires mandatés par l’organisation avait reconstruit à mains nues une maison palestinienne détruite par l’armée israélienne en Cisjordanie. En parallèle, les rabbins avaient engagé une action en justice pour contester la légalité de ces "démolitions" décidées en conclave ministériel ou lors de réunions de responsables militaires. Sans attendre la décision des juges, la maison reconstruire fut, une nouvelle fois, réduite à néant par les bulldozers israéliens.[70]» Un pays sans Constitution autorise qui veut à édicter des « lois » à sa convenance ; au grand malheur des victimes palestiniennes, qui n’ont nulle juridiction à qui s’en remettre ; au grand dam des humanistes israéliens, qui n’ont que leurs petites mains pour soulager les plaies provoquées par de grands engins.
Ils sont nombreux les Juifs pour qui «le concept même de colonie est discriminatoire. Il mine le caractère d’Israël, mon pays, […] répétait Dror, dans un café de Jérusalem, à deux pas de l’association La Paix maintenant que dirige Hagit Ofran, la propre petite fille du philosophe Yeshayahou Leibowitz[71]».
Le nom du mouvement suffit parfois : «Yesh Din ("Il y a une loi")», signifiant qu’Israël ne la respecte pas. Autant d’initiatives qui offrent une lueur d’espoir de paix aux plus damnés de tous les damnés. «Des mains "amies", les Palestiniens de Cisjordanie en voient régulièrement se tendre vers eux, comme celles des "femmes en noir" qui se sont baptisées ainsi en référence aux veuves argentines manifestant sur la place de Mai, à Buenos Aires. Depuis des années, ces militantes israéliennes se rassemblent le vendredi à Jérusalem et Tel-Aviv en brandissant une grande "main noire" sur laquelle sont écrits trois mots : "HALTE À L’OCCUPATION". Mais les plus persévérantes sont sans aucun doute les femmes qui viennent régulièrement sur les barrages de l’armée israélienne. Regroupées au sein de Marsom Watch, elles surveillent attentivement le comportement des soldats vis-à-vis des Palestiniens qui se présentent pour entrer sur le sol israélien ou, dans l’autre sens […].[72]» Il y a encore l’association Women Wage for peace, et ses marches rassemblant israéliennes et palestiniennes pour demander la paix. Il n’y a pas que des soldats fanatisés qui tirent à l’obus sur des enfants qui s’amusent sur la plage, provoquant un carnage, qui sont la honte de l’humanité ; il y a des Juifs israéliens qui la réhabilitent… Mais il est dans la nature des propagandes de profiter des amalgames ; il y a le peuple et il y a les élites théologico-militarisées ; dans les médias, tout cela devient une entité : Israël ; une vitrine qui n’a pas vocation à exposer ses défauts. Il y a un conflit israélo-palestinien rendu volontairement inextricable et que Boualem Sansal simplifie pour un public prêt à tout gober dès lors qu’on lui dit : «Les islamistes» sont dangereux.
L’amalgame est une stratégie de guerre
Revenons à David Grossman ! Il a perdu un fils dans la guerre israélo-palestinienne. Il a donc le profit idéal de celui qui veut se venger. Rien de cela. Ce drame ne l’a convaincu que davantage de la nécessité de la paix. Il avait contribué au discours d’Yitshak Rabin le soir où celui-ci a été assassiné et il était à ses côtés pour le voir pousser son dernier souffle. Dans une allocution prononcée sur la place même où son ami est mort, il dit : «Yitshak Rabin a pris le chemin de la paix avec les Palestiniens non par amour pour eux ou pour leur dirigeant. Il avait compris, avec une grande intelligence et bien avant beaucoup d’autres, que vivre dans un climat de violence, d’occupation, de terreur, de crainte et de désespoir exige davantage que ce qu’Israël était capable de supporter. […] Par le glaive nous vivrons, par le glaive nous mourrons et le glaive nous dévorera pour toujours.[73]»
Puis il s’adresse à Ehud Barak : «Arrêtez-vous un moment et jetez un coup d’œil à l’abîme. Pensez à combien nous sommes près de perdre tout ce que nous avons créé ici.» David Grossman ne dit pas « La paix et impossible ». Sansal si ! Alors que peuvent-ils bien faire ensemble de viable ? David Grossman veut préserver Israël du pire et il est persuadé que cela passe indiscutablement par un État et un peuple palestiniens libres, souverains, vivant en sécurité, sur un territoire viable. Boualem Sansal ne voit dans les Palestiniens que des nuisances, les mêmes qu’il décèle chez les « jeunes des banlieues », chez les Maghrébins, les « Méditerranéens » indignes de « paix ».
Les Arabes n’ont pas eu leur mot à dire sur la décision des nations Unies d’implanter un État juif en Palestine. Mais, à l’image du rassemblement entre Sansal est Grossman, parler des «Arabes »est la fondation d’un édifice voué au naufrage. Car il y a les peuples arabes, et il y a les dirigeants arabes. Deux entités on ne peut plus ennemies ; que séparent de plus grande fractures encore que celles qui les opposent, chacune seule, aux Juifs. Au lendemain de la déconfiture des leaders arabes face à Israël, ils ont opposé à l’État hébreu un refus de négocier d’autant plus radical qu’ils se savaient illégitimes à diriger leurs peuples, incompétents à les élever et incapables de les entraîner, au moins, vers la victoire militaire. La surenchère dans la rigidité de façade est la posture des faibles sur les questions de fonds. Là réside le problème principal. Des dirigeants arabes démystifiés aux yeux de leurs peuples ; une élite qui ne tire son pouvoir que des soutiens occultes fournis par des puissances occidentales trop heureuses des opportunités qu’elle leur offre de piller les ressources de son peuple ; des leaders appelés à traiter avec Israël qui les a maintes fois humiliés militairement, qui se refusent à se présenter à la table des négociations en vaincus ; mais qui se bousculent auprès de lui dans les coulisses pour rivaliser de marques d’allégeance et de servilité. Stratégie qui garantit une double défaite : celle de la paix et celle de la guerre. Conséquence : au lendemain de 1967, les Israéliens ont été « contraints de prendre des décisions unilatérales. […] De fait, la résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU, votée le 22 novembre 1967, reconnaît à l’État juif "le droit de vivre en paix avec des frontières sûres et reconnues qui ne soient pas sujettes à des menaces ou à des actes de violence". Et le président américain de l’époque, Lyndon Johnson, a confirmé aux dirigeants israéliens que ce texte, "volontairement ambigu, ouvre la possibilité à des ‘corrections’ par rapport aux lignes de démarcation antérieures. […]" Le ministre des Affaires étrangères Yigal Allon publie en 1969 un plan qui distingue entre des "frontières de sécurité" situées le plus loin possible (le Jourdain, le Golan, Charm-el-Cheikh, les hauteurs du Golan) et des "frontières politiques" plus rapprochées, calculées de manière à laisser en dehors d’Israël les régions à forte population arabe.[74]»
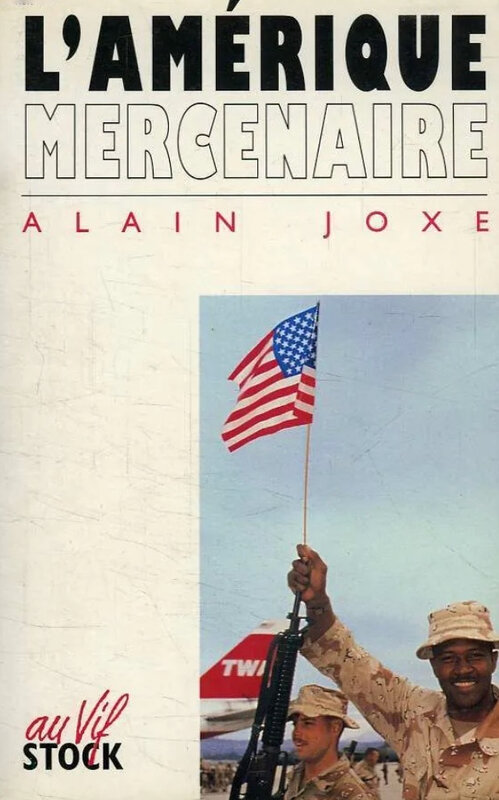
Alain Joxe : L'Amérique mercenaire, 1992
Les Palestiniens situent la naqba, « la catastrophe », en 1947. La vraie aura lieu vingt ans plus tard.
1967, année de la naqba, naissance d’une stratégie
1967. Défaite humiliante pour les Arabes. Une victoire au goût amer pour les Juifs. Une catastrophe pour les peuples arabes ; une catastrophe pour le peuple juif. Le ferment du chaos pour l’humanité.
Les négociations que mènent les dirigeants israéliens reposent sur un paradoxe : mettre leur pays à l’abri de la disparition quand ils viennent d’apporter la preuve de leur écrasante supériorité militaire. Position de force et posture de faiblesse ; singularité qui nourrira une politique duale, schizophrène ; expansive comme peut l’être la grenouille de la Fontaine qui « enfla tant qu’elle creva ». Vont-ils reculer juste au moment où ils découvrent l’euphorie de leur puissance ? Avancer mais jusqu’où ? Où se trouvent les frontières de la victoire suicidaire ? Jusqu’où s’étendent les terres de leur « âme » ?
Deux visions de l’avenir d’Israël se confrontent alors au sein des élites juives : «L’establishment a tendance à prôner l’abandon le plus rapide possible de la plus grande partie des "territoires", l’opposition à réclamer au contraire leur annexion. Les uns et les autres avancent des arguments stratégiques. Mais les "représentations", la symbolique, ne sont pas moins importantes. Rejeter les "territoires", c’est prendre ses distances avec la Bible, la Torah, le judaïsme traditionnel, toute forme de populisme, s’orienter vers une plus grande laïcité ; inversement, militer pour leur rattachement à Israël, c’est revenir aux sources nationales et religieuses, réaffirmer la singularité d’un destin collectif. Les "colombes", favorables à un retrait se définissent comme des "israéliens d’abord", "juifs" ensuite ; les "faucons", à l’inverse comme "juifs" et ensuite – ou donc – "israéliens".[75]» To be or not to be « normal » : telle était la question ; la politique depuis 1967 a consisté à ne pas trancher, tout en avançant dans le territoire en peau de chagrin des Palestiniens ; à annexer, coloniser, bombarder, exécuter, et à accuser les autorités palestiniennes de vouloir « rayer Israël de la carte », comme si ceux-ci avaient le plus petit soupçon de capacité à y parvenir. Pour pouvoir concilier tout et son contraire, Israël devait s’abstenir de se doter d’une Constitution, et avancer sur fond de désordre législatif propice à tous les rapts, à toutes les impunités.
L’on retrouve là les deux visions portées par les deux pères fondateurs du sionisme, celle de gauche de Théodore Herzl et de David Ben Gourion ; celle de droite, radicale, de Zeev Vladimir Jabotinsky, qui énonça la stratégie machiavélique qu’ont adoptée depuis tous les extrémistes : « On fait la paix avec celui qui est prêt à se battre pour sa terre. On fait la guerre à celui veut céder sa terre. » Guerre et paix entre Juifs s’entend, c’est-à-dire une guerre civile permanente ; qui ne peut se justifier que si la menace fantôme trône au-dessus de leur tête : celle de voir Israël disparaître. Et si ce péril cesse d’exister, il faut l’inventer. C’est de la sorte qu’est né le Djihad islamique de Cheikh Hussein, créé avec la bénédiction du Mossad pour neutraliser les initiatives de paix des laïcs de l’OLP. Le credo interne se double d’un autre en miroir, non dit : «Paix armée avec l’ennemi palestinien qui veut se battre pour sa terre. Guerre contre celui qui veut la paix.» Stratégie du chaos, de l’impossible paix, qui trouvera un grand écho dans un monde sortant de la bipolarité pour plonger dans celui, impérialiste, de la loi du plus fort : on la verra à l’œuvre dans de nombreux pays, avec l’Algérie comme laboratoire de l’islamisme radical, et, surtout, portée par l’Empire du chaos : les États-Unis d’Amérique.
Sommairement, au quotidien, une gauche qui s’effrite, une droite qui se radicalise… Deux tendances de moins en moins discernables, qu’arbitrent les religieux ultra-orthodoxes ; lesquels, chemin faisant, adoptent les pragmatismes terrestres des colons les plus zélés. Les colombes s’en vont vers d’autres cieux ; les laïcs stagnent ; les religieux prolifèrent en faisant des enfants éduqués selon les rites les plus rétrogrades. Le rapport de force démographique penche en faveur des « faucons », dans un environnement où les Arabes palestiniens, natalité galopante égale oblige, sont voués à devenir majoritaires. Tandis que la colonisation fait rage, le piège se referme sur Israël. Progressant inexorablement vers le fond du tunnel, comme dans une secte de plus en plus apocalyptique, les dirigeants israéliens entraînent leur pays vers l’impasse. La fuite en avant ; après, on verra.
Après, se situera dans un monde devenu fou, de guerre mondiale civile sur le point d’éclater, de climat sur le point de se détraquer, d’eau qui viendra à manquer, l’atmosphère qui sera devenue irrespirable, etc. Un contexte débarrassé du poids de la politique, des conventions, un contexte de guerre «mondiale», où les Israéliens disposent maintenant de sérieux atouts. Les autorités palestiniennes, acculées elles aussi, sans aucun allié arabe pour leur tendre la perche, s’enfoncent de la même manière. Leur planche de salut à eux, la démocratie ; qui leur redonnera l’ascendant eu égard à leur taux de fécondité à faire frémir un utérus dès sa propre gestation. Une « démogracie » en quelque sorte. Deux options, une issue identique : dans un seul État où ils domineraient par le nombre ; dans deux États où, débarrassé des démons arabes, Israël sera confronté aux siens. Dans un cas comme dans l’autre, les perspectives pour les Juifs sont sombres, au cœur d’un espace où les religieux ont pris le dessus. Mais il y aurait une option plus probable, qui laisserait l’ascendant aux Juifs, dans un Israël devenu une tyrannie militaro-religieuse affranchie des jalons de l’humanité. Sans doute est-ce le rêve secret de Sansal ; c’est le cauchemar de Grossman.
Le cauchemar des leaders israéliens : la paix
C’est Menahem Begin, père fondateur avec l’Irgoun du terrorisme en Palestine, qui, devenu Premier ministre, engage son pays dans le sillon du «Grand Israël» ; et donc vers une guerre sans fin. Yitshak Rabbin militera pour la paix. Il sera assassiné par un extrémiste religieux juif. Il ne reste alors sur le terrain politique que des «faucons» ; le peuple de gauche est resté orphelin, obligé de mener des actions symboliques pour maintenir le fil ténu de l’espérance. C’est cette tendance humaniste, laïque, démocratie, universelle qu’incarne le combat de David Grossman ; et il s’allie avec l’un des sionistes les plus forcenés que le « monde arabe » pouvait produire : Boualem Sansal… Tandis que les leaders israéliens élaborent des stratégies de guerre et de paix, leurs homologues arabes s’arment contre leurs propres peuples. Et les intellectuels algériens aiguisent leurs épées à tremper dans le sang des leurs, en empochant le salaire infâme de leurs trahisons. Nous allons examiner quelques autres domaines où les élites toxiques exposent leurs fumeuses théories pseudo-philosémites ; grâce à l’éclairage de quelques auteurs juifs à la probité indiscutable, que l’on peut à juste titre qualifier de Lumières, dans un monde taillé pour les faiseurs de ténèbres.
Le monde, et avec lui beaucoup de Juifs, vivait dans la certitude que les israéliens n’aspiraient qu’à vivre en paix et que les Arabes, déterminés à rayer Israël de la carte, étaient l’obstacle. La rhétorique voulait que les uns tendaient la main et que les autres s’obstinaient à la dédaigner. Et tout dans les airs soutenait ces apparences. Incapables de gagner une guerre contre Israël, inaptes à faire la paix avec les Juifs, de plus en plus honnis de leur propre peuple, les dirigeants arabes n’avaient plus qu’une posture de repli : se poser comme remparts contre un ennemi diabolique : le terrorisme islamique. Les pays arabes sont ce que sont leurs dirigeants ; ils sont incapables de s’unir ; ils forment donc une kyrielle de dynamiques politiques hétéroclites, mues – outre par une corruption fondamentale – de main de fer par des services de renseignements, qui ne répugnent pas à jouer de la gégène. Ils savent surtout enrayer à l’embryon toute dynamique libératrice et engendrer des groupes terroristes les plus invraisemblables. Peu importe puisqu’il se trouvera des Sansal bien dotés pour donner crédit aux plus incroyables impostures.
L’idée qu’Israël est devenu indestructible a fait son chemin dans l’esprit des dirigeants de l’OLP ; le partage équitable de cette terre entre les deux peuples s’est imposé à eux comme la seule solution humainement acceptable. Régler le conflit israélo-palestinien est dès lors devenu une affaire de techniciens et de diplomates au bon cœur. Mais… la paix advenant, les Israéliens perdraient le ciment de leur unité, le péril de l’extermination. Ils seraient «en danger de paix[76]». Et les Arabes n’auraient plus l’alibi de l’«écharde» juive dans l’œil de l’Islam. C’est le statu quo mondial qui s’en trouverait ébranlé. Sinon les peuples négligeables, la paix n’arrange personne.
L’ennemi objectif de tous ces pouvoirs épars : les peuples. Ne pouvant leur mener la guerre ouvertement, ceux-ci devaient trouver une cible sur laquelle tout le monde pourra s’accorder, qui neutralisera par ricochet toute perspective de paix. Et les dictateurs arabes – bien conseillés – ont compris que le seul biais pour se maintenir en place impose d’habiller cet ennemi des couleurs de l’Islam, fourre-tout indémêlable pour l’identité, la dignité, la langue, les us, la politique, la volonté d’en découdre, d’épancher sa haine, le désir de justice, d’équité, de respect, de se garantir les délices d’un Paradis gorgé de miel, de lait et de vierges soumises à n’en plus savoir laquelle dorloter, etc.

Charte du Hamas
Être installés aux premières loges ? Les islamistes n’en demandaient pas tant. Ils seront l’ennemi d’Israël, à maintenir sous la menace d’un holocauste factice pour l’éternité ; ils seront l’ennemi des dictateurs arabes, qui hériteront du statut d’avant-postes de la lutte contre le terrorisme, pour préserver les Occidentaux en Occident, et « les petites filles qui veulent se mettre du vernis sur les doigts » en Orient. Prix à payer ? Minime : maintenir les peuples dans la crainte et la précarité permanentes, dans la pauvreté matérielle et intellectuelle, dans le désœuvrement mental, dans l’ignorance, pour rallier aux intégristes des troupes nombreuses ; et construire des mosquées, une par quartier au moins, où Dieu a enjoint d’aller se réunir tous les vendredis, sinon tous les jours, comme lieux de culture et d’agitation. Tout le reste est affaire de politique, de manipulation ; de « réformes », dirait-on aujourd’hui. Dans tout ce tumulte calculé, il y a une part négligeable de religion ; il suffit de la monter en épingle et d’en faire un tout. L’islamisme, la lutte antiterroriste, les attentats, la « guerre civile » simulée. Nous l’avons vu à l’œuvre en Algérie, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, au Sahel, en Turquie, en Égypte. La géostratégie des « dominos ». Et le Hamas, le Hezbollah, le Djihad islamique, etc., seront les forces religieuses qui rendront impossible la paix en Palestine. Les GIA ont été créés par les services secrets algériens pour offrir à leur armée le statut de rempart contre la « talibanisation » du pays ; Le Djihad islamique est né selon les mêmes procédés, pour les mêmes objectifs.
S’agit-il d’un complot ?
Les pentes douces de la décadence
Il n’y a pas besoin de complot pour que dix escrocs épars aient la même idée d’escroquer ; c’est dans leur nature. Les convergences et les synergies s’opèrent d’elles-mêmes. Surtout si un acteur majeur sert de catalyseur à toutes les forfaitures. Escroquer n’est alors plus un crime dont les acteurs se défendent : c’est un sésame qui ouvre toutes les portes. Cet acteur majeur, ce sont les États-Unis d’Amérique, l’« empire du chaos », que Sansal et Cyrulnik dépeignent comme l’incarnation du Bien, quoiqu’un tantinet « coquin ». Quand il y a un incendie, on peut l’étouffer en lui retirant son carburant ; ou l’attiser en y insufflant un accélérateur. Mais, comme l’explique Alain Joxe dans son Amérique mercenaire, il importe pour qui « n’accepte pas la domination d’une certaine Amérique, celle de Reagan et celle de Bush [celle d’Obama et celle de Trump], de bien comprendre qu’une Amérique en cache nécessairement plusieurs autres […]. » Là, ni plus ni moins qu’ailleurs, il y a les élites, et il y a le peuple. En guerre les unes contre l’autre. Les élites US avaient naguère un ennemi d’où procédait leur légitimité : le communisme ; sans lui, elles aussi devaient soit renoncer à leur prédominance et offrir à leur peuple la démocratie à laquelle il aspire, soit trouver un ennemi de substitution. L’Islam sera celui-là.
- C’est ainsi que, du milieu des années 1960 à la fin des années 1980, le monde a basculé d’une bipolarité USA-URSS vers une géopolitique du chaos ; avec l’islamisme politique comme pôle d’attraction dans un monde de «mondialisation » débarrassé de la contrainte des frontières, de la souveraineté nationale. La qualité d’un ouvrage se mesure, nous l’avons vu avec Philippe Delmas, avec l’âge. Celui d’Alain Joxtats-Unis sont bien tête d’empire.[77]»
Au sortir de la guerre froide, l’URSS démantelée, les USA avaient compris qu’entre «affronter le fort» ou «attaquer le faible», il était plus aisé et plus rentable de concentrer les efforts «sur le monde musulman». Tête d’empire et pieds d’argile. «Trois facteurs permettent d’expliquer la fixation de l’Amérique sur cette religion qui est aussi une région. Chacun de ces facteurs renvoie à l’une des déficiences (idéologique, économique, militaire) de l’Amérique en termes de ressources impériales. – Le recul de l’universalisme idéologique conduit à une nouvelle intolérance concernant la question du statut de la femme dans le monde musulman ; – la chute de l’efficacité économique mène à une obsession du pétrole arabe ; – l’insuffisance militaire des États-Unis fait du monde musulman, dont la faiblesse en ce domaine est extrême, une cible préférentielle.[78]» C’est dans ce schéma que s’insère la proximité Israël-USA, l’un servant de « porte-avions » pour les buts néocolonialistes de l’autre.
Que l’on élargisse la focale ou qu’on la concentre, une évidence s’impose : la décadence est l’œuvre collective et délibérée des élites : arabes, juives, européennes, américaines ; les peuples qui en subissent les méfaits se réveillent ; et, partout dans le monde, s’élève le même péril islamiste qui paralyse leurs initiatives et renforce l’arsenal totalitaire au service des pouvoirs installés. Il n’y a pas besoin de se réunir dans des sites secrets pour définir une géostratégie commune pour débouter les peuples de leurs prétentions : celle-ci s’impose d’elle-même, comme par contagion, par osmose, par gangrène ; par gravitation.
Israël, soutenu par les USA, le «Satan des peuples musulmans ; et, en miroir, le terrorisme islamiste comme empire du Mal en devenir. Le péril islamiste devient l’ennemi qui justifie la poursuite de l’occupation des terres palestiniennes pour Israël ; celui qui impose le maintien des dictatures militaires « stabilisatrices » pour les pays arabes ; celui qui légitime des guerres sur des théâtres lointains pour les puissances militaires occidentales, avec les USA comme gendarme de peu de moyens et d’engagement minimal. Au grand bonheur du complexe militaro-industriel américano-mondialisé.
L’émancipation des peuples ouvrirait la voie aux Juifs d’accéder à la «normalité», pour exprimer leur savoir-faire et leur esprit d’entreprise au profit des leurs et de leurs voisins, dans la paix et la sécurité ; l’émancipation des peuples abattrait en quelques mois les édifices corrompus et tortionnaires des pays arabes, pour offrir au citoyen le loisir de la liberté, de la dignité, de la prospérité ; l’émancipation mettrait fin au pillage des ressources pour les allouer à leurs légitimes propriétaires ; l’émancipation rendrait les arsenaux militaires obsolètes et ferait du complexe militaro-industriel une verrue dans la face de l’humanité ; l’émancipation rétablirait Sansal et autres imposteurs dans leur juste périmètre d’affreux opportunistes. Tout cela est possible et souhaitable. Mais les deux seuls protagonistes autorisés n’ont cure de la paix ; les uns fournissent les armes, reconstruisent les édifices qu’ils ont démolis, pillent le pétrole et tous les minerais disponibles ; les islamistes – par essence même de ce nouveau choc des civilisations simulé – étant les derniers invités à la table des négociations, il n’y a plus de paix envisageable. Et, bien sûr, pour lubrifier le tout, il y a des Sansal à la pelle, des Cyrulnik par brigades, qui pondent des coquilles vides et qui trouvent, dans un étrange univers, des lecteurs dociles pour acheter leurs œuvres corrompues.
- Les quadratures sont impossibles à rationaliser… C’est cela qui les définit. Les islamistes terroristes ne sont que des épouvantails – parfois bien rémunérés pour agiter leurs bras : en Algérie, ils sont parlementaires – qui n’ont de pouvoir quasi nulle part au monde ; mais le statut leur convient à merveille, l’alternative étant leur relégation à un rang marginal, des étrangetés dans monde de joie, de paix, de justice, de liberté. Les élites médiatiques expliquent pourtant qu’ils sont sur le point de conquérir le monde, qu’ils sont en passe de réaliser « le grand remplacement » des peuples blancs d’Europe, grâce à leurs testicules féconds. Peut-on convaincre les islamistes que le salut de l’humanité passe par leur reddition au moment où tout annonce leur triomphe (inatteignable) imminent ? Comme pour Israël en 1967, la griserie de la victoire annoncée est mauvaise conseillère. Tout le reste n’est que filouteries politiques, géostratégies de petite mais efficace facture. La démocratie est le fléau ultime pour les islamistes radicaux, pour les tyrannies d’Orient, du Sud et de l’Est, pour les pouvoirs occidentaux, pour les oligarchies de tous ordres. Il suffit que les faux ennemis se coalisent pour maintenir en suspens ce faux péril, commun et réciproque ; et collaborent à l’élimination de toute dynamique œuvrant pour la démocratie, la libération, l’indépendance, la souveraineté, l’émancipation des peuples.
Les prophéties auto-réalisatrices ont hélas une tendance fâcheuse à déborder les périmètres prédits par leurs oracles. La solution radicale, spectaculaire, s’impose alors : l’assassinat pédagogique.
À la solution de la quadrature, les Arabes et les Juifs sont tenus ;
en attendant, ils se font la guerre
Au cours du dernier siècle, Anouar al-Sadate a été le premier leader arabe à avoir voulu couper le nœud gordien, en faisant le premier pas révolutionnaire vers la paix. À la surprise générale, il se rendit en Israël, sans « préalable » ni palabre. Il fut accueilli par Menahem Begin dans un silence glacé. Ce geste de bonne volonté contrariait toute la stratégie des sionistes déjà engagés dans un programme de colonisation sans frein. Sadate, l’empêcheur de mener une guerre sans fin en rond, devait disparaître ; et, comme il se doit, les Frères musulmans, étonnamment libres, feront le job ; dans un pays où les Moukhabarat contrôlent les moindres palpitations des Égyptiens, les islamistes trouveront les armes et les sauf-conduits, dans un défilé militaire, jusqu’au pied de l’estrade officielle. Une rafale et puis s’en va. Anouar al-Sadate est assassiné en direct. Houari Boumediene, revenu de ses délires despotiques, a voulu rendre le pouvoir au peuple : il a été empoisonné par ceux qui lui succéderont. Mohammed Boudiaf, qui voulait libérer les Algériens de leur joug militaire, sera exécuté devant les caméras ; « paix » était son dernier souffle ; Yitshak Rabin, qui voulait la paix pour les Israéliens et les Palestiniens, connaîtra le même sort. Yasser Arafat a, selon toute vraisemblance, été empoisonné. Autant de trajectoires vers la paix, stoppées par le venin, biologique ou religieux, par des mains mal inspirées, plus ou moins bien manipulées.

Anouar al Sadate avec Jimmy Carter et Menahem Beghin
Sadate, vain pionnier de la paix. Devant un tel geste, l’Égypte devait être payée en retour des territoires du Sinaï perdus durant la guerre des Six jours ; puis la page est tournée. Hosni Moubarak, l’homme du Pentagone, est en place. Le ralliement des dirigeants arabes à ceux de l’État hébreu, navire amiral des USA, se déroule ensuite comme une indécelable lame de fond : Irak, Jordanie, Arabie saoudite, toutes les monarchies du Golfe, pays maghrébins. Il restait les impuissants Palestiniens, qui iront de concession en concession, sans jamais rien obtenir en retour. Yasser Arafat aura beau proclamer urbi et orbi que le projet de chasser les Juifs de Palestine était «caduque», la colonisation redouble d’ardeur, laissant aux Palestiniens l’impression d’être les dindons d’une immense farce. Qu’ils acceptent les plans qui leur sont proposés, et leurs concessions entrent immédiatement dans les faits, tandis que celles de leurs homologues israéliens restent lettre morte ; qu’ils les refusent et les voilà apportant la preuve de leur refus de la paix et de leur mortelle intransigeance.
Il y eut dans le ciel ténébreux une éclaircie. Sous le patronage de Bill Clinton, les pourparlers conduisirent Yasser Arafat et Yitshak Rabbin à la mémorable poignée de main sur le perron de la Maison Blanche. Avec l’assassinat du leader travailliste, c’est toute l’aile humaniste du pouvoir israélien qui est décapitée. Mais, dans l’ombre, des hommes de bonne volonté des deux côtés continuent à avancer sur le chemin de la concorde. L’accord dit d’Oslo est prêt ; il ne reste qu’à le faire adopter par le pouvoir politique : Ehud Barak et Yasser Arafat. Mais le monde a bien changé en peu de temps. Comme partout ailleurs, la gauche occupe désormais la place de la droite et cette dernière est devenue extrême. Tout travailliste qu’il se proclame, Ehud Barak est un «faucon» déterminé à pousser la colonisation plus loin que ce que ses homologues du Likoud ont déjà opéré de façon brutale.
Cette histoire complexe, où le machiavélisme et à l’arsenal de la terreur des uns répondent aux jets de cailloux des autres, Boualem Sansal et Boris Cyrulnik la réduisent à l’entêtement des Arabes à vouloir effacer les Juifs de la face de la terre ; lesquels Juifs sont par hypothèse placés dans des dispositions de bienveillante neutralité : «Quand Barack Obama et Yasser Arafat étaient à un cheveu de la paix, il ne restait plus qu’à régler le problème du Mont du Temple. Obama avait estimé, avec l’accord de l’NESCO, que la question ne serait réglée ni par les Juifs ni par les Palestiniens, du fait du caractère plurithéiste du lieu. Pour le président américain, c’est à l’UNESCO qu’il appartient de proposer une solution. Arafat a refusé en disant : "C’est à Dieu de décider ! "Voilà qui signifie clairement que personne ne veut la paix au Proche-Orient.» Personne à lire comme synonyme de Palestiniens. À ce raccourci de Cyrulnik, Sansal acquiesce et surenchérit : « On dirait que l’UNESCO n’est plus qu’une annexe de l’ALESCO – instance chargée de l’éducation, la culture et la science dépendant de la ligue arabe – : les pays arabes y font la pluie et le beau temps. » Pour Sansal, la « tare » palestinienne doit se propager au monde « arabe » comme l’huile sur un buvard. Sauf que…
- À moins d’en passer par «les mathématiques du chaos, les théories quantiques et relativistes, [qui] nous amènent à penser la violence et la paix, et tout le reste, le temps, l’espace et l’identité, sur des plans infiniment différents du plancher des vaches qui est notre plan de vie», comme dirait Sansal, en ajoutant les effets spéciaux et les procédés d’incrustation virtuelle des studios hollywoodiens, toutes manipulations techniques auxquelles il faut conjuguer le concours de tous les prophètes du Mont du Temple, ce que vient d’énoncer Cyrulnik comme une évidence est tout bonnement impossible ! Impossible… et donc faux. Comment en effet distordre le continuum espace-temps et concrétiser une rencontre entre Yasser Arafat, mort en 2004, et Barack Obama, sorti du néant en 2008 pour devenir président en 2009 ? Une recherche documentaire sur le sujet, dans la littérature foisonnante sur le conflit israélo-palestinien, pour une occurrence de cette controverse ou simplement sur l’expression «c’est à Dieu de décider , fait chou blanc. Un seul résultat : le livre de Sansal et de Cyrulnik.
Ce serait une erreur, et peut-être même le piège tendu par les auteurs (les gesticulations et les écrans de fumée d’un illusionniste), de se concentrer sur cet inconcevable anachronisme. Car la réalité du conflit est indéniable et se contenter de le survoler est aussi grave que de s’aligner sur les tonalités des jusqu’au-boutistes. Et ce que tendent à démontrer ces deux auteurs faussaires, c’est qu’Arafat a torpillé les pourparlers, car il ne souhaite pas la paix. Cela correspond exactement à la propagande du Likoud et des lobbys extrémistes en Israël et dans la diaspora : mettre sur le dos des Palestiniens tous les blocages, tous les handicaps à la paix, et justifier mezza voce le traitement inhumain qui leur est réservé. Pour les auteurs, il s’agit de documenter la paix impossible en Méditerranée, ramenée à son périmètre congru : Israël. Mais pas l’Israël de 1948, qui était pourtant, au sortir de la Shoah, une bénédiction pour les Juifs de l’époque ; pas même celui de 1967, qui taillait dans le vif du territoire alloué aux Palestiniens ; pas davantage Israël tel qu’il s’est constitué en annexant à tout va an après an… Non, un Israël étendu à des frontières qu’il faudra chercher dans la Bible.

Yasser Arafat et Uri Avnery
Avant d’examiner les initiatives des Juifs sincèrement dédiés à la paix, voyons quelle était la stratégie des élites politiques constituée d’un Likoud radicalisé et d’un parti travailliste devenu «une sorte de Likoud-bis», comme le décrit «Uri Avnery, ancien député et figure du Bloc de la paix (Goush Shalom) […]» pour qui «celui qui a le plus creusé [la] tombe [de la gauche] est Shimon Peres. Il en a été le principal représentant tout en se comportant comme le propagandiste en chef d’Ariel Sharon à travers le monde entier.[79]»
Pour d’autres, c’est Ehud Barak qui «a plongé la gauche israélienne dans les ténèbres» ; l’on peut dire qu’il s’agit là d’une œuvre collective d’une élite qui se défend tant de représenter un pays «normal» qu’elle l’a plongé dans une autre normalité : celle de la corruption, matérielle, religieuse, morale, éthique. «Les services de presse et de communication de l’État, dotés de moyens financiers énormes, n’avaient qu’une mission : faire croire que les Palestiniens ne jouaient pas le jeu. […] Ce groupe concevait le processus d’Oslo comme devant, à terme, mener à l’effondrement d’Arafat et de l’OLP. […] Les militaires israéliens, même d’obédience travailliste, ne demandaient qu’une chose : réoccuper les territoires. Officiellement "pour mieux les contrôler et assurer la sécurité d’Israël", en fait, avec pour objectif l’effondrement du pouvoir palestinien laïc. […] De surcroît, en cas de prise de pouvoir par les "Palestiniens religieux", il serait plus aisé de justifier les "actions militaires" si l’ennemi se présentait comme "une organisation islamiste fanatique."[80]» On reconnaît là la stratégie de l’ennemi terrorisme «islamiste» commode. Détruire toute formation laïque, démocrate, de justice sociale ; et faire émerger des extrémistes religieux s’il y a des candidats ; maquiller, s’il n’y en a pas, des militaires en salafistes apocalyptiques – Hijra wa Takfir –, pour ensuite les combattre, enregistrer des victoires et des revers, dans une guerre sans fin. Voilà l’empire du chaos qui « laisse » sa géostratégie morbide se dérouler au jour le jour, comme la gravitation retient les objets bien ancrés au sol…
Il n’est ainsi laissé aux peuples arabes ni le temps ni les latitudes de réfléchir à la démocratie ; ils s’efforcent de rester vivants, dans une «guerre civile» simulée qui masque la vraie guerre militaire que leurs mènent leurs élites. Les Palestiniens assistent impuissants au dépeçage de leur territoire. «Malgré les accords, Israël poursuivait imperturbablement la construction de nouvelles colonies sur des terres palestiniennes. Les Arabes hurlaient à la trahison et Yasser Arafat était obligé d’effectuer un grand écart politique, de plus en plus périlleux, face aux dirigeants de l’OLP. […] L’échec ne venait pas d’un irrédentisme palestinien, mais du fait que, malgré leur supériorité écrasante, les Israéliens violaient et remettaient systématiquement en cause les textes qu’ils avaient eux-mêmes conclus en les transformant, après signature, en accords conditionnels, et ce avec la bénédiction des Américains. […]

- C’est dans ce cadre qu’Israéliens et Palestiniens se retrouvèrent avec Bill Clinton, en juillet 2000, à Camp David. […] Les discussions furent très vite bloquées. Elles furent surtout révélatrices du gouffre qui existait dans les méthodes de travail des uns et des autres. Chaque membre de la délégation israélienne avait un ordinateur portable à sa disposition, relié, par réseau Internet, à des banques de données, et toute une pile de CD-Rom contenant des logiciels de simulation, cartographiques, de calcul, de projections et d’études psychologiques sur tous les membres de la délégation palestinienne. Ces derniers, pour leur part, notaient sur de petits carnets, au crayon noir, les détails des discussions. […] Barak, la veille de son départ, ordonna à Tel-Aviv de lancer une campagne médiatique mondiale – préparée avant le sommet – sur le thème : "Israël a tout donné, Arafat a refusé. Pire, il n’a fait aucune concession, adoptant une attitude sans compromis, révélatrice de son refus de vivre en paix avec l’État hébreu." […] Une alliance objective se dessina alors entre les propos d’Ehud Barak, Premier ministre travailliste, et les positions que prenait Ariel Sharon, le leader de l’opposition du Likoud […]. Leur objectif commun était de détruire totalement toute option politique à la problématique palestinienne. "Nous n’avons pas d’interlocuteur pour parler de paix." Ce slogan fut décliné sur tous les tons par les deux hommes. […] Le 28 septembre 2000, Ariel Sharon, "pour démontrer qu’il était partout chez lui en Israël", monta sur l’Ahram al-Sharif, l’esplanade de la Mosquée, protégé par des dizaines de soldats et de policiers. […] La seconde Intifada commençait.[81]» Les caméras du monde passent en boucle les bombardements, les scènes effroyables d’enfants gisant dans la douleur, agonisant sur des brancards de fortune, dans des hôpitaux éventrés. Autant de victoires de l’armée israélienne que l’opinion internationale commence à voir d’un œil mauvais. Et dans cette opinion, des Juifs, effondrés de l’image que donne d’eux une élite entrée en démence.
La réalité de l’intransigeance palestinienne ? «[…] L’histoire de l’échec de Camp David 2000 n’est pas tout à fait celle qu’Ehud Barak et ses conseillers ont racontée quelques jours plus tard. Plusieurs observateurs informés aux meilleures sources ont pu confirmer que l’"offre" israélienne prétendument "rejetée" par la partie palestinienne n’était pas si "généreuse" que cela. Qu’il n’avait ainsi jamais été proposé 91 % de la Cisjordanie pour établir le futur État palestiniens. Et que le chef du gouvernement travailliste avait fait le pari d’un non-accord pour préparer les élections législatives de janvier 2001 qu’il a finalement perdues, face au Likoud et à son patron Ariel Sharon. Dans Le Rêve brisé, Charles Enderlin révèle qu’Ehud Barak a téléphoné à Bill Clinton dans la nuit du 1er janvier 2001 : "Arafat veut conclure un accord avant que je quitte la Maison Blanche, il veut poursuivre la négociation", dit le président américain au Premier ministre israélien qui lui répond : "Arafat alimente la violence. Je dois dire la vérité à mon opinion publique, je n’ai pas l’intention de conclure un accord quelconque avant les élections".[82]» Mettre, comme Sansal, la faute sur Arafat est si pratique ; dans les médias, c’est un sauf-conduit. Auprès des éditeurs, c’est un sésame pour de solides à-valoir.
De si mauvaise volonté les Palestiniens ? Ce sommet n’est pas le début des pourparlers ; il est le couronnement d’un processus qui court depuis des années, mené par des hommes qui ne cherchent pas la lumière ; un processus qui devait être signé officiellement et donner le coup d’envoi d’une paix réelle. Et les Palestiniens ont plus que fait leur part du chemin. En 1997, «un "accord de sécurité" avait été signé entre Israël et l’Autorité palestinienne, sous les auspices du chef de l’antenne de la CIA à Tel-Aviv, Stan Muskovitz. Cet accord confiait à Arafat une participation active à la sécurité de l’Etat hébreu, pour combattre "les terroristes", les bases terroristes, et les conditions environnementales menant au "soutien au terrorisme", en coopération avec Israël, y compris sous la forme d’"échange mutuel d’informations, d’idées et de coopération militaire". Les services de sécurité de Arafat s’en étaient fidèlement acquittés, par l’assassinat de terroristes du Hamas (déguisés en "accidents"), et par l’arrestation de ses dirigeants politiques.[83]» Ils n’obtinrent en retour que colonisation exacerbée. L’OLP a accepté de se transformer en force supplétive de la sécurité d’Israël… et Arafat sera récompensé en étant bientôt emprisonné dans les ruines de son bureau, après avoir échappé à un bombardement de la Moukata, siège de son autorité. L’extrême droite israélienne exulte. Un désespoir plus profond que jamais s’empare des Palestiniens. Qu’ont gagné les Juifs dans cette fuite en avant ? Qu’est devenue « l’âme juive » maintenant qu’elle trône au sommet d’une puissance économique, militaire et sécuritaire incontestée ?
La prostitution des valeurs du judaïsme
«Le sionisme est mort, la nation israélienne n’est plus aujourd’hui qu’un amas informe de corruption, d’oppression et d’injustice […] cinglait en 2003 l’ancien président de la Knesset et de l’Agence juive Abraham Burg. L’opposition s’est évanouie, seuls nos échecs sont retentissants […] Il faut une alternative d’espérance à la mise en ruine du sionisme et de ses valeurs par ses démolisseurs muets, aveugles, et démunis de toute sensibilité.[84]»
Les voix juives pour dénoncer la décente aux enfers de ce pays, qu’ils y vivent ou qu’ils soient de la diaspora, sont nombreuses, mais noyées dans le vacarme des bombes, des surenchères et des propagandes. Le 3 mai 2010, un collectif de personnalités et d’associations de confession juive, réuni au sein d’un groupe appelé J Call, rédige un texte alarmiste : «[…] C’est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser autour des principes suivants : 1) L’avenir d’Israël passe nécessairement par l’établissement d’une paix avec le peuple palestinien selon le principe "deux peuples, deux États". Nous le savons tous, il y a urgence. Bientôt, Israël sera confronté à une alternative désastreuse : soit devenir un État où les Juifs seraient minoritaires dans leur propre pays ; soit mettre en place un régime qui déshonorerait Israël et le transformerait en une arène de guerre civile. […] 3) Si la décision ultime appartient au peuple souverain d’Israël, la solidarité des Juifs de la diaspora leur impose d’œuvrer pour que cette décision soit la bonne. L’alignement systématique sur la politique du gouvernement israélien est dangereux, car il va à l’encontre des intérêts véritables de l’État d’Israël.» L’alignement quasi obscène de Sansal et de Cyrulnik sur la politique du Likoud est «dangereux» pour Israël, et ce sont des Juifs qui le disent.
- L’histoire de la diaspora juive dans le monde est tumultueuse. Face aux tiraillements et à des divergences inconciliables, les Juifs installés aux USA – le plus fort lobby pro-israélien du monde – abandonnent dans les années 1960 leurs rêves d’inspirer l’humanité par le bienfait, et s’accordent sur l’a minima d’un soutien à la sécurité d’Israël «à tout prix». Autour de ce dénominateur commun, s’enclenche une dynamique qui éloigne les meilleures volontés et réduit peu à peu les instances représentatives et à une concentration d’activistes radicaux[85]. Toute parole dissidente est accueillie par l’anathème et l’accusation d’antisémitisme. «À Brooklyn, à Dallas, à Paris, à Jérusalem, il suffit de dire "Judée et Samarie" pour frémir. Le Messie, symbole de l’espérance juive, n’est plus à venir : il vient !» déplore Martine Gozlan. Face à la passion, à la «volonté divin», que vaut la parole d’une humaniste attendrie par la douleur d’une famille palestinienne expulsée de sa maison, jetée à la rue par un commando surarmé ? Ceux qui, à l’instar de Boualem Sansal, savent entonner ces mots magiques : «Judée et Samarie». Ceux-là sont accueillis en stars et on leur propose de publier des livres quand bien même ils n’auraient rien à écrire ; de s’exprimer en tribune en dépit du fait qu’ils n’ont rien à dire ; de coprésider des rassemblements pour la paix alors qu’ils s’évertuent à proclamer être les tout derniers à y croire.

Martine Gozlan
«Le messianisme, en ses contours imprécis, était une dynamique, le secret de l’énergie juive : dévoyé, déformé, il se transforme en dynamite, s’inquiète encore Martine Gozlan. L’arbre de vie devient un arbre de mort. Une mystique vénéneuse fond sur Israël à la vitesse de l’éclair. Elle relègue aux oubliettes de l’Histoire juive les éclaireurs d’hier, les libéraux, les universalistes, ceux pour qui le judaïsme était passage de l’esclavage à la liberté, refus radical de l’oppression pour soi comme pour les autres. Devant cette trahison, une part d’Israël a mal : "La prostitution des valeurs du judaïsme consiste à se servir d’elles comme couverture pour satisfaire des pulsions", rageait le philosophe Yeshayahou Leibowitz. Cet imprécateur magnifique, disparu en 1994, ardemment patriote et religieux, rejetait de toute son âme la colonisation. Il avait même refusé le prix Israël que voulait lui remettre Ytzhak Rabin pour l’ensemble de son œuvre. C’est qu’il ne pardonnait pas aux travaillistes d’avoir lancé la colonisation des territoires. […] "La reconstruction du Temple n’a aucun rapport avec la réalité de la religion juive ! disait-il. Tous ces fumistes qui étudient comment fabriquer les habits de grands prêtres, au lieu de consacrer leurs réflexions et leurs efforts à la place et à la condition de la femme dans notre monde, constituent un signe de la dégénérescence du judaïsme."[86]»
Le mot «prostitution» est fort et «dégénérescence» est une ruine de l’âme humaine, juive ou non. Ils commencent à devenir récurrents dans la bouche d’orateurs inquiets. «En Israël, il n’y a plus de débat d’idées… La politique s’est en quelque sorte prostituée, et en se prostituant, elle a perdu le respect des citoyens… Le danger que court la démocratie israélienne aujourd’hui est plus grave que jamais.[87]». Les mots sont durs et ils sont de l’historien Zeev Stemhell. Après de longues années de sidération face à l’intransigeance des leaders au sein de la diaspora, les initiatives pour ramener leurs coreligionnaires à plus de raison se sont multipliées. Mais – c’est le propre des nations sûres de leur force que de se passer de solidarités encombrantes –, entre les adeptes de la paix et les jusqu’au-boutistes de la trempe de Boualem Sansal, il ne peut sortir qu’un vainqueur. La sécurité d’Israël n’étant plus en jeu, le combat devient de basse politique et, entre deux bombardements, une guerre civile qui se cantonne pour l’instant à l’épée de la plume dans les plaies des proscrits. Dans ces circonstances, la raison et les arguments de la démocratie plient souvent sous les coups de boutoir des extrémistes, des fondamentalistes portant le masque qui, c’est un comble, des valeurs universelles, qui de la laïcité.
Boualem Sansal, membre de la Tente juive
En 2011, une conférence se tient pour débattre de la légitimité à critiquer Israël ; non pas comme se la pose le goy Pascal Boniface[88] dans son livre dédié à la question, mais entre Juifs militants. «D’un côté, Jeremy Ben-Ami, le fondateur aux États-Unis de "J Street" ("la rue juive"), le lobby juif récent qui se veut tout à la fois "pro-israélien", "pro-paix", et "pro-deux-États". J Street a été conçu comme l’alternative au puissant lobby conservateur AIPAC dont les valeurs sont proches de celles du Likoud. […]
De l’autre côté, l’organisation porte-parole des communautés implantées en "Judée et Samarie" […]. Yesha chapeaute tous ceux qui vivent de l’autre côté de la ligne verte […]. La Conférence du président se targue d’évoquer les sujets qui fâchent, tout au moins au niveau théorique. On pouvait donc s’attendre à ce qu’il y ait un vrai débat politique pour ou contre la politique du gouvernement à l’égard des Palestiniens. Il n’en fut rien […]. Le fondateur de J. Street évoqua l’iceberg contre lequel se dirigeait le Titanic israélien avec sa politique palestinienne, en réitérant le besoin vital d’Israël de créer deux États le plus rapidement possible. […] Ses mots tombèrent dans le vide. Le génie du représentant des habitants de "Judée et Samarie" fut de ne jamais répondre à cette problématique mais de se lancer dans une vaste et belle évocation de la tente juive. Une tente qui, souligna-t-il, pouvait accueillir même ceux qui critiquaient la politique du pays, s’ils possédaient cet "amour d’Israël" qui est le fondement même du peuple juif.
Sans cet amour d’Israël, point de salut. Il allait de soi, aux yeux du porte-parole de "Judée et de Samarie", que le juge Goldstone, qui avait dirigé l’enquête internationale sur l’opération "Plomb durci" de l’armée israélienne à Gaza, s’était de lui-même exclu de la tente, car son rapport avait aidé le Hamas. Le fondateur de J Street, en revanche, aux dires de M. Dayan, avait eu droit de cité dans la tente à ses débuts. Mais il était tombé en disgrâce quand il avait essayé de convaincre les membres du Congrès américain de ne pas suivre automatiquement les consignes du lobby AIPAC et de soutenir le projet de paix de la communauté internationale. […] Et c’est ainsi que Dayan, un juif d’origines argentines […], s’arrogeait le droit d’exclure Ben-Ami de la tente juive. […] Dorloté par la métaphore de la tente, le public composé d’Israéliens et de leaders juif venus de la diaspora se déchaîna contre Jeremy Ben-Ami avec la subtilité d’une foule dans un cirque romain. […] Soudain, la tente juive, au pedigree millénaire, avait pris les allures d’un club politique privé avec ses propres conditions d’admission. On ne pouvait plus dissocier "la Judée et la Samarie" de l’Israël historique sans tomber dans le piège attrape-tout de la haine contre Israël. […] Pendant l’été, trois événements complétèrent ce débat autour de la tente. Jeremy Ben-Ami publia un livre intitulé A New Voice of Israël […] pour plaider la cause de J Street et la nécessité de créer deux États. La réaction des juifs opposés à J Street […] fut violente. J Street et son créateur furent accusés d’être des menteurs et des traîtres à la cause israélienne.[89]»
Si le juge Goldstone et Jeremy Ben-Ami sont non grata au sein de la tente juive, l’on peut dire que Boualem Sansal présente de nombreux atouts qui le qualifient à en être un membre indiscutable : «Je ne le crois pas, l’État juif ne pouvait être créé qu’en Palestine, en Judée et en Samarie : là sont les racines de son âme.» Il n’est pas impossible que l’on soit rentrés dans une ère étrange où la quadrature du cercle s’est doublée d’un cercle vicieux. C’est une gageure et pourtant les Arabes y sont tenus : ils doivent impérativement tendre la main à des Juifs, en Israël et au sein de la diaspora juive, pour favoriser l’émergence de forces contre lesquelles ils pourront ensuite se mesurer pour construire une paix viable. Encore faut-il que ces Juifs de bonne volonté, comme David Grossman, cessent de s’appuyer sur des bouées lestées de plomb de la trempe de Boualem Sansal… Boualem Sansal pour qui il n’y a d’Israël qu’Israël, avec la Judée et la Samarie comme ses prophètes, et Jérusalem comme capitale «propre», «bien pavée», avec des «arbres bien coiffés».
- Bien des ouvrages ont été écrits sur le rêve brisé des accords d’Oslo. La plupart par des juifs que l’on ne peut taxer de nourrir quelque haine envers leurs coreligionnaires. Ils attestent clairement que Yasser Arafat a été baladé de bout en bout, dans une stratégie qui ne s’infirme pas depuis 1967 : forcer les Palestiniens dans un retranchement, pour définir un état des lieux considéré comme définitif sur les conquêtes israéliennes, laissant la partie palestinienne désarmée, dans une zone abandonnée à la convoitise des colons ; lesquels élargissent poche par poche le territoire que les Juifs orthodoxes et la droite considèrent comme leur, parce que Dieu en a voulu ainsi.
L’on pourrait cyniquement dire que les Juifs ont raison de vouloir souscrire aux injonctions divines qui leur dictent d’étendre leur espace vital, récupérer la Cisjordanie, le plateau du Golan, leur terre promise, sainte. Ils ont les moyens et la force, les complicités internationales, des supplétifs tels que Boualem Sansal à la pelle, et les outils de propagande pour parvenir à leurs fins. Mais que l’on n’aille pas faire croire qu’en agissant ainsi ils sont dans le camp de la paix, que c’est pour la sécurité d’Israël qu’ils militent. Les Palestiniens sont-ils exempts de reproches ? Comme tous les Arabes, ils doivent découvrir les vertus de la destinée individuelle, et toutes les libertés qu’elle autorise ; des libertés qui doivent faire force de loi ; en matière de religion, de politique, de culture, de mœurs et de goûts. L’Islam a hérité de bien des pans des Livres qui l’ont précédé ; il aurait gagné à faire la part belle à l’altérité que ceux-ci professaient. Mais les peuples arabes n’ont jamais été en position de réfléchir ensemble ; ils ont commencé à subir le joug de la tyrannie exacerbée, de la part de leurs propres leaders et de leurs ennemis étrangers, à l’époque même où les autres continents ont commencé à se libérer de leurs chaînes. Lorsqu’on a l’ascendant, les négociations sont nettement plus aisées.
Au-delà de cela, les erreurs des Palestiniens, Arafat en tête, sont nombreuses et l’une d’elles a été, au bord du précipice, d’accepter la perche que lui a tendue Saddam Hussein après avoir fondé l’espoir sur le soutien de l’Arabie saoudite, de l’Égypte de Hosni Moubarak qui conspirait dans son dos. La donne est l’une des plus complexes au monde, tant il y a d’acteurs aux intérêts divergents, d’ennemis, de faux amis, de fourbes, de traîtres, à la table des négociations. Mais s’il faut relever une interprétation, une seule, qui tient de l’absurde, elle prendrait cette forme-ci : «Yasser Arafat a dit non» à la paix. Et c’est celle que nous proposent Boualem Sansal et Boris Cyrulnik. La connaissance demande patience et longueur de temps ; une éthique irréprochable. La désinformation se suffit quant à elle d’un slogan, qui se passe de justification.
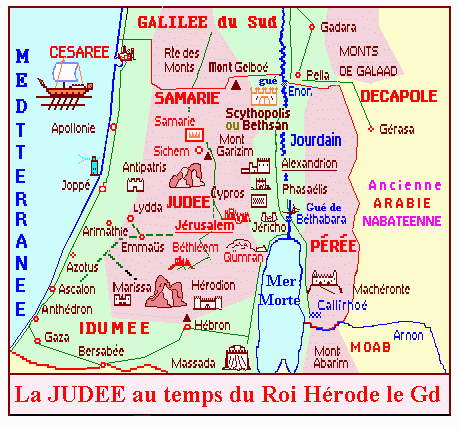
Mais suivons le diable jusqu’à sa porte ! Quelles seraient au juste les limites de la «Terre promise» ? Prudent, ou peut-être un brin machiavélique, Dieu ne l’a pas précisé. Il laisse donc à ses élus expansionnistes le soin de repousser ses frontières. Elles n’ont rien à voir avec le désir des Juifs ordinaires qui aspirent à vivre en paix et dans la tranquillité, à dormir du sommeil du juste ; elles sont tout aussi éloignées des projets initiaux des Pères fondateurs d’Israël, qui désiraient une terre d’accueil pour les leurs et non une feuille de nénuphar pour les projets impérialistes de quelques faucons de l’administration US, du Pentagone et de la CIA : Richard Perle, Armitage, Libby, et leur projet «Clean Break» qui est aussi éloigné de la théorie du complot que la Syrie et l’Irak de la souveraineté pour leurs peuples.
Mais l’on peut, sans trop forcer, parvenir à la conclusion que, de l’Égypte d’où le pharaon les a chassés jusqu’aux confins de la Babylone ancienne, soit peu ou prou la Jordanie, l’Irak et la Syrie, sans compter la corne de l’Afrique et son Éthiopie, remontant jusqu’au Maghreb et ses peuplades juives qui repoussèrent jadis les invasions arabes, tout cet immense territoire est la propriété légitime promise à «l’âme» juive. Comment contester aux Juifs d’Algérie le droit divin de revendiquer les terres et les biens que certains d’entre eux possédaient avant les foutouhates islamiques ? Il y a là motif objectif à étendre la « terre promise » jusqu’aux confins des îles Canaries. Voilà les raisons, éloignées de la raison, qui rendent impossible la paix. Impossible parce que le but est la guerre et que ceux qui ont les pouvoirs et les moyens seraient promis à de déplorables fatalités si la paix revenait. Et pour masquer cette réalité, des hommes comme Boualem Sansal, Kamel Daoud, Yasmina Khadra, Mohammed Sifaoui, etc., sont rémunérés, promus, édités, interviewés, célébrés, pour dire noir quand la réalité est blanche et blanc quand les évidences montrent noir. Sansal n’est pas le chaperon blanc de la paix, c’est le chevalier noir de l’apocalypse.
- Plutôt que de militer pour des législations sur les mensonges prononcés par des anonymes sur un insaisissable Internet, on devrait se pencher sur ceux écrits et signés par des écrivains de «l’establishment» tels que Sansal et Cyrulnik et qui énoncent d’immenses bobards ; non pas pour les interdire dans un monde de marché libre, mais pour y apposer, comme sur des paquets de cigarettes, la mention salvatrice : «Nuit gravement à la santé» mentale des lecteurs.
Grande cause, petite conclusion
Tura mi tefhemđ żrit, iγis-is d keččini
Toi qui te proclames savant, observe bien ! La fêlure, c’est toi.
Aït-Menguellat
Réfuter, continuer à réfuter, encore et encore ; ce peut être usant et vain quand une armée de faussaires est mise dans des conditions idéales, missionnée pour fausser, désinformer, mentir, miner la connaissance, troubler le sens. La vérité a mauvaise presse ; elle relève, disent certains éditorialistes, de «la tyrannie de la transparence». Une légende kabyle raconte comment un homme bon, pêcheur de son métier, s’est vu offrir par un génie sorti du néant de satisfaire pour lui un souhait, quel qu’il soit. Les besoins d’un Kabyle étaient sommaires et ses ambitions raisonnables ; si bien qu’au lieu de réclamer une montagne d’or qui lui aurait permis de pourvoir à tous ses besoins, il réclama une denrée prosaïquement utile.
C’était l’époque des caravanes montant du désert, traversant des espaces hostiles pour rapporter une matière essentielle : le sel indispensable à la conservation des denrées alimentaires, parmi lesquelles le poisson dont il avait fait métier. Une machine à fabriquer du sel, sur place, voilà qui ferait le bonheur de notre homme ; il n’aurait plus à se ruiner pour en acquérir et pourrait même gagner davantage en vendant ses excédents autour de lui. Ce qui fut demandé fut fait. Dès que la machine se mit en marche, un fil ininterrompu de sel d’une pureté éclatante commença à se déverser sur le sol, formant un tas de cette précieuse marchandise. Puis l’homme fit un autre tas, puis un autre encore et, bientôt, tout autour de lui, il y avait assez de sel pour des années de ses propres besoins ; il laissa couler le bien en se disant que ce don des éléments allait lui assurer une immense richesse. La journée tirait à sa fin. Il ne lui restait plus qu’à tout arrêter. Il s’avisa soudain qu’il ignorait comment le génie lui avait montré comment mettre l’engin en marche ; il n’avait pas songé à lui demander de lui apprendre à l’éteindre. Imperturbablement, le sel se déversait, menaçant de submerger tout l’espace. Que faire ? La montagne de sel commençait à déborder hors de sa propriété. Pris de panique, il sortit sa chaloupe, embarqua la machine, se rendit en haute mer, et la jeta dans les flots. Depuis ce temps, celle-ci continue de produire du sel ; c’est cela qui aurait rendu impropre à la consommation l’eau jadis potable des océans.
- C’est un peu cela, les élites négatives, faussaires, toxiques ; elles déversent du mensonge, encore et encore, irréparablement, comme sous l’empire d’un génie inaccessible ; et nul n’est en mesure de mettre fin à leur horrible besogne. L’océan de la connaissance collective est aujourd’hui saturé du sel fétide d’une mécanique infernale. L’eau est une denrée indispensable à la vie et l’information est l’élément fondamental de la civilisation. On sait que la machine à produire du sel est une légende ; les médias sont quant à eux vraiment d’inlassables boites à débiter le mensonge. Il reste encore des sources d’eau pour épancher la soif de l’humanité ; les glaciers qui les alimentent sont en passe de disparaître et les nappes souterraines sont attaquées à l’acide par des machines démoniaques de fracturation. Les technologies offrent des moyens de dessaler l’eau des mers ; mais pour une goutte qui étanche la soif, il y a de vastes marées saumâtres, empoisonnées, par la main d’hommes mus par une autre mécanique infernale : «le marché libre». Quant à la connaissance… Pour maintenir la viabilité de la société, de la civilisation, il faut aller puiser aux glaciers de plus en plus rares de l’information ; et inventer des machines Ce n'est là un travail d'intellectuelAlbert Camus, Albert Londres… La morale, la décence élémentaire, un soupçon d’éthique interdiraient à Sansal de se revendiquer de ces grands hommes. Après avoir suivi le Juif errant dans les abysses de l’humanité, le voyant traqué, assoiffé, affamé, torturé, humilié, assassiné, Albert Londres l’a accompagné de l’autre côté du miroir. Il a vu quand celui-ci est arrivé. Il l’a vu basculer du statut de proscrit à celui de futur persécuteur. Il l’a accompagné en Palestine et il a assisté à toutes les duplicités, à toutes les manipulations, toutes les trahisons qui firent passer le sionisme de chimère à la réalité. Revenu à Paris, il apprend que les massacres ont commencé en Palestine. Il abandonne tout et repart.
Comment résumer le passage de presque rien à presque tout pour un peuple ? Tout ce qu’on dit est un parti-pris, tout ce qu’on omet est suspect. Tout raccourci devient manipulation. Il faudrait lire toute la documentation de l’époque pour embrasser la situation. Il y a d’un côté le peuple juif avec lequel ses élites prennent fait et cause, ses milliardaires apportent les fonds, les diplomates les appuis, les militaires le savoir-faire de guerre et les politiques les stratégies. De l’autre, les paysans arabes qu’abandonnent les leurs. Entre les deux, «cent quarante soldats de sa Majesté» ; les milliards du Baron de Rothschild ; et un véreux Lord Balfour qui enflamme pour cent ans une région par une simple déclaration. D’un côté Le Juif errant arrivé ; de l’autre l’errance des Palestiniens a commencé.
Ce sont les siècles les plus ténébreux qui ont donné naissance aux grands hommes ; et c’est dans ces conditions affreuses que des éditeurs ont honoré leur métier en les publiant. Nous vivons dans un monde terrible ; et le pire n’est pas là où on l’imagine. Le pire dans une société qui doit échapper à un destin funeste, vient de ceux qui sont sur des tribunes usurpées, haranguant les foules pour les orienter vers le désordre du sens.
Et Camus, Londres, avaient cette aura pour sortir leurs congénères de l’obscurité. Seraient-ils de ce monde ? Albert Londres ne se lasserait de remettre le métier à l’ouvrage ; Albert Camus ne cesserait de remonter le Rocher de l’information ; car la cause est plus noble que jamais ; une cause indispensable : une cause pour les Méditerranéens. La cause primordiale, celle qui subsume toutes les autres : démasquer les imposteurs, les affreux imposteurs, qu’ils usent d’armes automatiques ou d’épées trempées dans la plaie des victimes ; mettre à nu leurs trahisons ; une cause pour les damnés aussi, afin de leur faire comprendre que l’heure est venue de se hausser à la mesure du défi, pour se débarrasser des tyrans qui leur barrent le chemin vers leurs richesses ; qui leur barrent le chemin vers la connaissance. Offrir prédominance à la connaissance ; car c’est elle qui élève et qui découvre les chemins de l’amitié, de la tolérance, de l’émancipation, tout en laissant la place à la piété individuelle ; la connaissance pour faire de ce bassin méditerranéen un havre de paix naturelle, quand Sansal et Cyrulnik entraînent tout le monde dans les pistes empoisonnées d’une paix impossible.
«Celui qui voudrait se nourrir de la guerre devra être rentable en retour», disait Bertolt Brecht. 15 euros les 45 pages, dont les plus vraies ont ét.é puisées sur Wikipédia, confortablememt assis ans un salon un Miidi de France ... 15 euros, c'est faire payer cher la foutaise
- Monsieur SansalCyrulnik, la connaissance n’est pas une marchandise. On n’en fait pas commerce. La connaissance est un bien universel. Comme l’air et l’eau, elle doit être offerte. Pourtant, elle n’est pas donnée. Reporter de guerre est un métier à haut risque, enquêter sur les crimes des puissants se paie souvent de plusieurs balles dans la tête. Et ceux qui s’y résolvent ne sont pas suicidaires ; ils ne le font pas pour s’enrichir ; ils le font par devoir, par nécessité. C’est un engagement d’hommes et de femmes dévoués, au service de leurs semblables, des démunis ; pour contribuer à mettre fin à leur calvaire ; au service de tous les autres aussi, pour que nul n’ait à se promener à travers son existence en aveugle. Jeter une lumière crue sur la réalité, telle est la mission d’un journaliste. À cette aune, les faussaires sont des criminels contre l’humanité.
La connaissance est un bien universel. Comme l’air et l’eau, elle doit être offerte. Pourtant, elle n’est pas donnée. Reporter de guerre est un métier à haut risque, enquêter sur les crimes des puissants se paie souvent de plusieurs balles dans la tête.
Anthony Feinstein est un psychiatre. . Il a enseigné à l’université de Toronto, et dirigé un hôpital psychiatrique à Londres. Son travail l’a conduit à s’intéresser aux Reporters de guerre. Ils risquent leur vie pour l’Information. Nous avons vu que Sansal et Cyrulnik jouent la vie des autres, par la désinformation. Pour Janine Di Giovanni, il est absolument nécessaire d’avoir vu de ses propres yeux ce dont elle parle dans ses papiers. "Qu’est-ce que c’est que ce bazar sur la ligne de front ? Qu’est-ce qui s’est passé dans cette bataille ? Je sens que l’on ne peut rien écrire si on n’a pas vu. On ne peut tout simplement pas en parler. Je pense que c’est fondamentalement malhonnête de recueillir l’information auprès des autres journalistes et d’écrire sur cette base. […] Tout un tas de journaliste ont couvert la Tchétchénie à partir de Moscou. Le lecteur lambda qui vit à Londres ne le sait pas et il pourrait penser que les journalistes ont été plongés dans cette guerre. Mais ils n’y étaient pas. Ils étaient confortablement assis dans leurs fauteuils dans un hôtel confortable."» Quel degré de malhonnêteté peut-on atteindre si en plus on prend fait et cause pour celui qui bombarde ? En se donnant pour seule peine de son travail fétide un regard superficiel sur une fiche Wikipédia.
«Maggie O’Kane, du Guardian, a évoqué la même idée lorsqu’elle m’a expliqué que si les journalistes de guerre voulaient écrire sur la guerre ou sur les victimes, ils ne pouvaient pas leur tourner le dos dès que le danger se faisait trop pressant. : "C’est comme ça que j’ai vu ma mission à Bagdad dans les années 90, alors que la coalition s’apprêtait à bombarder la ville. Quinze d’entre nous ont décidé de rester sur place. Moi, je suis restée parce qu’un collègue m’a dit : ‘il y a vraiment peu d’occasions de se rendre un peu utile, et là, c’en est une’ […]. La même chose est arrivée en Bosnie, cette sensation que nous, la presse, devions y être. Nous avions à stopper cette folie. C’est pourquoi je fais ce travail. […]’".»
Stopper la folie, Monsieur Sansal, Monsieur Cyrulnik ; non contribuer à l’engendrer par la désinformation ; à raison d’1 euro les trois pages, soit une fois et demie le coût d’une photocopie.
Informer n’est pas une rente, mais un métier. «C’est risqué parce qu’il faut que le boulot soit fait» dit tranquillement James Nachtwey. «À travers vos photos. Voilà. Vous devez vous inscrire dans le même espace qu’eux, et, quand vous y êtes, vous courrez les mêmes risques qu’eux. Donc vous partagez ça avec ceux que vous photographiez. Mais ce n’est jamais par goût du risque.[90]»
Eux, ce sont les damnés de la terre, pas les lobbys les plus influents, les plus riches, les plus puissants ! Chris Hedges est revenu vivant mais anéanti des théâtres de guerre qu’il a couverts. Quand ils franchissent le pas de la grandeur, les lanceurs d’alerte ne présentent pas la facture aux bénéficiaires de leur courage ; ils savent d’emblée qu’ils s’apprêtent à tout perdre : leur travail, leur salaire, leur carrière, leur quiétude, parfois leur vie. Les États-Unis se sont honorés en créant un statut protecteur pour eux ; en France, ils sont livrés à une précarité qu’aucun être vivant ne devrait avoir à subir[91].

Jérusalem, vers 1910, "Mur des Lamentations"
Viendra peut-être le jour où, comme dans l’univers orwellien qu’instaurent des hommes tels que Boualem Sansal, nous serions réduits à lire clandestinement. Inconcevable dites-vous, dans le monde occidental tout au moins ? On aurait tort de penser que l’Holocauste est affaire du passé et que le Maccarthysme a vécu. Parfois, le passé ressurgit sans crier gare : comme «quand le FBI, par exemple, a rendu visite à un employé de la librairie d’Atlanta après qu’il ait été vu en train de lire un article intitulé "Armes de stupidité massive" et dénonçant la guerre en Irak, les motifs de son intervention semblaient bénins : un citoyen inquiet ou zélé avait remarqué les mots "armes" et "massive" et cru bon d’alerter le FBI pour activité suspecte ; les agents de base, déconsidérés depuis que le FBI a été accusé, par ses négligences, d’avoir contribué au 11 septembre, ont préféré prendre au sérieux l’information ; Marc Schultz s’est soudain trouvé contraint d’expliquer aux deux hommes du FBI pour quelles raisons il avait de telles lectures et de les laisser fouiller sa voiture, tout en se demandant comment il ferait à l’avenir pour échapper à une telle surveillance.[92]»
Toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont la face noble du journalisme, qui auraient des choses à instruire à Boualem Sansal, pourraient fort bien devenir des lectures dangereuses.
Boualem Sansal, qui a eu au moins trente ans pour couvrir un théâtre de guerre, non sur un sol étranger, mais sur celui de son peuple martyrisé. Qu’a-t-il fait quand sévissaient manipulations policières, chefs religieux plus ou moins affiliés aux services de renseignement, hommes politiques corrompus jusqu’à la moelle, militaires remontés aux psychotropes, tout ce monde allié à des intérêts étrangers qui lorgnaient sur l’un des sous-sols les plus riches du monde ? À quoi s’occupait-il pendant ce temps ? Quand l’imbécilité est magnifique, elle baisse la garde. Elle fait étalage de sa propre bassesse… Il restait une qualité que nous n’avions pas explorée entièrement chez Boualem Sansal. «Quand j’ai pris la plume, disait-il, c’est tout naturellement que j’y suis allé, comme [camus] l’avait fait en son temps, la tremper dans la plaie, et à ce moment l’Algérie étaient une immense plaie. Je ne suis pas allé loin, j’ai ouvert ma fenêtre, le sang coulait sous nos pieds à gros bouillons et l’air était tout entier à la folie».
Qui, mieux qu’Albert Londres, peut lui donner la réplique cinglante qu’il mérite ? Mort, dites-vous, Albert Londres ! C’est cela qui distingue le géant du brimborion. Les grands hommes ne meurent jamais. Et si Albert Londres devait se trouver dans l’assistance que toise Sansal du haut des tribunes méprisantes ouvertes à lui, il lui dirait ceci : «L’insolence n’est pas toujours une mauvaise chose, encore faut-il qu’elle s’adresse aux grands ! […] Quand on a si longtemps inspiré la pitié, il est tentant de vouloir inspirer le respect. Mais à l’heure où on fait peau neuve, mon ami, on ne se met pas au balcon, autrement on attrape des maladies ![93]»
Lounis Aggoun
[1] Monika Borgmann, Une mort à la lettre, éditions L’Harmattan, 2013.
[2] Jean de la Guérivière, Les Fous d’Afrique. Histoire d’une passion française, éditions du Seuil, 2001.
[3] Béatrice Patrie, Emmanuel Espaňol, Méditerranée. Adresse au président de la République Nicolas Sarkozy, éditions Sindbad Actes Sud, 2008.
[4] Philippe Delmas, Le Bel avenir de la guerre, éditions Gallimard, 1995, p. 9.
[5] Voir le documentaire d’Eric Schlosser, « 1980, Accident nucléaire en Arkansas », diffusé sur Arte le 21 juillet 2010.
[6] Philippe Delmas, Le Bel avenir de la guerre, éditions Gallimard, 1995, pp. 179-180.
[7] Philippe Delmas, Le Bel avenir de la guerre, éditions Gallimard, 1995, pp. 180-181.
[8] Boualem Sansal Le Serment des Barbares, éditions Gallimard, 1999.
[9] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 208.
[10] L’ouvrage de l’ex-agent du DRS, Abdelkader Tigha, retrace bien les périls mortels qui guettent ceux parmi ses agents qui sont simplement suspects de ne pas être engagés à fond dans la mécanique de mort. Contre-espionnage algérien : Notre guerre contre les islamistes, éditions Nouveau monde, 2008.
[11] Lire à cet égard le prophétique ouvrage de Jean-François Revel La Connaissance inutile, éditions Grasset, 1988.
[12] Patrick Lamarque, Le Désordre du sens. Alerte sur les médias, les entreprises, la vie publique, éditions ESF, p. 31, 1993.
[13] Voir Pascal Boniface, Les Intellectuels faussaires, éditions Jean-Claude Gawsewich, lire aussi le livre collectif Les éditocrates, aux éditions La Découverte, etc.
[14] Boris Cyrulnik, Boualem Sansal, L’Impossible paix en Méditerranée, édition de l’Aube, p. 52, 2017.
[15] Pierre-André Taguieff, La République menacée, éditions Textuel, p. 50, 1996.
[16] Alain Ménargues, Le Mur de Sharon, éditions Presses de la Renaissance, p. 52, 2004.
[17] Emmanuel Faux, Le Nouvel Israël. Un pays en quête de repères, éditions Seuil, pp. 215-217, 2008.
[18] Sélim Nassib, Yolande Zauberman, L’Histoire de M, éditions du Seuil, 2019, p. 94.
[19] Sélim Nassib, Yolande Zauberman, L’Histoire de M, éditions du Seuil, 2019, p. 54.
[20] Sélim Nassib, Yolande Zauberman, L’Histoire de M, éditions du Seuil, 2019, pp. 75-76.
[21] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, pp. 197-198.
[22] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, pp. 198.
[23] Diana Pinto, Israël a déménagé, éditions Stock, 2012, p. 59.
[24] Sélim Nassib, Yolande Zauberman, L’Histoire de M, éditions du Seuil, 2019, pp. 94-95.
[25] Lire à cet égard l’ouvrage de Jean Monneret, La Tragédie dissimulée. Oran, 5 juillet 1962, éditions Michalon, 2006.
[27] https://www.cairn.info/revue-revue-d-histoire-de-la-shoah-2016-2-page-535.htm
[28] Lire La Conférence de la Honte pour voir la façon ignoble dont les plénipotentiaires occidentaux évoquaient cette population juive ; Lire Ces Juifs dont l’Amérique ne voulait pas, pour mesurer l’antisémitisme galopant aux USA, surtout dans les hautes sphères politiques et militaires.
[29] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, pp.38-39.
[30] Patrick H. Mercillon, Ismaël-Israël. 100 ans de guerre pour la Terra sainte, éditions EPA, 1979, p. 141.
[31] Patrick H. Mercillon, Ismaël-Israël. 100 ans de guerre pour la Terra sainte, éditions EPA, 1979, p. 140.
[32] Mohammed Sifaoui, Une Seule voie : l’Insoumission, éditions Plon, p. 247, 2017.
[33] Marc Hillel, Israël en danger de paix, éditions Fayard, 1968, pp. 227-228.
[34] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, p. 205.
[35] Marc Hillel, dans Israël en danger de paix, 1968, p. 318.
[36] Moshe Dayan, au Magazine Look, cité par Marc Hillel, dans Israël en danger de paix, 1968.
[37] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, p. 128
[38] Alain Joxe, L’Amérique mercenaire, éditions Stock, 1992.
[39] Emmanuel Todd, Après l’Empire, éditions Gallimard, 2003, p. 146-162.
[40] Michel Castex, Un mensonge gros comme le siècle, éditions Albin Michel, 1990.
[41] Scott Ritter, Les Mensonges de George W. Bush, éditions Le Serpent à plumes, 2004 ; Hans Blick, Irak. Les armes de destruction massive, éditions Fayard, 2004.
[42] David Ben Gourion Israël, années de lutte, éditions Flammarion, 1964, p. 50.
[43] Cécilia Gabizon, Johan Weisz, OPA sur les Juifs de France. Enquête sur un exode programmé 2000-2005, éditions Grasset, 2006.
[44] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, pp. 85-86.
[45] Erik H. Cohen Heureux comme Juifs en France – étude sociologique, éditions Elkanna et Akadem, 2007.
[46] Alain Ménargues, Le Mur de Sharon, éditions Presses de la Renaissance, 2004, 66.
[47] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 97 ; 99.
[48] Patrick H. Mercillon, Ismaël-Israël. 100 ans de guerre pour la Terra sainte, éditions EPA, 1969, p. 417
[49] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 89 90.
[50] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 95.
[51] Diana Pinto, Israël a déménagé, éditions Stock, 2012, p. 99.
[52] Schlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé,éditions Fayard, 2009.
[53] Alain Ménargues, Le Mur de Sharon, éditions Presses de la Renaissance, 2004, 70-73.
[54] Schlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé,éditions Fayard, 2009, pp. 253-254.
[55] Yehuda Lancry, Le Messager meurtri. Mémoires d’un ambassadeur d’Israël, éditions Albin Michel, 2010, pp. 153-155.
[56] J. J. Goldberg, The Jewish Power, inside the American Jewish Establishment, Addison-Wesley publishing company, inc., 1997.
[57] Nancy Snow, Information War. American Propagande, Free speech and Opinion control since 9-11, Seven Stories Press, 2003.
[58] Bill Kovach, Tom Rosenstiel, Blur, How to know what’s true in the age of information overload, éditions Bloomsbury, 2010.
[59] À titre d’exemple, Censored 2009 - The top 25 stories censored of 2007-08, dirigé par Peter Philips et Andrew Roth, Seven Stories Press, 2008.
[60] Black List. Quinze grands journalistes brisent la loi du silence, ouvrage dirigé par Christina Borjesson, les Arènes 2003 ; Media Control – Huit grands journalistes américains résistent aux pressions de l’administration Bush, Les Arènes, 2006.
[61] Lire Le Pique-nique des vautours, de Greg Palast, éditions Denoël, 2013.
[62] Lire Warriors of Disinformation. How lies, Videotape, and the USIA won the Cold War, d’Alvin A. Snyder, Arcade Publishing (New York), 2012.
[63] Michael R. Beschloss et Strobe Talbott, At The Highest levels, the inside story of the end of the Cold War, éditions Little, Brown and Company, 1993, p. 114.
[64] Michael R. Beschloss et Strobe Talbott, At The Highest levels, the inside story of the end of the Cold War, éditions Little, Brown and Company, 1993, p. 117.
[65] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, p. 87.
[66] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 162.
[67] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 155.
[68] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 148
[69] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, p. 130
[70] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 190.
[71] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, p. 81
[72] Emmanuel Faux, Le Nouvel Israël, éditions Seuil, 2008, p. 194
[73] Emmanuel Faux, Le Nouvel Israël, éditions Seuil, 2008, p. 204.
[75] Michel Gurfinkiel, présenté par Vladimir Fédorovsky, Le Testament d’Ariel Sharon, éditions du Rocher, pp. 53-56, 2006.
[76] Marc Hillel, Israël en danger de paix, éditions Fayard, 1968.
[77] Alain Joxe, L’Amérique mercenaire, éditions Stock, pp. 119-120, 1992.
[78] Emmanuel Todd, Après l’Empire. Essai sur la décomposition du système américain, éditions Gallimard, 2002, p.158.
[79] Emmanuel Faux, Le Nouvel Israël, éditions Seuil, p. 238, 2008.
[80] Alain Ménargues, Le Mur de Sharon, éditions Presses de la Renaissance, 2004, p. 88.
[81] Alain Ménargues, Le Mur de Sharon, éditions Presses de la Renaissance, 2004, 88-94.
[82] Emmanuel Faux, Le Nouvel Israël, éditions Seuil, 2008, p. 235.
[83] Alain Ménargues, Le Mur de Sharon, éditions Presses de la Renaissance, 2004, p. 103.
[84] Emmanuel Faux, Le Nouvel Israël, éditions Seuil, 2008, p. 233.
[85] J. J. Goldberg, The Jewish Power, inside the American Jewish Establishment, Addison-Wesley publishing company, inc., 1997.
[86] Martine Gozlan, Israël contre Israël, éditions de l’Archipel, 2012, pp.75-76 ; 80.
[87] Emmanuel Faux, Le nouvel Israël, édition du Seuil, 2008, p. 209.
[88] Pascal Boniface, Est-il permis de critiquer Israël ?, éditions Robert Laffont, 2003.
[89] Diana Pinto, Israël a déménagé, éditions Stock, 2012, pp. 151-158.
[90] Anthony Feinstein, Reporter de guerre. Ils risquent leur vie pour l’information, éditions Altipresse, 2013, pp. 87-88.
[91] Florence Hartmann, Lanceurs d’Alerte. Les mauvaises consciences de nos démocraties, éditions Don Quichotte, 2014 ; François Bringer, Ils avaient donné l’alerte. Whistle-blowers, ces agents qu’on a fait taire, éditions du Toucan, 2011.
[92] Corey Robin, La Peur, Histoire d’une idée politique, éditons Armand Colin, 2004, p. 225.
[93] Albert Londres, Le Juif errant est arrivé, éditions Albin Michel, 1929, p. 282.


- retour à l'accueil








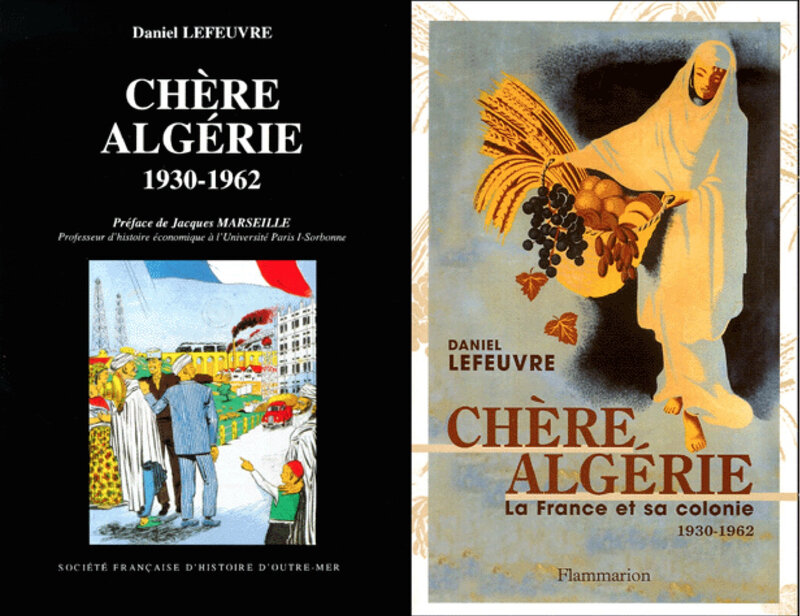


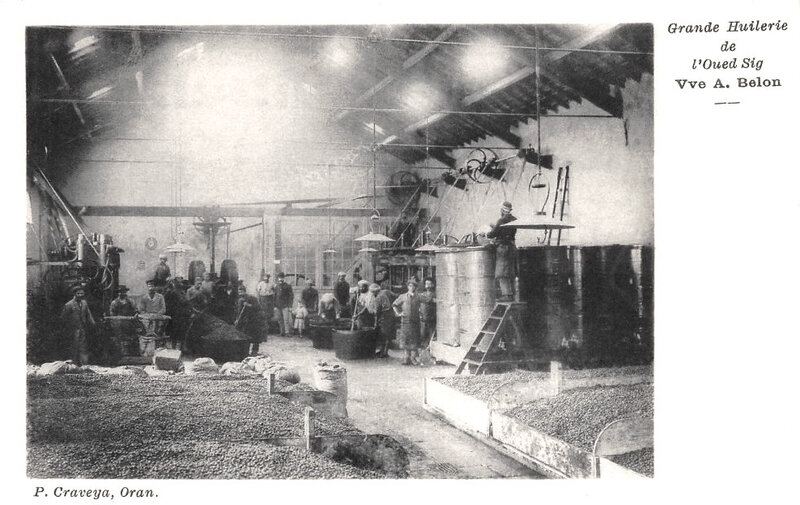
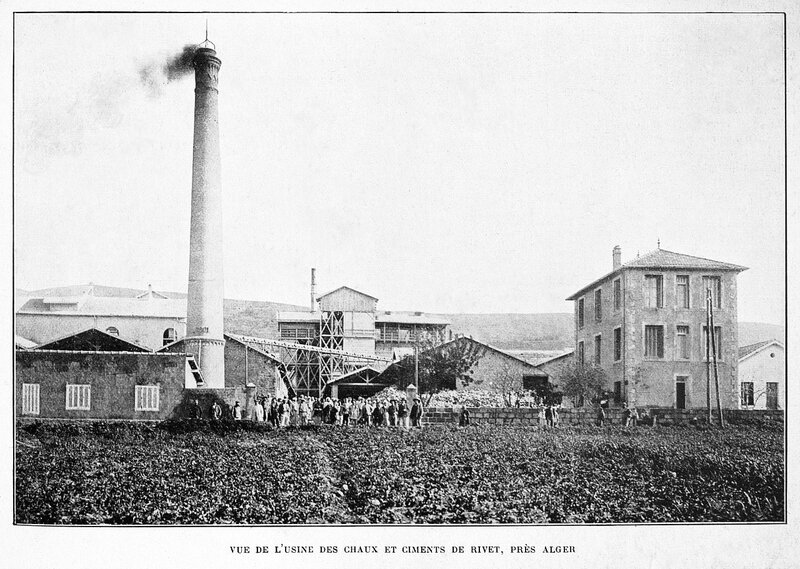
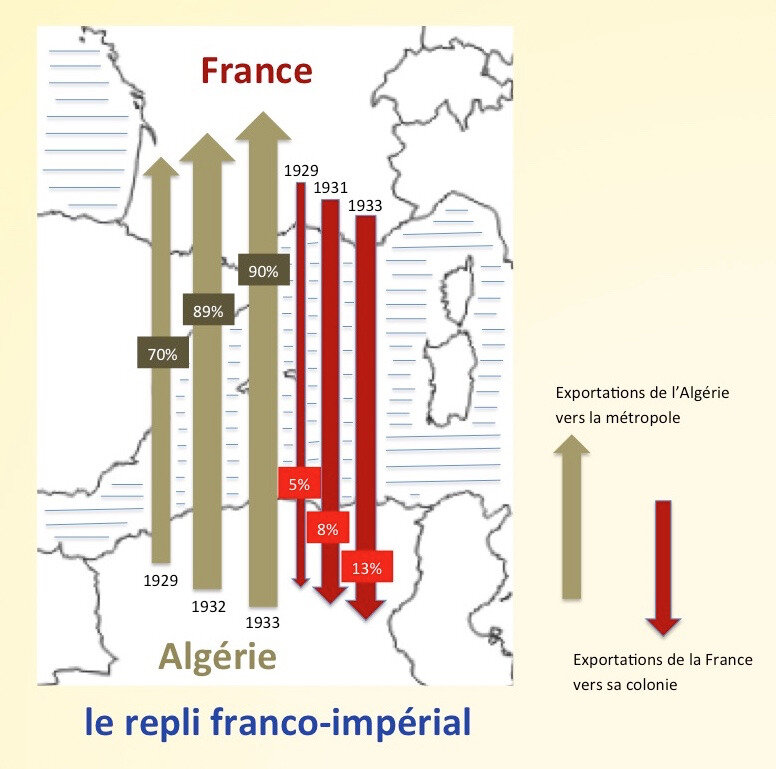




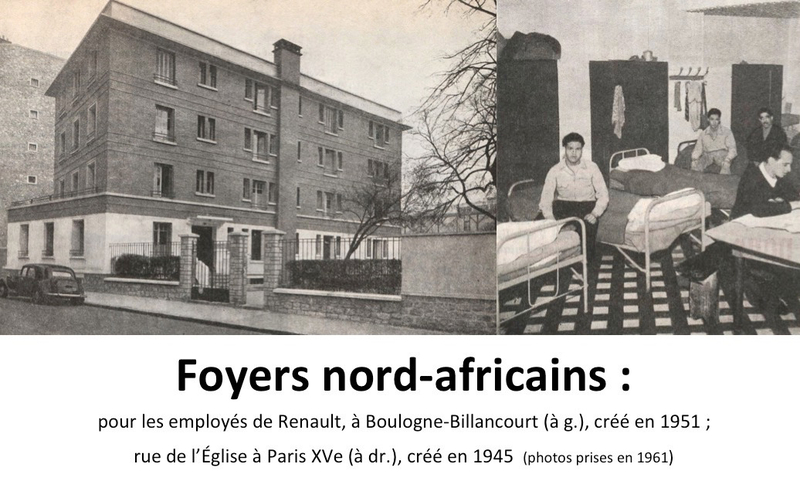









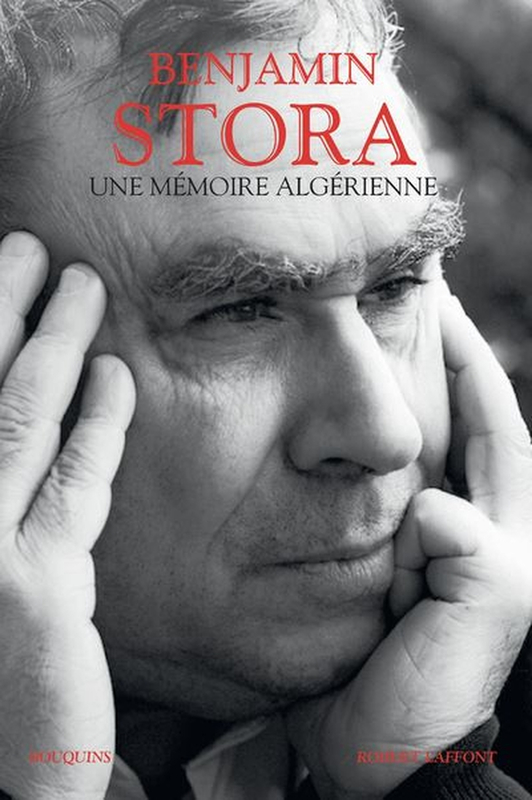






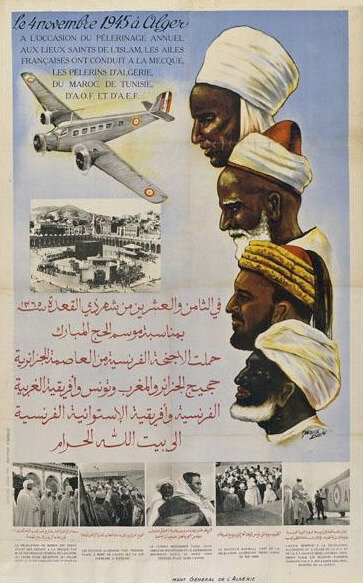




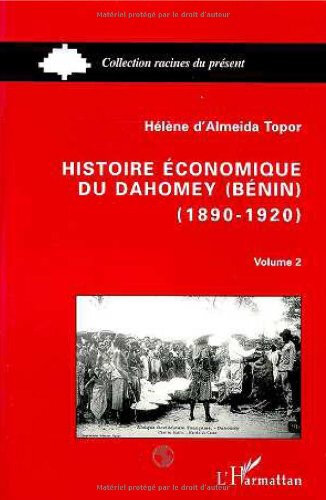
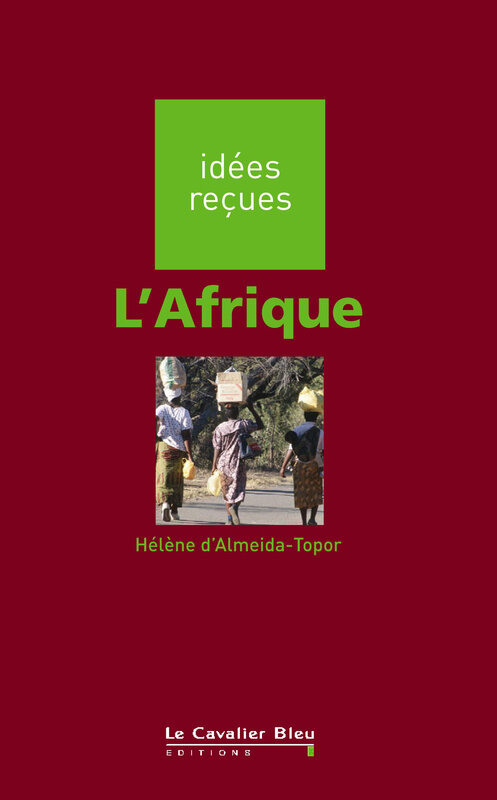





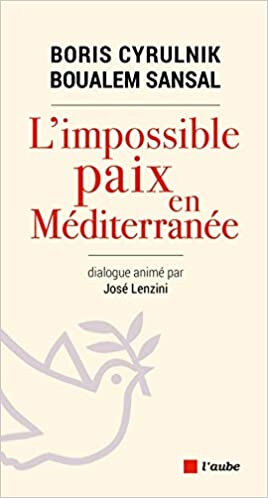







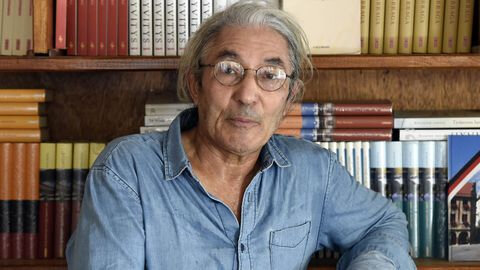


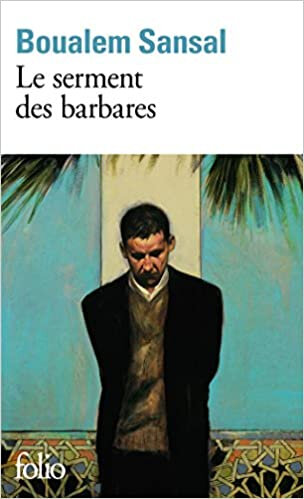


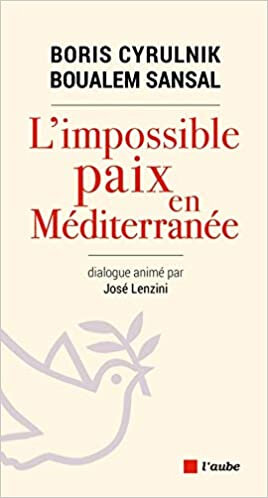
 "
"





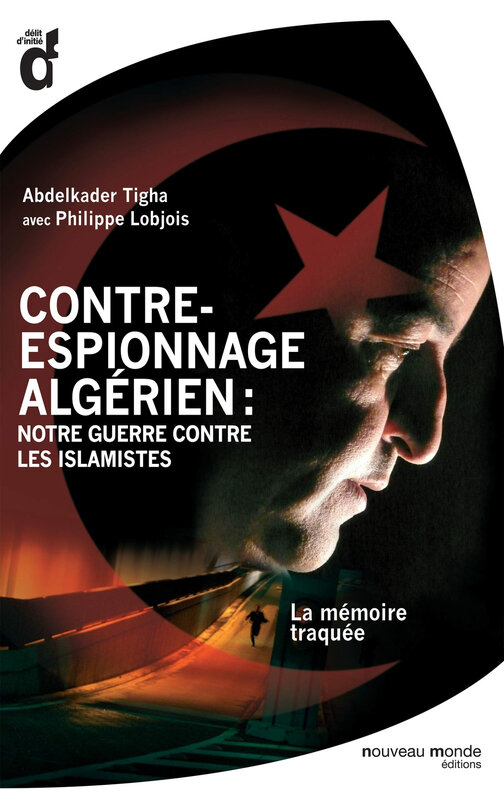
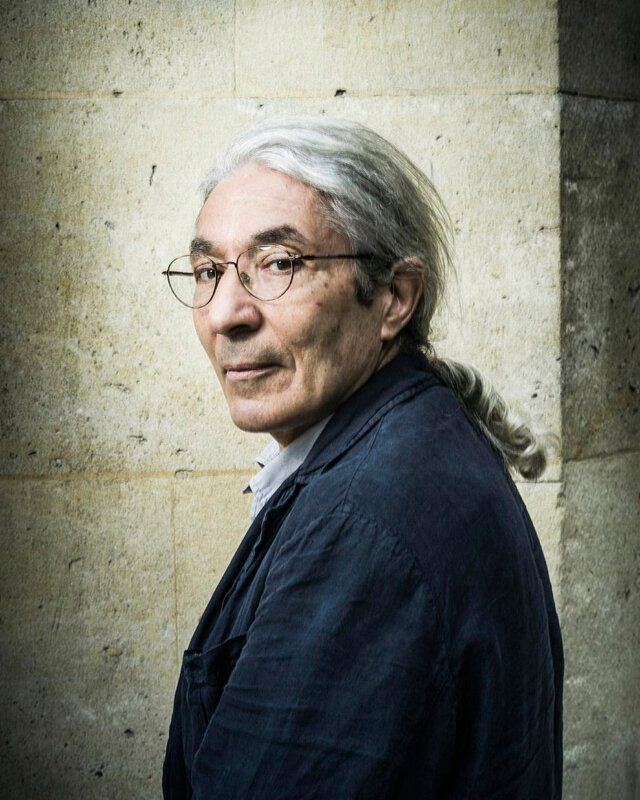








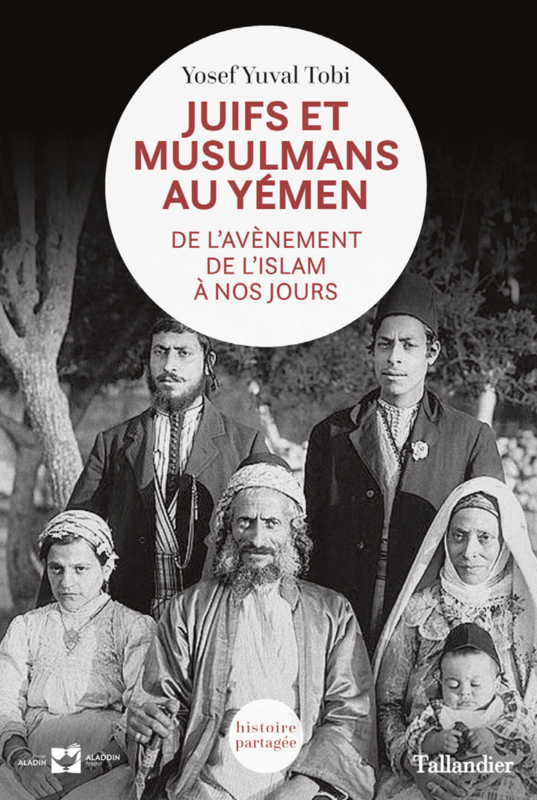




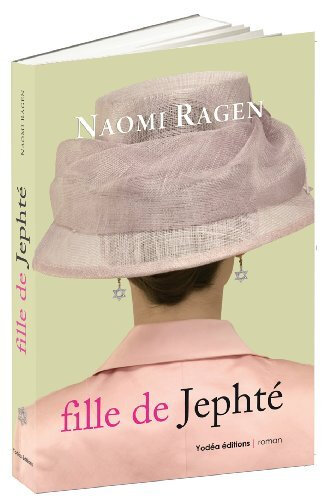


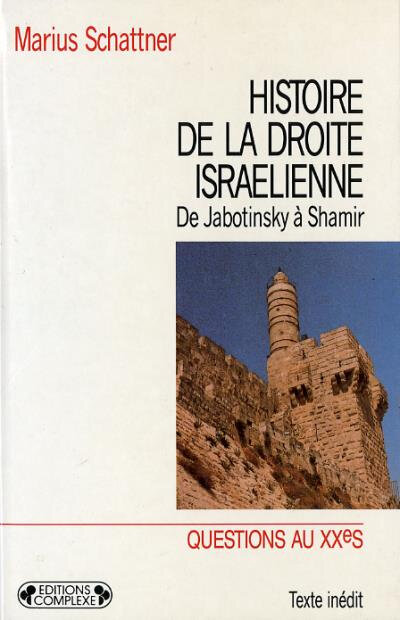










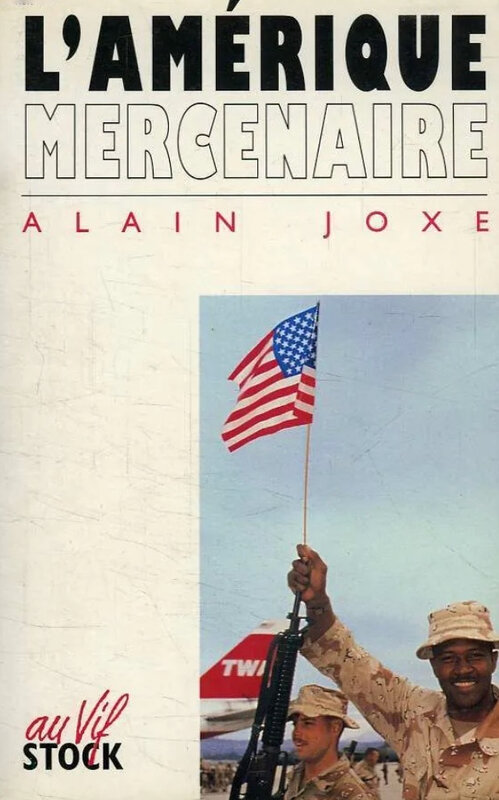





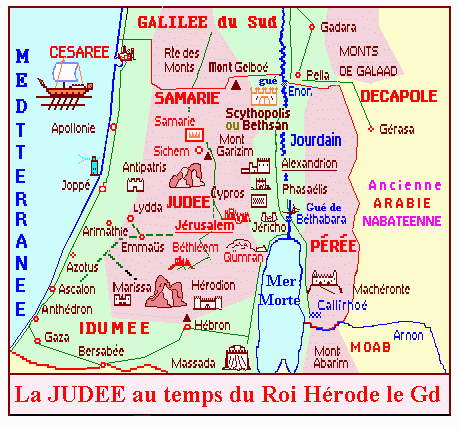













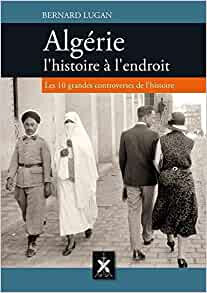




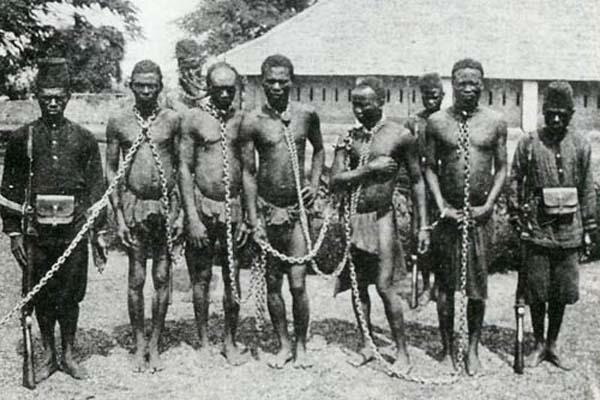
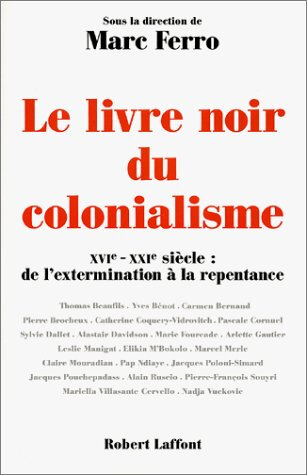








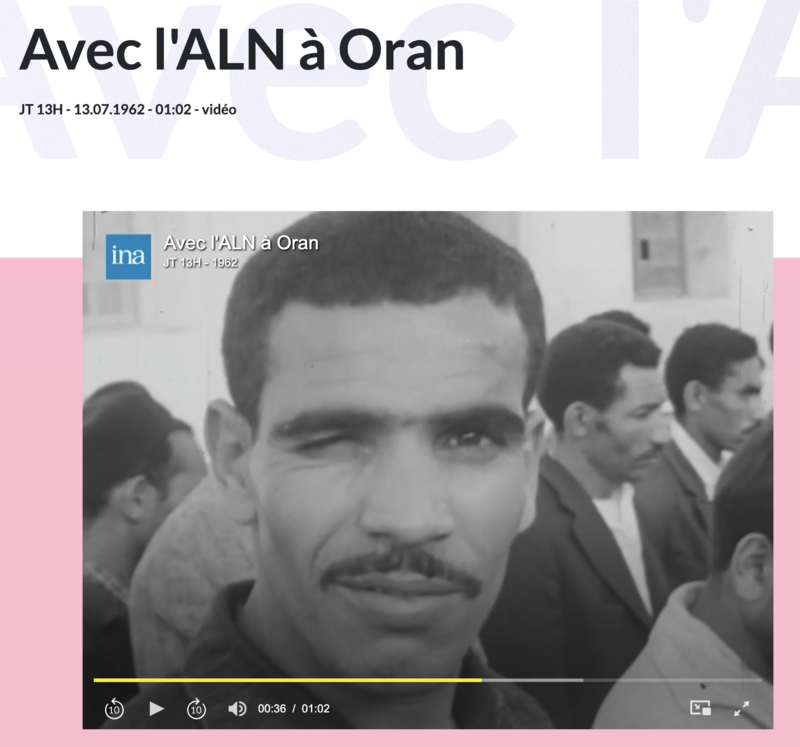


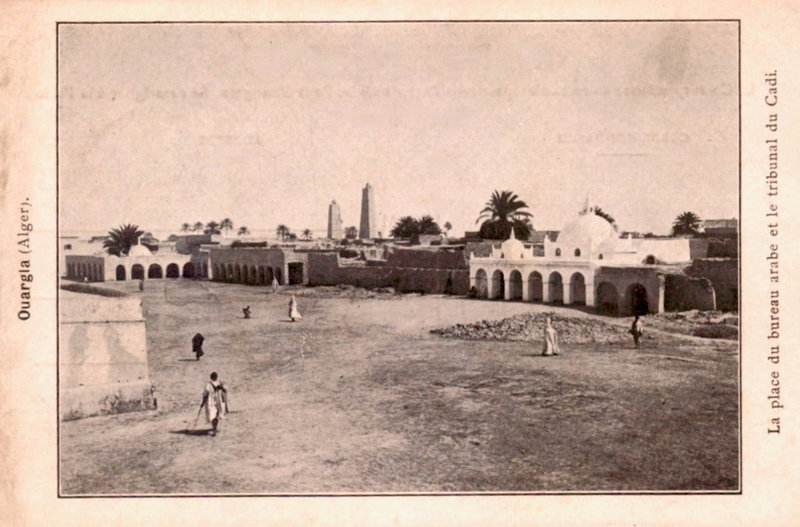



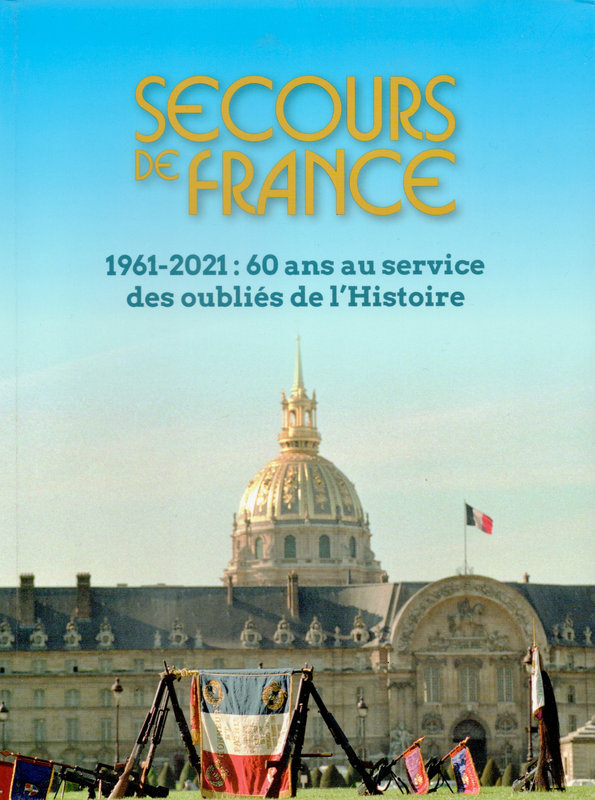











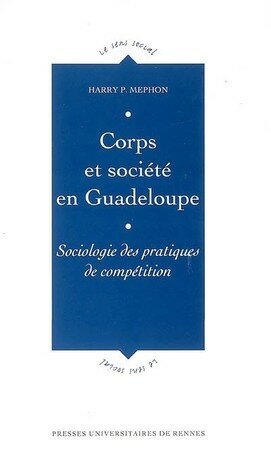
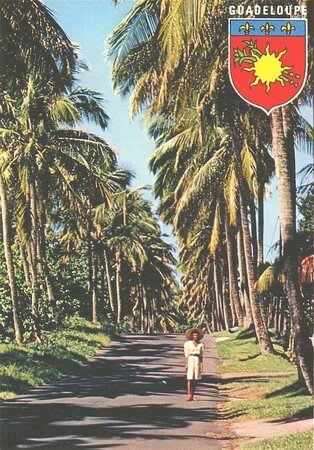
































/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)