exposé : la colonisation française en Afrique
exposé :
la colonisation française en Afrique
aide pour traiter le sujet
À la suite de plusieurs demandes de "plans" pour des exposés sur la colonisation française en Afrique, nous proposons les éléments d'aide suivants. Il est impossible de définir un plan passe-partout, pour deux raisons :
- 1) Généralement, le sujet est plus précis que cet énoncé : la colonisation française en Afrique. Cette Afrique, pour commencer, comprend-elle le Maghreb, ou bien ne recouvre-t-elle que l'Afrique "noire" ? Ensuite, le sujet peut évoquer les différentes phases de l'expansion, les motifs et idéologies de la colonisation, les modalités de domination et d'administration, les résistances aux Européens, ou encore des aspects particuliers (rapports avec les "indigènes", économie, influences culturelles, etc...), la confrontation avec d'autres puissances coloniales, les conditions d'émancipation des peuples colonisés... Le plan doit donc varier en fonction du sujet fourni et/ou de l'accent que veut lui donner l'auteur.
- 2) Un sujet de travail (exposé, dissertation, dossier...) est soumis avec l'objectif que celui qui le traitera devra rechercher des informations, mobiliser des connaissances, trier des références, réfléchir à une démonstration lui-même... C'est tout l'intérêt formateur de ce type d'exercice. Permettre à celui qui y est astreint, de faire l'économie de ces tâches est contre-productif. Par contre, il est du devoir de ceux qui disposent d'une certaine connaissance de ce sujet, d'aider les autres à en acquérir eux-mêmes, sans se substituer à leur responsabilité dans le traitement final du sujet.
Études Coloniales
______________________________________
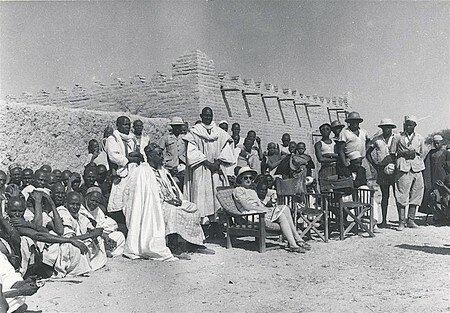
village de Karal (Tchad) : le ""tata"" [tam-tam] du chef du canton - Scène de fête.
Le chef de canton (homme aux lunettes noires) préside avec à ses côtés une femme coiffée
du casque colonial, décembre 1951 (source : Caom, base Ulysse)
quelques tables des matières d'ouvrages d'histoire
relatifs à la colonisation française en Afrique
- Histoire générale de l'Afrique. VII - L'Afrique sous domination coloniale, 1880-1935, collectif, dir. du volume, A. A. Boahen (Ghana), Unesco, 1989.
volume, A. A. Boahen (Ghana), Unesco, 1989.
chap. premier
L'Afrique face au défi colonial
chap. 2
Partage européen et conquête de l'Afrique
chap. 3
Initiatives et résistances africaines face au partage et à la conquête
chap. 4
Initiatives et résistances africaines en Afrique du Nord-Est
chap. 5
Initiatives et résistances africaines en Afrique du Nord et au Sahara
chap. 6
Initiatives et résistances africaines en Afrique occidentale de 1880 à 1914
chap. 7
Initiatives et résistances africaines en Afrique orientale de 1880 à 1914
chap. 8
Initiatives et résistances africaines en Afrique centrale de 1880 à 1914
chap. 9
Initiatives et résistances africaines en Afrique méridionale
chap. 10
Madagascar de 1880 à 1939 : Initiatives et résistances africaines à la conquête et à la domination coloniales
chap. 11
Le Libéria et l'Éthiopie, 1880-1914 : la survie de deux États africains
chap. 12
La Première Guerre mondiale et ses conséquences
chap. 13
La domination européenne : méthodes et institutions
chap. 14
L'économie coloniale
chap. 15
L'économie coloniale des anciennes zones françaises, belges et portugaises (1914-1935)
chap. 16
L'économie coloniale : les anciennes zones britanniques
chap. 17
L'économie coloniale : l'Afrique du Nord
chap. 18
Les répercussions sociales de la domination coloniale : aspects démographiques
chap. 19
Les répercussions sociales de la domination coloniale : les nouvelles structures sociales
chap. 20
La religion en Afrique pendant l'époque coloniale
chap. 21
Les arts en Afrique à l'époque de la domination coloniale
chap. 22
Le nationalisme africain et le colonialisme, 1919-1935
chap. 23
La politique et le nationalisme en Afrique du Nord-Est, 1919-1935
chap. 24
La politique et le nationalisme en Afrique au Maghreb et au Sahara, 1919-1935
chap. 25
La politique et le nationalisme en Afrique occidentale, 1919-1935
chap. 26
La politique et le nationalisme en Afrique orientale, 1919-1935
chap. 27
La politique et le nationalisme en Afrique centrale et méridionale, 1919-1935
chap. 28
L'Éthiopie et le Libéria, 1914-1935 : deux États africains indépendants à l'ère coloniale
chap. 29
L'Afrique et le nouveau monde
chap. 30
Le colonialisme en Afrique : impact et signification
- L'Afrique occidentale au temps des Français. Colonisateurs et colonisés (vers 1860-1960), dir. Catherine Coquery-Vidrovitch, La Découverte, 1992
Introduction
Le pays, son passé, ses cultures
Facteurs communs
1. Les changements sociaux
2. Quel passé pour l'Afrique ?
2.1 De l'histoire coloniale à l'histoire africaine (1912-1960)
2.2 L'histoire de l'Afrique occidentale enseignée aux enfants de France
3. L'armée coloniale en Afrique occidentale française
4. Géopolitique de la colonisation
5. La politique économique coloniale
6. L'islam sous le régime colonial
"États coloniaux"
7. Sénégal-Soudan (Mali) : deux États pour un empire
8. La Mauritanie de 1900 à 1961
9. Le Niger
10. La Haute-Volta (Burkina-Faso)
11. La Côte d'Ivoire
12. La Guinée
13. Le Dahomey (Bénin)
14. Le Togo
- Pour en finir avec la colonisation, Bernard Lugan, éd. du Rocher, 2006 .
.
Préambule : réflexions sur le débat colonial
Première partie :
De l'Afrique ignorée à l'Afrique approchée (du XIVe siècle à 1884)
chap. 1
Les Européens du XIVe siècle à 1800
chap. 2
Les Européens et l'Afrique du Nord de 1800 à 1870
chap. 3
Les Européens et l'Afrique Noire de 1800 jusqu'au Congrès de Berlin (1884)
chap. 4
Les explorations
Deuxième partie :
De l'Afrique partagée à l'Afrique dominée (1885 à 1914)
chap. 5
La colonisation française, une grande idée de gauche
chap. 6
La création de l'empire colonial français
chap. 7
La colonisation britannique ou l'impérialsime sans complexe
chap. 8
L'Allemagne entre le refus de la colonisation et la "place au soleil"
chap. 9
Les autres nations coloniales (Belgique, Portugal, Espagne et Italie)
Troisième partie :
De l'apogée du système colonial à l'amorce de la décolonisation (1914 à 1945)
chap. 10
Le premier conflit mondial en Afrique et ses conséquences
chap. 11
Les années 1919-1939 ou la transition
chap. 12
Le second conflit mondial et ses conséquences
Quatrième partie :
L'Afrique libérée (1945 à 1975)
chap. 13
La décolonisation française
chap. 14
La déchirure algérienne
chap. 15
La décolonisation britannique
chap. 16
Les autres décolonisations
Cinquième partie :
La colonisation en débats
chap. 17
Les doctrines coloniales
chap. 18
La France fut-elle ruinée par ses colonies ?
chap. 19
Les colonies africaines ne furent pas de bonnes affaires pour les colonisateurs
chap. 20
Les véritables responsabilités de la colonisation
Conclusion
De la colonisation de l'Afrique à la colonisation de l'Europe
- L'Afrique et les Africains au XIXe siècle, Catherine Coquery-Vidrovitch, Armand Colin, 1999.
Le chapitre 6 de cet ouvrage est consacré à "l'intervention coloniale". Voici sa composition :
1 - Les débuts de l'impérialisme colonial en Afrique noire
2 - La genèse de l'administration coloniale
3 - L'achèvement des conquêtes coloniales
3.1 - En Afrique de l'Ouest
3.2 - En Afrique centrale
4 - Les résistances
4.1 - Arabes, Swahili et Nyamwezi : la révolte de Pangani et le soulèvement d'Abushiri
4.2 - L'union imprévue : la révolte shona et ndebele de 1896
5 - L'Algérie. De la conquête à la colonisation
5.1 - Conquête et colonisation de peuplement
5.2 - Une résistance nationale ? D'Abd el-Kader aux Kabyles
5.3 - La misère algérienne
Signalons que Catherine Coquery-Vidrovitch ne traite, dans ce livre, que du XIXe siècle. Dans ce cadre, "S'il fallait, dans la première moitié du XIXe siècle, souligner l'importance des impacts nouveaux, les avatars de l'islam en Afrique du Nord et son expansion au sud de Sahara (...) apparaissent sur le plan interne un acteur autrement puissant que l'impact occidental" (p. 9).
- L'empire triomphant, 1871/1936 - 1. Afrique occidentale et équatoriale, Gilbert Comte, éd. Denoël, coll.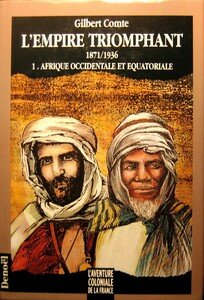 "L'Aventure coloniale de la France", 1988.
"L'Aventure coloniale de la France", 1988.
Première partie : la conquête
1 - Les Républicains et le "groupe colonial"
2 - La marche de Gallieni vers le Soudan
3 - La longue poursuite de Samory
4 - Sur le Niger et dans la forêt ivoirienne
5 - Du royaume de Béhanzin aux confins sahariens
6 - Brazza aux mains nues sur le Congo
7 - La remontée de Gentil vers le lac Tchad
8 - Foureau et Lamy à travers le Hoggar
9 - La course ensanglantée de la colonne Voulet-Chanoine
10 - La défaite de Rabah et le massacre des vaincus
Deuxième partie : la colonisation
1 - La mise en place des structures
2 - L'opinion métropolitaine face aux scandales du Congo
3 - Mercantilisme et réformisme
4 - Dans les tranchées de l'Europe en guerre
5 - Bastions allemands en Afrique
6 - À la recherche d'une doctrine
7 - Apothéose au bois de Vincennes
______________________________________
cartographie

Afrique subsaharienne en 1880 - principaux États
et empires africains (en rouge)

carte de l'Afrique colonisée en 1914

la décolonisation des pays d'Afrique
- source des trois cartes : cabinda.org/histoire


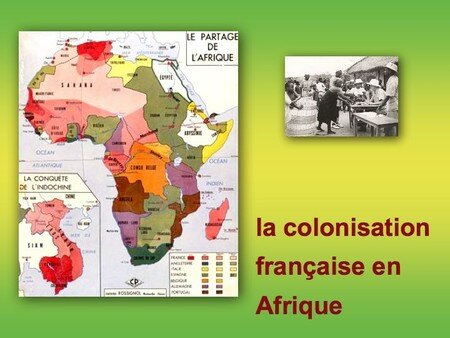
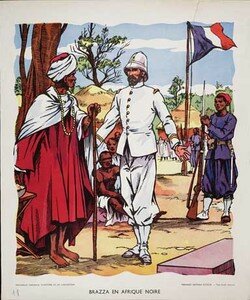

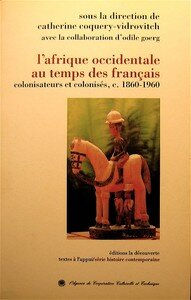





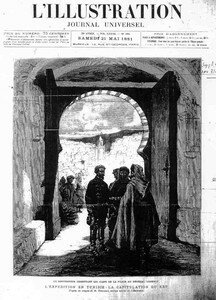
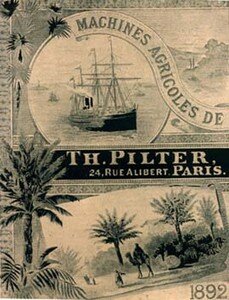


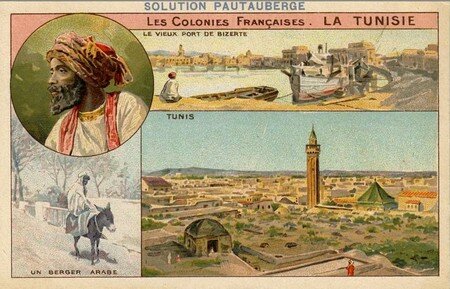
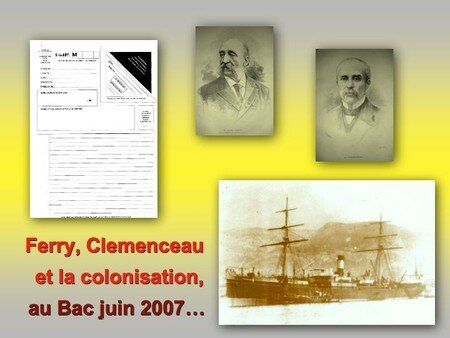













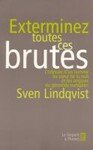

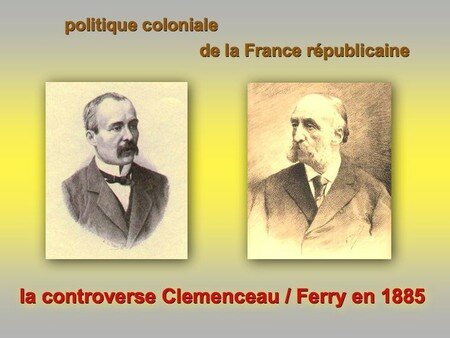
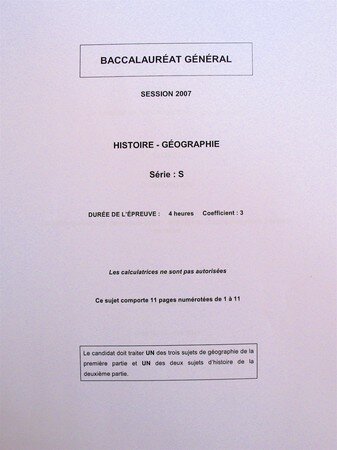


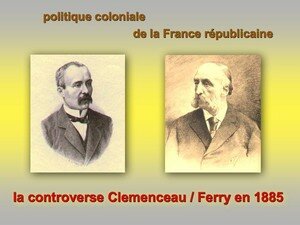

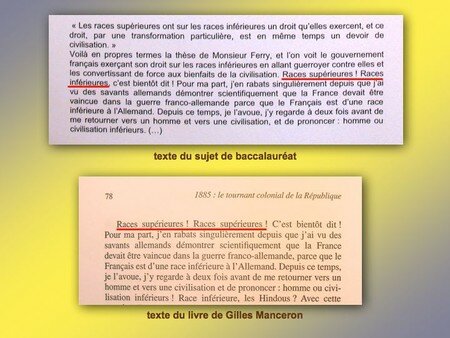
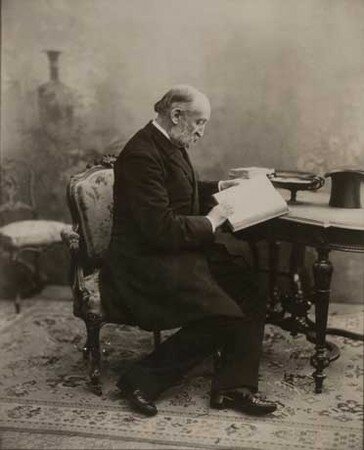





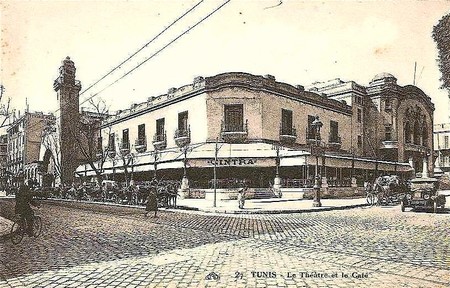


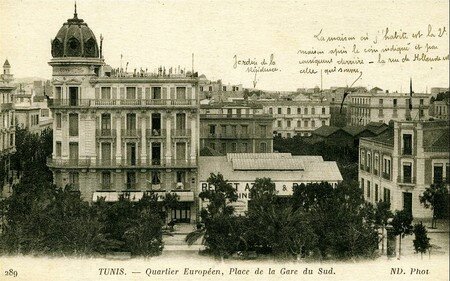





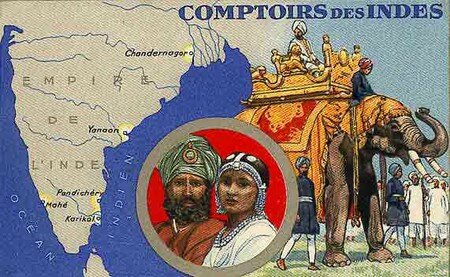
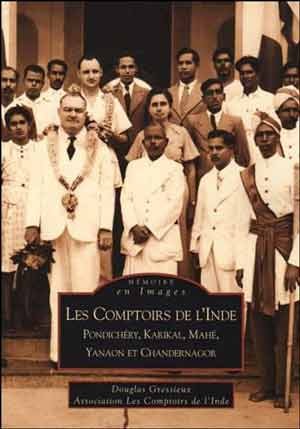


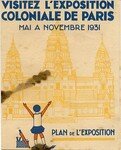




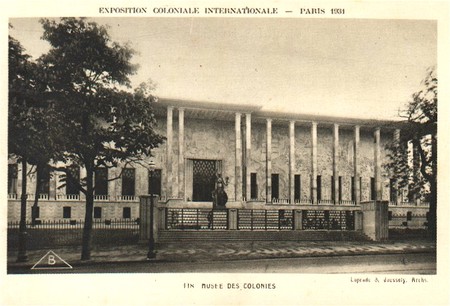
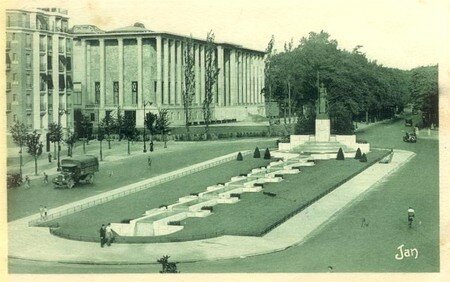


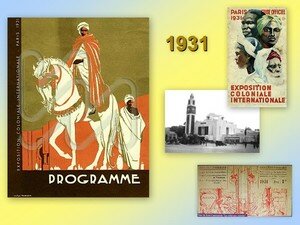
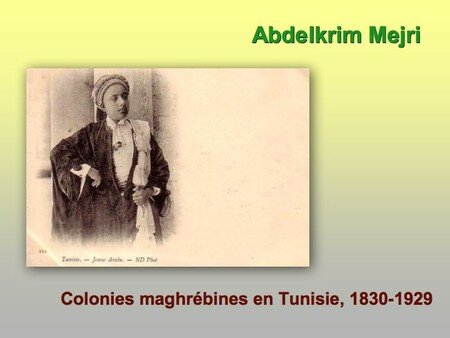
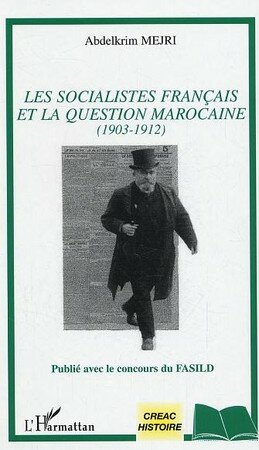



/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)